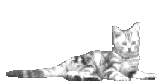-
La découverte du corps

Si la marche et la lecture solitaire sont des marqueurs de la recherche d’un épanouissement personnel, qui n’a plus que faire d’attitudes démonstratives, ce ne sont pas les seuls.
Depuis la Renaissance, les manuels dits de civilité (de savoir-vivre) ont de plus en plus insisté sur le positionnement du corps dans l’espace. L’essentiel étant de dérober son corps au toucher et au regard des autres, on a ainsi progressivement banni les embrassades et les courbettes excessives, le but étant certes de ne pas se faire oublier, mais sans s’imposer. Cette nouvelle approche du corps, conçu comme à soi, induit la grande innovation du siècle qu’est la toilette faite dans le secret d’une pièce privée.
Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, l’eau était considérée comme dangereuse. Elle l'était certes sous l’influence des religieux, qui redoutaient une auto complaisance érotique dans le bain, mais aussi sous celle des scientifiques qui étaient également très réticents devant un usage inconsidéré de l’eau, dans les ablutions, mais plus encore dans les bains. Bordeu, un médecin du XVIIIe siècle, disait en effet avoir connu des individus vigoureux, détruits par l’hygiène :
« La peau s’était nettoyée, les émanations et la transpiration fortes s’étaient détruites, mais tout ce qui caractérise le sexe était éteint. »
On ignorait donc l’usage de l’eau, sauf pour le visage et les mains, et on lui préférait la toilette sèche, qui consistait en un essuyage avec de l’alcool ou du parfum. Le linge de corps, qu’on ne changeait pas, avait du reste cette fonction d’essuyage. La netteté se concentrait en revanche sur les parties visibles : on secouait de temps en temps les vêtements pour en ôter la poussière, mais col et poignets devaient être impeccables.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les choses évoluent : le docteur Tronchin recommande, outre la marche et des repas frugaux, la toilette à l’eau froide. Or Nicolas Le Floch suit cette règle, lui qui a coutume de se laver tous les matins à grande eau, si possible à la fontaine de la cour et « dans sa natureté ».
Il devient aussi de bon ton d'avoir son propre cabinet de toilette, voire sa propre salle de bains. Certes le moment du bain n’est pas forcément intime pour autant : Louis XV, qui possédait une salle de bain avec deux baignoires – l'une pour se savonner, l'autre pour se rincer (cf. L’Affaire Nicolas Le Floch) – prenait encore son bain en public. Mais les particuliers se dotent peu à peu du même confort dans un espace privé donnant sur leur chambre, ce que ne manque pas de souligner Jean-François Parot lorsqu'il mentionne, dans Le Crime de l'hôtel Saint-Florentin, qu'une salle de bain est attenante à la chambre à coucher du duc de La Vrillière.
Portrait du célèbre docteur genevois Théodore Tronchin (1709-1781), gravé par Robert Gaillard, d'après Jean-Étienne Liotard.
Quand on ne dispose pas de ce confort, il y a les bains flottants avec leurs cabines individuelles, ceux-là mêmes dont il est question dans Le Crime de l'hôtel Saint-florentin. On y offre aux clients des serviettes, du savon à la bergamote et des mules.
« On y disposait d’une baignoire en cuivre, d’un banc, d’un guéridon où une bouteille attendait dans un rafraîchissoir, d’une toilette et d’une chaise longue », écrit Jean-François Parot.

Bien qu'ils datent du XIXe siècle, ces dessins – de S. Frisch et de Civeton – peuvent donner
une idée des barges de bains flottants qui sont au centre
de l'énigme du Crime de l'Hôtel Saint-Florentin.L’article « Parfum », dans l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et d’Alembert, est clair :
« Autrefois les parfums où entraient le musc, l’ambre gris et la civette, étaient recherchés en France, mais ils sont tombés de mode, depuis que nos nerfs sont devenus plus délicats. »
La senteur animale dénonce l’homme du peuple ou la personne sans savoir-vivre. "L’élégant n’exhale point l’ambre", note Mercier et Casanova manque de défaillir à l’apparition de la vieille duchesse nymphomane qui sentait le musc à vingt pas :
« Une odeur infecte de musc qui me parut cadavéreuse faillit me faire trouver mal. »
La mode est donc aux parfums végétaux, frais, subtils et discrets, comme le bois de rose et de cèdre, l'iris, la fleur d'oranger, la rose, le jasmin, la jonquille, la tubéreuse, et autres fleurs odorantes, mais aussi des senteurs aux fruits. Or, dans L’Affaire Nicolas Le Floch, Julie de Lastérieux use « d’essences particulières, bergamote ou cédrat, dissoutes dans l’alcool ».

Ci-dessus, un nécessaire à parfums du XVIIIe siècle
contenant deux flacons en verre et un entonnoir.On n’utilise pas non plus le parfum à profusion. Julie de Lastérieux est encore l’illustration même de cette mutation, qui s’opère dans le XVIIIe siècle finissant : elle use en effet du parfum avec parcimonie afin – écrit Jean-François Parot – de « laisser percer l’atmosphère individuelle, révélatrice de l’unicité du moi ». Exhaler un puissant parfum, c’est en effet laisser supposer une propreté douteuse : le musc engendre le soupçon. Il faut, dans l'usage du parfum comme dans les gestes, signaler sa présence sans l’imposer.
On opte aussi, dans l'intimité, pour des vêtements plus confortables, telles la robe de chambre en perse fleurie de M. de Noblecourt ou celle d’indienne de La Borde. Dans Le Cadavre anglais, la reine elle-même reçoit Nicolas « en chenille et décoiffée ».
http://www.nicolaslefloch.fr/Vie-Paris/l-intimite-au-18e-siecle-3.html
 Tags : parfum, siecle, bain, d’un, –
Tags : parfum, siecle, bain, d’un, –
-
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Vous devez être connecté pour commenter