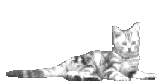-
Par Dona Rodrigue le 17 Septembre 2016 à 16:26

Louis-Philippe 1er, roi des Français
Fils de Louis-Philippe-Joseph d’Orléans (dit Philipe-Égalité) et
de Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, cousin de Louis XVI,
Louis-Philippe d’Orléans (1773-1850) est âgé de 16 ans lorsque
survient la Révolution de 1789.
Favorable aux idées nouvelles mais prudent, il débute une brève carrière militaire qui lui évite de trop s’engager politiquement. Nommé lieutenant général, il participe en 1792 et 1793 aux batailles victorieuses de Valmy et Jemmapes opposant les armées révolutionnaires à une coalition étrangère.
Sa position de prince français et son opposition aux excès de la Révolution le forcent à s’exiler en avril 1793.
D’abord réfugié en Suisse, il visite par la suite plusieurs pays, dont les Etats-Unis, avant de se fixer en Angleterre.
En 1809 il épouse Marie-Amélie de Bourbon des Deux-Siciles qui lui donnera dix enfants.
En 1815, la chute de Napoléon 1er et la restauration des Bourbon lui permettent de rentrer en France avec toute sa famille.
Bien qu’ayant retrouvé son rang de prince, il garde une certaine distance avec le nouveau régime.
Cette position lui vaut une popularité dans les milieux modérés.
Homme d’affaires pugnace, il reconstitue progressivement l’immense fortune familiale qu’il fait fructifier.
En juillet 1830 une révolution renverse le roi Charles X et le 9 août suivant Louis-Philippe est proclamé roi des Français par l’Assemblée Nationale.
Il régnera jusqu’en 1848 sous le nom de Louis-Philippe 1er.
A son tour renversé par une révolution, il s’exile en Angleterre où il décède en 1850.

Il est le dernier roi ayant régné en France.
Passionné d’aménagement forestier et d’architecture, Louis-Philippe a joué
un rôle déterminant dans la création du Domaine de Randan.
Il y séjourne chaque année de 1821 à 1829 et s’investit directement dans ce
projet au côté de sa sœur Adélaïde d’Orléans.
Devenu roi, il ne fera plus le voyage de Randan mais il continuera à apporter ses conseils sur l’organisation et le développement de la propriété.
On lui doit notamment l’idée d’étendre le château en créant une vaste aile surmontée d’une terrasse donnant accès à une nouvelle chapelle, disposition très originale.
Au moment de son abdication en février 1848, Louis Philippe exprime le souhait de se retirer à Randan mais les évènements ne lui permettront pas de goûter cette retraite.
Louis-Philippe 1er, roi des Français
Née en 1777, Adélaïde d’Orléans est la fille de Louis-Philippe-Joseph d’Orléans
(dit Philippe Egalité) et de Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre.
http://pulsatilla.eklablog.com/le-domaine-royal-de-randan-2-a118278910
A partir de 1782 son éducation est confiée à Madame de Genlis, comme celle de son frère le futur roi Louis-Philippe. Mêlant les anciens principes d’éducation des princes aux idées nouvelles de Rousseau sur la pédagogie, Madame de Genlis donne à ses élèves une éducation stricte mais ouverte sur le monde : apprentissage des langues, visites de monuments ou de manufactures, activités physiques, travaux manuels, jardinage…
En 1787, Adélaïde d’Orléans est baptisée dans la chapelle de Versailles avec Louis XVI et Marie-Antoinette pour parrain et marraine. A la veille de la Révolution, le projet de son mariage avec le duc d’Angoulême est refusé par le roi.
Tout comme le duc d’Orléans, Mme de Genlis est tout d’abord favorable aux idées et mouvements qui aboutissent à la Révolution et c’est avec enthousiasme qu’elle conduit ses élèves, Adélaïde en tête, à assister à la prise de la Bastille le 14 juillet 1789.

Face aux incertitudes de l’époque, Madame de Genlis
et Adélaïde d’Orléans partent pour l’Angleterre en octobre 1791 où elles séjournent durant un an.

Elles sont alors considérées comme émigrées par le pouvoir révolutionnaire.
En novembre 1792, le duc d’Orléans les fait rentrer en France espérant obtenir qu’elles soient rayées de la liste des émigrés, en vain.
En décembre la gouvernante et son élève partent se réfugier en Belgique :
le début de 22 années d’exil pour Adélaïde d’Orléans.
Son père le duc d’Orléans ayant voté la mort de Louis XVI avant d’être lui-même guillotiné,
Adélaïde d’Orléans est à la fois rejetée par les monarchistes émigrés et par la France révolutionnaire.
Persécutée par tous, elle connaît des années d’exil difficiles qui la conduiront en Suisse, en Bavière et en Hongrie au gré de l’évolution géopolitique de l’Europe.

En 1801, elle réussit à rejoindre sa mère exilée en Espagne.
Surtout, en 1808, elle retrouve son frère Louis-Philippe en Angleterre :
ils seront désormais inséparables.
Adélaïde rentre en France à la faveur de la restauration de la monarchie en 1815.
Ne s’étant jamais mariée, elle vit aux côtés de son frère de sa belle-sœur et de leurs nombreux enfants
qu’elle considère comme les siens.
En 1821, elle hérite d’une partie de la fortune de sa mère la duchesse douairière d’Orléans
ce qui lui permet d’acquérir le château et la forêt de Randan.
Après la perte de nombreux parents, après un long et périlleux exil,
la princesse fait de Randan un lieu de villégiature familial, un refuge intime.
Adélaïde d’Orléans jouera un rôle important dans l’ascension politique de son frère, notamment durant les journées révolutionnaires qui le portèrent au trône en 1830.
Devenue Madame Adélaïde, sœur du roi, elle apportera ses conseils et son soutient constant
à LouisPhilippe, notamment en jouant les intermédiaires.
Victor Hugo dira à son sujet
« C’était une femme intelligente et de bons conseils, qui abondait dans le sens du roi sans jamais verser. Madame Adélaïde avait quelque chose de viril et de cordial, avec beaucoup de finesse…Elle avait partagé son exil [à Louis-Philippe] elle partageait un peu son trône.
Elle vivait dévoué à son frère, absorbé en lui, ayant pour égoïsme
le moi de Louis-Philippe ».
Décédée le 31 décembre 1847, elle ne verra pas la révolution
qui renversera Louis-Philippe deux mois plus tard.

Adélaïde d’Orléans
Isabelle d’Orléans (1848-1919) est la fille d’Antoine d’Orléans, duc de Montpensier,
fils du roi Louis-Philippe, et de Marie-Louise Fernande de Bourbon,
fille du roi Ferdinand VII d’Espagne et sœur de la reine Isabelle II d’Espagne.
Depuis la chute du roi Louis-Philippe en 1848, le duc de Montpensier était exilé en Espagne, pays de son épouse ; c’est pourquoi Isabelle d’Orléans est née à l’Alcazar de Séville, en 1846.
Le duc et la duchesse de Montpensier s’installèrent au palais de San-Telmo, également à Séville, qui resta leur résidence principale tout au long du XIXème siècle.
La jeune Isabelle vécue donc toute sa jeunesse en Andalousie, région à laquelle elle restera profondément attachée.
En 1864, Isabelle d’Orléans épouse son cousin germain Philippe d’Orléans, comte de Paris, héritier présomptif de la couronne de France.
Elle doit alors quitter l’Espagne pour rejoindre l’Angleterre, terre d’exil de son mari. Neuf enfants naîtront de cette union.
La Chute du Second-Empire et l’instauration de la IIIème République permettent l’abrogation de la loi qui condamnait la famille d’Orléans à l’exil. En 1871, le comte et la comtesse de Paris arrivent en France, pays qu’ils découvrent.
A cette occasion ils visitent pour la première fois le château de Randan, propriété que le duc de Montpensier a hérité de sa tante Madame Adélaïde.
En 1886, le comte et la comtesse de Paris marient leur fille Amélie à l’héritier du trône du Portugal. Ce mariage donne lieu à des mouvements royalistes qui inquiètent la jeune République et aboutissent à la promulgation d’une nouvelle loi d’exil interdisant le territoire français au chef des familles ayant régné sur la France.
Le comte de Paris et son épouse reprennent le chemin de l’Angleterre.
En 1890, le duc de Montpensier décède près de Séville.
Par testament, il lègue à sa fille Isabelle son château de Randan, en France, et son Palais de Villamanrique en Espagne.
En 1893, le comte de Paris décède à son tour.
Non soumise à la loi d’exil, la comtesse de Paris quitte définitivement l’Angleterre.
Désormais elle partage son temps entre Randan, sa résidence d’été, et Villamanrique, sa résidence d’hiver.
Très attachée à Randan, Isabelle reprend en main le Domaine qu’elle modernise : embellissement de la façade du château, installation du confort moderne (téléphone, eau courante, électricité)…
Pendant la Première Guerre mondiale, elle installe dans les dépendances du château un hôpital militaire.
A son décès en 1919, la comtesse de Paris lègue à son fils Ferdinand d’Orléans, un Domaine en parfait état d’entretien qu’il s’agisse des bâtiments, du parc ou de l’immense massif forestier.

Isabelle d’Orléans, comtesse de Paris
C’est à Ferdinand d’Orléans (1884-1924), dernier duc de Montpensier, que l’on doit l’exceptionnel Musée de la Chasse de Randan. Sa vie prématurément achevée peut-être divisée en trois périodes principales :
LA JEUNESSE D’UN PRINCE
Ferdinand d’Orléans naît au château d’Eu en 1884.
Son père, le comte de Paris, est le petit-fils du roi Louis-Philippe et le chef de la famille royale française.
Sa mère, Isabelle d’Orléans, également petite-fille du roi Louis-Philippe, est infante d’Espagne.
Antoine d’Orléans, père de la comtesse de Paris et grand-père de Ferdinand décède en 1890.
Il lègue à sa fille son Domaine de Randan et à son petit-fils Ferdinand son titre de duc de Montpensier.
En 1893,la comtesse de Paris prend possession de Randan où Ferdinand séjourne pour la première fois.
On aménage pour lui une salle d’étude dans laquelle figure déjà des oiseaux naturalisés.
D’abord éduqué un précepteur, Ferdinand est envoyé dans un externat d’Angers de 1895 à 1897.
Interdit de service dans l’armée française, il obtient en 1898 l’autorisation du roi d’Espagne d’intégrer l’Ecole navale espagnole.
Il poursuit sa formation militaire jusqu’en 1906 date à laquelle il quitte l’armée avec le grade de lieutenant de vaisseau.
C’est dans le cadre de la marine militaire espagnole que Ferdinand réalise en 1903-1904 un premier long voyage qui le conduit en Amérique du Sud et en Afrique où il tue pour la première fois de grands animaux exotiques.
Leurs dépouilles sont sans doute à l’origine du musée cynégétique de Randan qui est cité pour la première fois en juillet 1904.
LE TEMPS DES EXPEDITIONS
On désigne par « Belle Époque » la période qui a précédé le Première Guerre mondiale, moment d’expansion économique et de relative insouciance. Pour Ferdinand d’Orléans c’est également le temps le plus agréable et le plus intense de son existence.
En 1906, il part pour la première fois en Indochine.
Ce voyage marque le début de sa passion pour cette colonie française d’Extrême-Orient où il séjourne à six reprises et où il se fait construire un castel.
En Indochine Ferdinand veut faire œuvre de colonisateur en témoignant auprès de ces concitoyens des attraits de cette colonie.
Il explore particulièrement l’Annam où il s’implante ; surtout, il réalise l’exploit de relier Saïgon aux ruines d’Angkor en automobile afin de prouver que le tourisme est une ressource possible pour l’économie locale.
A cette occasion il plaide pour la sauvegarde des vestiges des anciennes citées Khmers d’Angkor.
Lors de ses expéditions, Ferdinand réalise des photographies et des films, parfois avec l’aide d’opérateurs. De retour en France, il utilise ces documents pour illustrer ses comptes-rendus de voyage où faire des projections lors de conférences mondaines ou populaires.
Durand ses voyages qui le conduisent dans de nombreux pays, Ferdinand s’adonne à sa passion de la chasse, rassemblant de nombreux trophées.
En 1909, Ferdinand offre ses services au roi d’Espagne dans la guerre coloniale qui oppose ce pays au Maroc. Le prince, en qualité d’officier de marine, concourt à la campagne de Melilla et de Peñón de Vélez de la Gomera (Maroc).
Tombé malade au bout de trois mois, il met fin à son engagement.
En 1912, l’Albanie s’émancipe de l’Empire Ottoman, proclame son indépendance et se cherche un souverain.
Pressenti, le duc de Montpensier, se tient alors à la disposition de ce nouvel état.
Quelques heures durant, il débarque secrètement sur les côtes albanaises malgré le blocus qui frappe le pays.
Finalement, en avril 1913, sous la pression de la diplomatie internationale, Ferdinand décline toute candidature au trône d’Albanie mettant fin à cette aventure hasardeuse.
En 1913, Ferdinand entreprend un tour du monde sur son yacht le Mékong. Il se trouve au Japon, quand le 2 août 1914 la France déclare la guerre à l’Allemagne. Dans la nuit du 23 au 24 août, le Mékong croise un vapeur allemand - le Hannamethal- ; il ouvre le feu sur lui, l’oblige à se rendre et le livre à la flotte britannique basée à Weihaiwei (Chine). Ce sera son unique fait d’arme pendant la Première Guerre car aucune armée alliée ne l’accepte dans ses rangs.
LES ILLUSIONS PERDUES
Si en apparence Ferdinand d’Orléans essaie de tenir son rang de cadet de la famille royale, la dernière décennie de sa vie est marquée par le déclin physique et moral.
En 1914,à l’issue de son ultime voyage en Extrême-Orient, Ferdinand rentre en France en automne. Il a trente ans et deux scandales le menacent.
Le premier, qui transpire dans la presse, concerne ses difficultés financières : le duc de Montpensier est au bord de la faillite. Les voyages et les chasses ont fait fondre son patrimoine, tout comme sa passion pour les innovations technologiques (voitures, avion, cinématographe…) ou son train de vie flamboyant.
Lesecond touche à l’état de santé du prince. Comme de nombreux membres de la haute société, Ferdinand est morphinomane. Il semble qu’il est contracté l’habitude de consommer cette drogue à l’époque où il était aspirant dans la marine espagnole. Il ne parviendra pas à se défaire de son accoutumance.
A la mort de sa mère en 1919, Ferdinand hérite de la plus grande partie du Domaine de Randan.
En 1921 il épouse à Randan Isabelle de Valdeterrazo, vicomtesse de los Antrines, fille fortunée d’un grand d’Espagne.
Cette union n’apporte pas la stabilité escomptée.
Isolé, soumis à l’influence de son entourage, puis à celle de son épouse,
Ferdinand connaît une fin de vie pathétique.
Il décède au château de Randan le 30 janvier 1924 à l’âge de 40 ans et est inhumé le 9 février suivant en la chapelle royale de Dreux.
Si sa mort a pu être considérée comme suspecte, elle n’a pas surpris ceux qui connaissaient sa faiblesse pour les paradis artificiels et qui redoutaient depuis longtemps une fin prématurée.
 Ferdinand d’Orléans, duc de Montpensier
Ferdinand d’Orléans, duc de Montpensierhttps://fr.pinterest.com/maxmcx78/house-of-bourbon-orleans/
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Dona Rodrigue le 6 Janvier 2015 à 21:31

Michel Cabieu repoussant l’attaque anglaise à Ouistreham
Dans la nuit du 12 au 13 juillet 1762, peu de temps avant la signature du traité de Paris qui mit fin à la guerre de Sept Ans, une escadre anglaise, en croisière dans la Manche, débarqua trois détachements d’environ cinquante hommes chacun à l’embouchure de la rivière d’Orne.
Ces troupes avaient l’ordre d’enclouer les pièces des batteries de Sallenelles, d’Ouistreham et de Colleville.
Si l’expédition réussissait, l’ennemi brûlait, le lendemain, les bateaux mouillés dans la rivière, remontait l’Orne jusqu’à Caen, assiégeait la ville et s’ouvrait un chemin à travers la Normandie.
L’audace d’un homme de cœur fit échouer le projet des Anglais et sauva le pays.
Voici le fait dans toute sa grandeur, dans toute sa simplicité.
A cette époque, Michel Cabieu, sergent garde-côte, habitait une petite maison située à l’extrémité nord d’Ouistreham.
Dans son isolement, cette maison ressemblait à une sentinelle avancée qui aurait eu pour consigne de préserver le village de toute surprise nocturne.
Ses fenêtres s’ouvraient sur les dunes et sur la mer.
En plein jour, pas un homme ne passait sur le sable, pas une voile ne se montrait à l’horizon, sans qu’on les aperçût de l’intérieur de la chaumière.
Mais l’ennemi avait bien choisi son temps. La nuit était profonde. II n’y avait plus de lumières dans le village.
Les Anglais laissèrent quelques hommes pour garder les barques et se divisèrent en deux troupes, dont l’une se dirigea vers Colleville, tandis que l’autre se disposa à remonter les bords de la rivière d’Orne.
Ce soir-là, Michel Cabieu s’était couché de bonne heure. Il dormait de ce lourd sommeil que connaissent seuls les soldats préposés à la garde des côtes et obligés de passer deux nuits sur trois.
A ses côtés, sa femme luttait contre le sommeil. Elle savait son enfant souffrant et ne pouvait se décider à prendre du repos.
De temps en temps elle se soulevait sur un coude et se penchait sur le lit du petit malade pour écouter sa respiration.
L’enfant ne se plaignait pas ; son souffle était gal et pur, et la mère allait peut-être fermer les yeux, lorsqu’elle entendit tout à coup un grognement, qui fut suivi d’un bruit sourd contre la porte extérieure de la maison.

Plaque commémorant l’exploit de Michel Cabieu « Maudit chien ! murmura-t-elle. Il va réveiller mon petit Jean. » Des hurlements aigus se mêlaient déjà à la basse ronflante du dogue en mauvaise humeur. Il y avait dans la voix de l’animal de la colère et de l’inquiétude. Encore quelques minutes, et il était facile de deviner qu’il allait jeter bruyamment le cri d’alarme. La mère n’hésita pas ; elle sauta à bas du lit, ouvrit doucement la fenêtre et appela le trop zélé défenseur à quatre pattes.

« Ici, Pitt ! ici ! » dit la femme du garde en allongeant la main pour caresser le dogue. Le chien reconnut la voix de sa maîtresse et s’approcha.
C’était un de ces terriers ennemis implacables des rats, et qui ne se font pardonner leur physionomie désagréable que pour les services qu’ils rendent dans les ménages.
II avait appartenu autrefois au fameux corsaire Tharot, qui l’avait trouvé à bord d’un navire anglais auquel il avait donné la chasse.
En changeant de maître, il avait changé de nom.
On l’appelait Pitt, en haine du ministre anglais qui avait fait le plus de mal à la marine française.
« Paix ! monsieur Pitt ! paix ! »
répétait la femme de Cabieu en frappant amicalement sur la tête du chien.
Mais celui-ci, comme son illustre homonyme, ne rêvait que la guerre. II n’était pas brave cependant, car il s’était blotti, en tremblant, contre le bas de la fenêtre. Mais, comme les peureux qui se sentent appuyés, il éleva la voix, allongea le cou dans la direction de la mer et fit entendre un grognement menaçant.
« Il faut pourtant qu’il y ait quelque chose », pensa la mère. Elle se pencha et regarda dans la nuit. Mais elle ne put rien apercevoir sur les dunes. A peine distinguait-on, sur ce fond obscur, l’ombre plus noire des buissons de tamaris agités par le vent.
Au-dessus des dunes, une bande moins sombre laissait deviner le ciel.
La femme de Cabieu crut même apercevoir une étoile.
Puis l’astre se dédoubla.
Les deux lumières s’écartèrent et se rapprochèrent, pour se rejoindre encore.
« Ce ne sont pas des étoiles ! se dit la mère avec épouvante.
Ce sont des feux de l’escadre anglaise.
Ils nous préparent quelque méchant tour. »
Tandis qu’elle faisait ces réflexions, le chien se mit à aboyer avec fureur. La femme du garde regarda de nouveau devant elle. Il lui sembla voir remuer quelque chose sur le haut de la dune.
« C’est l’ennemi ! » dit-elle en pâlissant.
Elle courut auprès du lit et réveilla son mari.
— Michel ! Michel ! cria-t-elle d’une voix tremblante, les Anglais !
— Les Anglais ! répéta le sergent en écartant brusquement les couvertures. Tu as le cauchemar !
— Non. Ils sont débarqués. Je les ai vus.Ils vont venir. Nous sommes perdus !
— Nous le verrons bien ! dit Cabieu en sautant dans la chambre.Il chercha ses vêtements dans l’obscurité et s’habilla à la hâte.
Le chien ne cessait d’aboyer.
— Diable ! diable ! fit le garde-côte en riant, ils ne doivent pas être loin.
M. Pitt reconnaît ses compatriotes.
Depuis qu’il est naturalisé Français, il aime les Anglais autant que nous.
— Peux-tu plaisanter dans un pareil moment, Michel ! dit la femme du sergent.En même temps elle battait le briquet.
Une gerbe d’étincelles brilla dans l’ombre.
— N’allume pas la lampe ! dit vivement le garde-côte ; tu nous ferais massacrer. Si les Anglais s’aperçoivent que nous veillons, ils entoureront la maison et nous égorgeront sans briller une amorce.
— Que faire ? dit la femme avec désespoir.
— Nous taire, écouter et observer.
— Le chien va nous trahir.
— Je me charge de museler M. Pitt.A ces mots, le sergent entre-bailla la porte et attira le dogue dans la maison ; puis il alla se mettre en observation derrière la haie de son jardin.
La mère était restée auprès du berceau. L’enfant dormait paisiblement et rêvait sans doute aux jeux qu’il allait reprendre à son réveil.

II ne se doutait pas du danger qui le menaçait. II songeait encore moins aux angoisses de celle qui veillait à ses côtés, prête à sacrifier sa vie pour le défendre. Cabieu ne revenait pas. Sa femme s’inquiéta ; les minutes lui paraissaient des siècles. Elle voulut avoir des nouvelles et sortit en refermant doucement la porte derrière elle.
A l’autre bout du jardin elle rencontra son mari.
— Eh bien ? lui dit-elle.
— Ils sont plus nombreux que je ne le pensais. Vois !La femme regarda entre les branches que son mari écartait.
— Ils s’éloignent ! dit-elle avec joie.
— Il n’y a pas là de quoi se réjouir, murmura Cabieu.
— Pourquoi donc ? Nous en voilà débarrassés.
— C’est un mauvais sentiment cela, Madeleine ! Il faut penser aux autres, et je suis loin d’être rassuré. Je devine maintenant l’intention des Anglais.Ils vont essayer de surprendre la garde des batteries d’Ouistreham. Heureusement qu’en route ils rencontreront une sentinelle avancée qui peut donner l’alarme. Si cet homme-là fait son devoir, nos artilleurs sont sauvés.
Cabieu se tut un instant pour écouter.
— Ventrebleu ! s’écria-t-il avec colère.
— Qu’y a-t-il ? demanda Madeleine.
— Quoi ! tu n’as pas entendu ?
— J’ai entendu comme un gémissement.
— Oui, et la chute d’un corps. Ils ont poignardé la sentinelle.Ce gredin-là dormait. Tant pis pour lui ! Je m’en soucie peu... Mais ce sont ces gueux d’habits rouges qui n’ont plus personne pour les arrêter...
Ils tueront les artilleurs endormis, ils encloueront les pièces !...
Comment faire ? comment faire ?... Ah !...
Cabieu cessa de se désespérer. Il avait trouvé une idée et, sans prendre le temps de la communiquer à sa femme, il s’élança vers la maison. Madeleine connaissait l’intrépidité de son mari.
Elle le savait capable de tenter les entreprises les plus désespérées.
Elle résolut de le retenir à la maison et traversa le jardin en courant. Elle trouva le sergent occupé à remplir ses poches de cartouches.
— Michel, dit-elle, en enlaçant ses bras autour du cou de son mari, tu n’as pas l’idée d’aller tout seul à la rencontre des Anglais ?
— Pardon.
— Mais, malheureux, tu t’exposes à une mort certaine.
— Probable.
— Tu n’as donc pas pitié de moi ?
— J’en aurais pitié si tu avais un mari assez lâche pour manquer à son devoir.
— Pourquoi tenter l’impossible ?Les Anglais arriveront avant toi.
— Je connais mieux le pays qu’eux ; et je compte bien prendre le chemin le plus court.
— Et si tu les rencontres en route ?
— J’ai mon fusil ; il avertira nos artilleurs.
— Tu te feras tuer, voilà tout ! Les Anglais se vengeront sur toi de leur échec... oh ! je n’aurais pas dû te réveiller !Madeleine se lamentait, suppliait.
Cabieu continuait ses préparatifs et répondait aux objections de sa femme par des plaisanteries dites avec fermeté, ou par des mots sérieux prononcés en souriant. En même temps il réfléchissait et combinait son plan.
Tout à coup il éclata de rire. Une idée étrange venait de surgir dans son esprit. Il entra dans un cabinet et reparut avec un tambour, qu’il jeta sur son épaule. « Si la farce réussit, dit-il en mettant sa carabine sous son bras, on n’aura jamais joué un si joli tour a nos amis les Anglais ! »
Il se pencha sur le berceau et embrassa l’enfant qui dormait. Quand il se releva, ses yeux étaient humides. Madeleine s’aperçut de son émotion. Elle essaya d’en profiter pour le faire renoncer à son projet.
— Michel, dit-elle en se plaçant entre la porte et son mari, tu n’auras pas le cœur de nous abandonner, moi et ton enfant ! Nous sommes sans défense !
— L’ennemi ne pense pas à vous.Vous n’avez rien a craindre.
— Si tu pars, Michel, je suis sûre que je ne te reverrai plus.J’en ai le pressentiment !
— N’essaie pas de m’attendrir, Madeleine. Je ne changerai pas de résolution. Allons ! dis-moi adieu.Nous avons déjà perdu trop de temps.
La jeune femme fondit en larmes et se jeta dans les bras de son mari.
— Reste ! lui dit-elle d’une voix brisée.
— Tu veux donc me déshonorer ? dit Cabieu avec sévérité.
— Non, tu ne seras pas déshonoré. On ne saura pas que je t’ai réveillé dans la nuit. On croira que tu dormais.On ne te fera pas de reproches.
— Et ma conscience ? dit le garde-côte.Allons ! Madeleine, embrasse-moi et laisse-moi partir.
II serra sa femme contre son cœur, la poussa doucement de côté et ouvrit la porte.
— Et ton fils ! s’écria Madeleine en cherchant à retenir son mari avec cette dernière prière.
II est si jeune.
Si tu ne reviens pas, il n’aura pas connu son père.
— Tu lui diras plus tard pourquoi je ne suis pas revenu ; et il apprendra à me connaître, s’il a du cœur.Adieu, Madeleine, adieu !
Et l’on n’entendit plus dans la nuit que les sanglots de la femme et le bruit des pas de Cabieu qui s’éloignait.
A quelque distance de sa maison, il sauta dans le creux d’un fossé qui séparait les dunes de la campagne.
Il espérait ainsi échapper aux regards de l’ennemi.
Après avoir couru quelques minutes, il arriva au bord d’un chemin qui conduisait à la mer. Tout à coup un homme se présenta devant lui. Le sergent épaula sa carabine et coucha en joue l’inconnu.
« Arrête ! lui cria-t-il, ou tu es mort ! »
L’homme s’arrêta au milieu de la route, et Cabieu marcha à sa rencontre.
— Il paraît, mon drôle, lui dit le garde-côte, que tu comprends bien le français ?
— Aussi bien que vous le parlez, répondit l’étranger sans le moindre accent ; et c’est pour cela que j’ai cru devoir vous obéir.J’ai deviné que j’avais affaire a un ami.
— Tu es donc un de mes compatriotes ?
— Mieux que cela, un de tes parents. Je t’ai reconnu à la voix.Si tu es moins habile ou plus défiant que moi, approche et regarde.
Je suis sans armes.
Le sergent examina l’homme de plus près.
— C’est toi, Baptiste ! s’écria-t-il avec joie.
— Oui, c’est moi, ton frère
— On m’avait assuré que l’ennemi t’avait fait prisonnier.— On ne t’avait pas trompé.
Avant-hier, dans une descente qu’ils ont faite sur la côte de Colleville, les Anglais ont enlevé quatre garde-côtes, ton serviteur et un autre soldat du régiment de Forez.
— Comment te trouves-tu ici ?
— Par cette. raison bien simple qu’il y a deux jours, j’étais fait prisonnier, et qu’aujourd’hui je suis libre.
— Ce n’est pas le moment de plaisanter.L’ennemi est à deux pas de nous.
— Je le sais. Écoute-moi, et fais ton profit de ce que je vais te dire. Ce soir, le capitaine de la frégate, où j’étais aux fers, m’a fait monter sur le pont. Plusieurs barques étaient déjà à la mer.On me promet la liberté si je consens à servir de guide aux troupes qu’on allait débarquer sur la côte.
— Tu as accepté ?
— - Parbleu ! Sans cela, aurais-je le plaisir de te parler à cette heure ?... On débarque.Je suis placé sous la garde de deux grands habits rouges.
Nous marchons sur Colleville.
J’étais à la tête de la compagnie, pour servir d’éclaireur. Mon premier soin est de conduire les Anglais sur le bord d’une mare bourbeuse. Un de mes gardiens y tombe consciencieusement, sans en être prié.
J’y pousse l’autre, et je me sauve à la faveur de la nuit, laissant le reste de la troupe en tête-à-tête avec les grenouilles du marécage. Ils n’ont pas osé me tirer des coups de fusil, dans la crainte de jeter l’alarme dans le pays...
Et me voilà !
— Où allais-tu ?
— Chez toi. Je voulais t’avertir de l’arrivée de l’ennemi.
— Et me conseiller de l’attaquer ?
— Sans doute.
— Touche-là, Baptiste ! dit le sergent avec émotion.Les deux frères se serrèrent la main.
— Tu es l’homme qu’il me fallait, ajouta Cabieu.
A nous deux, nous sommes de force à repousser les Anglais.
— Si on nous aide, dit le soldat du régiment de Forez.Où sont tes hommes ?
— Les voilà ! répondit le sergent en frappant successivement sur sa poitrine et sur celle de son frère.
— Quoi ! tu n’as pas rassemblé tes garde�côtes ?
— Ils sont au diable !
— Et tu venais ainsi, tout seul ?...Ah ! mon cher, tu es fou !
— Pas si fou que cela, puisque j’ai eu l’esprit de te rencontrer...Es-tu décidé te venger des Anglais ?
L’occasion est bonne.
— Hum ! Ils sont au moins un cent.
— Qu’importe ! si nous avons cent fois plus de courage qu’eux.
— Nous n’aurons pas autant de fusils.
— Tu hésites ? N’en parlons plus... J’entends du bruit sur la dune.Ils approchent.
Voici le moment de les arrêter.
Adieu !
— Michel, dit le soldat d’un air triste, tu pars sans moi ?Cabieu s’éloigna. Son frère courut après lui.Tu me méprises donc bien ?
— Je savais que tu me suivrais, répondit Cabieu en riant.Je n’ai pris les devants que pour t’empêcher de faire des phrases.
Tu as le malheur d’être bavard.
Ce soir, il faut se taire et agir.
— Bon ! Donne-moi une arme.
— Je n’ai que mon fusil.
— En ce cas, j’ai bien peur, si je ne laisse pas mes os sur la dune, de retourner sur l’escadre anglaise. Avec quoi veux-tu que je me batte ?Avec les poings ?
— Avec cela, dit Cabieu.Sans s’arrêter, il prit le tambour qu’il portait sur l’épaule et le suspendit au cou de son frère. Celui-ci reçut les baguettes en hochant la tête.
— J’espère bien, dit-il, que nous ne nous servirons pas de ce tambour ?
— Pardon.
— Autant vaudrait appeler l’ennemi et le prier tout de suite de nous entourer et de nous passer par les armes !
— Chut ! dit Cabieu d’une voix brève.On entendit, derrière la dune, un bruit d’armes et le cliquetis des galets qui roulaient sous les pieds.
« C’est ma troupe de Colleville, murmura le soldat.
Ils n’ont pas pu trouver le chemin de la batterie. Ils reviennent. »
A cet instant, une traînée de feu monta en serpentant dans le ciel.
« Ils tirent des fusées, dit Cabieu. on va bientôt leur répondre. »
En effet, sur leur droite, à trois cents pas environ, les deux frères aperçurent la lueur d’une autre fusée.
— C’est la troupe d’Ouistreham, dit le soldat.
— Oui, répondit Cabieu, celle-là continue les signaux, tandis que les autres cessent de lancer des fusées.Ils vont évidemment se rallier sur les bords de la rivière.
Ce hasard nous donne la victoire.
Cabieu se leva précipitamment. Il avait le visage radieux.
— Reste-là, dit-il à son frère.
— Je veux t’accompagner.
— Je t’ordonne de rester ici, reprit le sergent d’une voix impérieuse.Qui a conçu le plan ? Moi. Je suis donc ton chef.
Si tu ne m’obéis pas, si tu violes la consigne, tu es traître à ton pays !
— Tu as l’air de parler sérieusement, Michel ; et cependant je suis sûr que tu vas faire une folie.
— Si tu exécutes fidèlement mes ordres, dans une heure, les Anglais auront rejoint leur escadre.
— Que faut-il faire ?
— Rester ici.
— Bien.
— Et, lorsque tu auras entendu l’explosion de ma carabine, battre la générale à tour de bras et en courant dans la direction des Anglais...Puis-je compter sur toi, Baptiste ?
— Comme sur toi-même, Michel.Cabieu visita l’amorce de sa carabine et partit d’un pas rapide. Le soldat regarda avec tristesse son frère qui s’éloignait.
Il pensait qu’il ne le reverrait plus. Mais le sergent des garde-côtes avait plus de confiance que cela dans la réussite de son entreprise.
Il marchait sur l’ennemi avec la certitude de le mettre en fuite.
Il ne craignait pas d’être aperçu.
La nuit était si profonde qu’il entendait déjà les Anglais sans les voir.
Cabieu quitta la dune et se jeta dans la campagne.
Il voulait tourner les Anglais et revenir sur eux à l’improviste, en s’abritant derrière une haie de saules qui poussaient dans le voisinage de la rivière.
La connaissance qu’il avait du pays le servit autant que son audace. Le garde-côte s’accroupit derrière un buisson, à dix pas de l’ennemi.
Il coula le canon de sa carabine entre les feuilles, ajusta le groupe et resta en observation. Les Anglais parlaient entre eux avec animation.
Les uns tendaient la main du côté de la mer, comme s’ils eussent donné l’avis de se rembarquer au plus vite. Les autres se tournaient vers la batterie d’Ouistreham, comme s’ils eussent voulu exciter leurs camarades à ne pas laisser leur entreprise inachevée.
On devinait à leurs gestes, à leur air indécis, qu’il y avait dans leur conseil deux courants d’idées contraires.
La compagnie qui avait marché sur le village de Colleville se croyait trahie et craignait une surprise ; les autres paraissaient décidés à tenter tous les hasards.
Cabieu retenait sa respiration, voyait et écoutait tout.
Quand il fut convaincu que le parti des audacieux l’emportait, il coucha en joue l’officier qui s’était mis à la tête du détachement.
En même temps, il s’écria d’une voix formidable : « Qui vive ? » A ce mot, un grand trouble se fit dans les rangs des Anglais. Ils se pressèrent les uns contre les autres, formèrent le carré et regardèrent avec inquiétude dans les ténèbres. « Voilà le moment de jouer ma comédie, se dit Cabieu. »
Il tourna la tête en arrière, comme s’il eût adressé un commandement à une troupe de soldats. « Nom d’un tonnerre !
s’écria-t-il, ne tirez pas ! ne tirez pas ! Je vous le défends ! »
Les Anglais dressaient l’oreille et cherchaient dans l’ombre à apercevoir leur ennemi. Cabieu fit résonner la batterie de son fusil.
« Sacrebleu ! fit-il d’un ton furieux, n’armez pas, caporal ;
j’ai défendu de tirer. »
Et, changeant de voix :
— Capitaine, reprit-il, il faut en finir avec ces gueux d’habits rouges.
Si nous faisons feu, il n’en échappera pas un.
— Silence ! répondit Cabieu. Obéissez à la consigne.
— Capitaine, continua-t-il sur un autre ton, mes hommes sont impatients.Ils ne veulent plus rester au port d’armes.
— Gredin ! s’écria Cabieu, ce sont les mauvais chefs qui font les mauvais soldats.Et, comme s’il eût parlé au reste de sa troupe imaginaire : « Qu’on emmène cet homme ! dit-il avec colère. Il n’est pas digne de se mesurer avec l’ennemi.
Qu’on le conduise en prison. » Il se leva, marcha avec bruit et frappa plusieurs fois la terre de la crosse de son fusil, comme pour faire croire à une lutte.
Tout en jouant cette scène, Cabieu ne perdait pas de vue les Anglais. Ceux-ci paraissaient consternés.
« Eh bien ! s’écria de nouveau le rusé sergent, il me semble qu’on a murmuré dans les rangs ! Auriez—vous la sottise de regretter le départ de cet homme ?
Sachez-le : ce n’est pas le nombre qui fait la force d’une armée, c’est la discipline.
D’ailleurs n’êtes-vous pas assez nombreux pour mettre en fuite trois fois plus d’ennemis qu`’il n’y en a là à combattre ?...
Allons ! arme bras !...
Que personne ne tire avant le commandement.
Les garde-côtes d’Ouistreham et de Colleville sont avertis.
Ils vont venir. Attendons-les. Nous prendrons l’ennemi entre deux feux.
Pas un Anglais ne remettra le pied sur l’escadre ! »
En disant cela, il ajusta l’officier qui avait fait quelques pas dans la direction de la haie. Il lâcha la détente ; le buisson s’enflamma et, quand la fumée se fut dissipée, Cabieu aperçut sa victime qui se débattait sur le sable de la dune.
Les Anglais firent un feu de peloton sur la ligne des saules.
Les balles sifflèrent aux oreilles de Cabieu et cassèrent des branches autour de lui. « Canailles ! s’écria Cabieu d’une voix furieuse, comme s’il eût parlé à ses hommes, ne vous avais-je pas défendu de tirer ?
Heureusement que rien n’est perdu.
Nous n’avons personne de tué, et voici les garde-côtes qui arrivent.
En effet, au loin, on entendit le son d’un tambour qui battait la générale.
Le bruit se rapprochait ; il était formidable.
On aurait dit un régiment qui s’avance au pas de course.
« Voilà les nôtres ! cria Cabieu. Ne tirez pas encore. A la baïonnette ! mes amis, à la baïonnette ! » II avait rechargé sa carabine et il tira un second coup de feu dans la masse des Anglais. « A la baïonnette ! » reprit-il d’une voix courroucée.
A ces mots il agita les touffes de saules ; puis il traversa bravement la haie et s’élança à la rencontre des Anglais.
« Sauve qui peut ! » s’écria l’ennemi qui se croyait attaqué par des forces supérieures.
De tous les côtés à la fois les Anglais gagnèrent le haut de la dune, se précipitèrent sur le rivage et se jetèrent dans les barques.
Cabieu eut encore le temps de leur envoyer deux coups de fusil, avant qu’ils eussent pris la mer.
Son frère le rejoignit sur les bancs de sable ; il battait toujours du tambour.
— Tu peux te reposer, lui dit Cabieu en riant, ils sont partis. La farce a réussi.
— Tiens, Michel, dit le soldat du régiment de Forez en sautant au cou de son frère, s’il y avait en France dix généraux comme toi, M. Pitt n’oserait plus nous faire la guerre.A cet instant, les deux frères entendirent des gémissements derrière eux. Ils remontèrent sur la dune, et, après avoir cherché quelque temps au hasard dans les ténèbres, ils trouvèrent un homme qui se débattait sur le sable. Ils se penchèrent sur le blessé et ils constatèrent qu’il avait une cuisse cassée et l’autre percée par une balle.
Ils le soulevèrent et le transportèrent dans la maison du garde-côte.
Les Anglais sont partis, dit Cabieu.
En embrassant sa femme.
Nous amenons un prisonnier qu’il faut soigner comme si c’était l’un des nôtres.
Ils le soignèrent si bien qu’au bout de deux jours le blessé recouvra sa connaissance.
Il se nomma.
C’était un bas officier qui commandait un des détachements, et qui, selon toute apparence, était fort estimé ; car le commandant de l’escadre le fit demander en offrant de renvoyer les quatre garde-côtes et le deuxième soldat du régiment de Forez que les Anglais avaient faits prisonniers. La proposition fut acceptée, et l’échange eut lieu.
Quelques jours après, l’escadre anglaise mit la voile, et les côtes de la basse Normandie ne furent plus inquiétées jusqu’à la signature du traité de Paris, le 10 février 1763.
L’esprit et le courage de Cabieu avaient sauvé le pays.
Le ministre lui accorda une gratification de deux cents livres et lui écrivit une lettre de satisfaction pour sa manœuvre.
Ce fut tout. Mais l’opinion publique fut plus généreuse que le Trésor royal.
L’exploit de l’humble garde-côte eut un grand retentissement dans la Normandie, et le peuple ne le désigna plus que sous le nom de général Cabieu.
« Il aurait vécu heureux de ce souvenir, dit Boisard dans ses notices biographiques sur les hommes du Calvados, si un incendie ne fût venu augmenter sa détresse et celle de sa famille.
« La pitié qu’il inspira réveilla le souvenir du service qu’on avait oublié.
A la sollicitation du duc d’Harcourt, le ministre de la guerre lui accorda une gratification annuelle de 100 francs.
Mais la reconnaissance nationale lui réservait d’autres dédommagements.
Il les obtint aussitôt qu’elle put se manifester sans recourir au patronage des grands.
Le grade de général fut solennellement conféré à Cabieu dans les premières années de la Révolution, et nous l’avons vu en porter les insignes.
L’État lui accorda en outre une pension de 600 francs. »
Michel Cabieu mourut à Ouistreham, le 5 novembre 1804.
Ce petit coin de terre, qui n’est sur la carte qu’un point insignifiant, vit naître et mourir obscurément un de ces héros auxquels la Grèce élevait des statues.
Carte postale de OUISTREHAM en 1900

 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Dona Rodrigue le 7 Décembre 2014 à 11:50

Monsieur le Pésident
Vous organisez depuis plusieurs années autour du 14 juillet et de la prise de la Bastille.
Mis à part le ridicule que représente le choix de cette date comme fête nationale et de ce symbole, l'ouverture des portes d'une prison quasi vide,
(sept prisonniers: quatre faussaires, dont le procès était en cours d'instruction ; deux fous, Auguste Tavernier et de White ; un noble, criminel, enfermé à la demande de sa famille, le comte de Solages)
à tel point que les "révolutionnaires" d'aujourd'hui disent qu'il s'agit là de l'anniversaire de la Fête de la Fédération
(14 juillet 1790 ! elle-même anniversaire de quoi?)
je voudrais vous faire part de l'aspect monstrueux de ce que j'ai entendu sur les antennes du service public, France-Info en l'occurrence: ce que les organisateurs de la fête et probablement les instituteurs font mettre dans la bouche d'un enfant de 4 ans (je dis bien de 4 ANS!) coiffé du bonnet phrygien: à la question :
Que fais-tu ? Le bambin répond:
moi, je vais tuer le Roi !
Je ne doute pas, Monsieur le Président, que vous aurez le courage de publier dans le bulletin NATIONALle document ci-joint:
"Le bilan de la révolution et de l'empire" et d'apprendre à votre bambin, vous qui êtes sans doute un farouche défenseur de la démocratie élective, qu'en 1789, il aurait été absolument minoritaire (et donc il aurait eu tort comme le disait Laignel !) puisque les Français étaient royalistes à 98%.
J'ai bien l'honneur, Monsieur le Président, de vous souhaiter bonne réception de ce courrier.
* * *

Français, voyez ce que vous fêtez en ce 14 juillet :
BILAN
«Les Français se sont montrés les plus habiles (révolutionnaires)
artisans de ruine qui aient jamais existé au monde.Ils ont entièrement renversé leur commerce et leurs
manufactures. Ils ont fait nos affaires, à nous leurs rivaux,mieux que vingt batailles n’auraient pu le faire »
E. Burke
Ce que l'on vous cache...
Facture Humaine
- 2 millions de morts entre la révolution et l'empire
- La démographie française s'écroule
- La catastrophe équivaut aux 2 guerres mondiales alors que la France n'a que 27 millions d'habitants...
- La France n'était plus envahie sur son territoire depuis Louis XIV ; et Louis XV
rajouta la Lorraine et la Corse en ne perdant que quelques centaines d'hommes...
-Les conflits de la « guerre en dentelle » comportaient des règles
d'humanité.Ces guerres étaient le fait d'armées de métier, de professionnels. La révolution créa la conscription et la guerre totale où femmes et enfants seront
directement impliqués... «Promotion démocratique de l'holocauste »
- Invasions dès 1792, 1814, 1815...Guerres civiles, massacres, guillotine pour les suspects, port obligatoire de la cocarde, carnages et populicide en Vendée, fours et tanneries de peaux humaines...
L'Assemblée Nationale révolutionnaire avait pourtant pris l'engagement solennel de n'attaquer la liberté d'aucun peuple et de n'entreprendre aucune conquête.
Au lieu de cela, la révolution fit entrer la France dans 23 ans de guerres
(excepté le bref intermède de la Paix d'Amiens et la 1ère Restauration)
La France restée royaliste ne veut pas de la « levée en masse » ;
le pays flamand renâcle (Les paysans du Nord pendant la Révolution de Georges Lefèvre)
- Vers Cambrai : « A Morbecque, les femmes s'attroupent, puis les hommes arrivent, armés de bâtons ferrés et de fléaux, criant : vivent les aristocrates, au diable les patriotes ! ».
Même chose à Steenbecque, Meteren, Meris,Blaringhem, Boenghem, Sercus et dans tout le canton de Steenvoorde.
« A Hazebrouck même, une bande de 400 à 500 paysans attaquent le corps de garde... »
La révolution est obligée de payer cher pour avoir des volontaires ou de donner des biens nationaux...
La révolution et l'empire « nettoieront » la France de sa jeunesse et quand il n'y en aura plus, l'Empire mobilisera ce qu'elle appellera les « Marie-Louise », les tout jeunes conscrits, presque sans instruction militaire qui seront décimés (quasi exterminés) à la boucherie de Leipzig.
« Un homme comme moi aurait dit Napoléon à Metternich, ne regarde pas à un million de morts. »
La période révolutionnaire coûta environ 400.000 morts.
Napoléon rajouta
6.000 morts à Marengo,8.000 à Austerlitz,
10.000 à Eylau,
15.000 à Essling,
30.000 à Wagram, 300.000 avec l'Espagne et la guerre civile, 10.000 à la Moskova,la Bérézina 7.000 sans les disparus.
Sur les 650.000 hommes passant en Russie,100.000 reviendront, 100.000 seront prisonniers et
300.000 périront sous la mitraille, la misère ou le froid...
En 1813, ce seront encore 250.000 hommes,
Dresde 9.000,
Leipzig 60.000 et enfin
Waterloo avec environ 26.000.
La désertion
On se mutile ou on se révolte.En 1811, on compte 60.000 hommes cachés dans les bois.
En 1812, les mutineries s'organisent dans plusieurs villes de France.
Les étrangers mobilisés s'enfuient, Suisses, Croates, les Portugais puis les Polonais ; 50.000 désertions pendant la campagne de Russie.
Au total, de 1789 à 1815, nous avons 1.400.000 victimes, 400.000 pour la révolution, 1 million pour l'empire auxquels il faut rajouter les morts de la Terreur et de la Vendée.Les émigrés ne sont pas forcement les nobles, car paysans, bourgeois, prêtres fuient et seront 10.000 en Angleterre et 6.000 en Espagne, les aristocrates à Turin ou à Coblence où ils prennent les petits métiers pour survivre.
Combien sont partis ? environ 200.000 personnes...
La Révolution, une véritable purge.
LA Septembre 1792, la Révolution décide d'égorger les suspects :
- 150 à 200 à l'Abbaye
- 300 à la Conciergerie
- 180 à la Force
- 215 au Châtelet
- 115 aux Carmes
- 200 à Bicêtre dont 33 enfants...
- 72 aux Bernardins
- 75 à St Firmin
...1.300 morts pour Paris en 4 jours
Les exécutions par guillotine postérieures à Thermidor : 2.639 personnes.
Et la province
A Toulon, Fréron se vante de faire tomber 200 têtes par jour, sans conception d'âge ni de sexe.
A Marseille, Barras ne se fait pas prier pour exécuter...
Dans le Vaucluse, les villages flambent devant les colonnes républicaines de Maignet.A Quiberon, en juin 1795, 950 prisonniers à qui on avait promis la vie sauve ; Hoche les fusillera au Champ des Martyrs.
A Orange, 332 exécutions ;
à Lyon, Collot d'Herbois exécute 1.684 personnes dont 60 jeunes gens dans la plaine des Brotteaux (dans d'ignobles conditions...).
à Bordeaux, c'est Tallien, à Cambrai c'est Lebon et ses «fricassées de têtes ».
A Arras on massacre sous l'air du « Ça ira»
Les estimations diront 35.000 victimes...28% de paysans,
31% d'artisans et ouvriers,
20% de marchands,
8 à 9% de nobles et
6 à 7% pour le clergé.
«Il n'y a plus de Vendée ! Elle est morte sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais de Savenay.J’ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, massacré les femmes qui n'enfanteront plus de brigands.
Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher.
J’ai tout exterminé...Les routes sont semées de cadavres.Il y en a tant que sur plusieurs points ils font des pyramides»
(Westermann)
La Vendée comme de multiples endroits en France, s'est révoltée contre la conscription, le « ras le bol » des persécutions religieuses et pour défendre le roi.
Déjà à l'époque, on essaie de prendre soin de la publicité.
Lors de la libération des 5.000 prisonniers républicains par les royalistes, la consigne est stricte ;écoutons Merlin de Thionville :
«Il faut ensevelir dans l'oubli cette malheureuse action. N’en parlez même pas à la Convention. Les brigands n'ont pas le temps d 'écrire ni de faire des journaux. Cela s'oubliera...»
« Nous fusillons tout ce qui tombe sous notre main » dit l'adjudant général Rouyer
« Je continue de brûler et de tuer tous ceux qui ont porté les armes... »(Turreau)
« J'ai brûlé et cassé la tête à l'ordinaire »(Nevy)
« L'armée de Brest à tué 3.000 femmes »(représentant Garnier)
« Pères, mères, enfants, tout à été détruit. »(commandant Perignaud)
«J'ai égorgé tous les habitants ! »(Duquesnoy)
« à coup de baïonnettes 600 des 2 sexes »
(Cordelier)
La technique d'Oradour est multipliée à l'excès.
Au Mans, décembre 93, on fusille, on écrase les enfants, on viole les femmes.On introduit des cartouches dans les corps auxquels on met le feu.
On embroche les femmes encore vivantes avec des fourches.
Le lendemain on fait des battues...
A Nantes, on fusille mais pour Carrier, il faut mieux.On coule un navire avec 20 prêtres.
On prend des bateaux à fonds plat et on crée les déportations verticales. Chaque jour 100 à 200 personnes seront noyées. On attache des couples, parfois dans des positions obscènes et on pratique ce que l'on appel les «mariages républicains» dans la Loire devenue pour l'occasion la
« baignoire nationale ».C'est environ 4 à 5.000 personnes qui périront ainsi, noyés, hommes, femmes et enfants.
De même à Angers, on jette dans la Loire, en 3 jours, 800 personnes au Pont de Cé.
A Quiberon, en juin 1795, 950 prisonniers à qui on avait promis la vie sauve ; Hoche les fusillera au Champ des Martyrs.
Carrier dit :
«Nous ferons de la France un cimetière plutôt que de ne pas la régénérer
à notre façon.» Cette guerre civile est difficile à évaluer car dans toute la France la révolte a tonné. Des déportations du Pays Basque à Lyon en passant par Marseille, des révoltes du Sud Ouest à la Normandie, en passant par la Bretagne et la
Vendée, sans oublier d'autres régions comme le Nord et la Corse. Il faut compter au bas mot 400.000 morts...
L'addition est faite, triste et macabre :
La Révolution a coûté :
400.000 morts pour les guerres jusqu’en 1800
1.000.000 pour Napoléon
600.000 pour les guerres intestines
soit 2.000.000 morts
Nous laissons le mot de la fin à Napoléon, le soir d'Eylau :
« Une nuit de Paris réparera ce carnage »
(Faudrait-il parler des tanneries de peaux humaines et les fours où les révolutionnaires brûlaient les Vendéens vivants...Voir les travaux de Reynald Sécher, les mémoires de G. Babeuf...)
Après ça vous pouvez continuer à trouver bien la révolution française et être heureux qu'elle serve d'exemple aux autres pays, mais vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas ce qu'a été vraiment la révolution française.Certaines personnes penseront cyniquement que c'était le prix à payer pour que la France devienne une démocratie, je leur répondrai que l'Angleterre en est également une et qu'elle n'a pas eu à faire 2 millions de morts pour en arriver la !
J'en profite pour rendre hommage aux 98 soldats français morts pour rien en Afghanistan et à nos MILITAIRES qui sont tombés au MALI... au nom du MONDIALISME !
Je vous laisse méditer....http://urbvm.com/histoire-de-nos-regions/genocide-vendeen/
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Dona Rodrigue le 19 Novembre 2014 à 14:13
Georges Jacques Danton Portrait de Danton par Constance-Marie Charpentier, Musée CarnavaletNaissance 26 octobre 1759  Arcis-sur-Aube
Arcis-sur-AubeDécès 5 avril 1794 (à 34 ans)  Paris
ParisNationalité  France
FrancePays de résidence France Diplôme Licence de droit Profession Avocat Activité principale Homme politique Conjoint Gabrielle Charpentier
Louise GélySignature
Georges Jacques Danton, né le 26 octobre 1759 à Arcis-sur-Aube et mort guillotiné le 5 avril 1794 (16 germinal an II) à Paris, est un avocat et un homme politique français.
Danton est une des figures emblématiques de la Révolution française tout comme Mirabeau avec qui il partage un prodigieux talent oratoire et un tempérament impétueux, avide de jouissances (les ennemis de la Révolution l'appellent le Mirabeau du ruisseau), ou comme Robespierre, à qui tout l’oppose, le style, le tempérament et le type de talent. Il incarne la « Patrie en danger » dans les heures tragiques de l’invasion d’août 1792 quand il s'efforce de fédérer contre l'ennemi toutes les énergies de la nation : pour vaincre, dit-il, « il nous faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace et la France sera sauvée ! ».
Comme Robespierre, il s’est vite constitué autour de sa personne une légende. Et s’est déchaînée entre historiens robespierristes et dantonistes une polémique idéologique et politique qui a culminé sous la IIIe République. Pour les premiers, Danton est un politicien sans scrupules, vénal, capable de trahir la Révolution ; pour les seconds, il est un ardent démocrate, un patriote indéfectible, un homme d’État généreux.
Sommaire
- 1 Biographie
- 1.1 Période précédant la Révolution
- 1.2 La Révolution
- 2 Historiographie
- 3 Citations
- 4 Sources
- 5 Bibliographie
- 6 Notes et références
- 7 Représentations
- 8 Voir aussi
Biographie
Période précédant la Révolution
Georges Jacques Danton est né à Arcis-sur-Aube, dans la province de Champagne, le 26 octobre 1759 de Jacques Danton (mort le 24 février 1762 à l'âge de 40 ans), procureur du lieu et de sa seconde épouse, Marie-Madeleine Camut (morte le 12 octobre 1813), fille d'un charpentier. Marié en 1754, le couple a quatre enfants. Jacques Danton vient de Plancy, gros village situé à quatre lieues d’Arcis, où son père cultive encore la terre en 1760.
Il a un an lorsqu’un taureau, se jetant sur une vache qui l’allaite, le blesse d’un coup de corne, lui laissant une difformité à la lèvre supérieure gauche. Plus tard, comme il est doué d'une grande force, il veut se mesurer à un taureau qui lui écrase le nez d’un coup de sabot. Enfin, il contracte dans sa jeunesse la petite vérole, dont il conserve des traces sur le visage[1].
Son père étant mort et sa mère remariée le 24 juillet 1770 à un marchand de grain, Jean Recordain, il est mis au petit séminaire de Troyes, puis au collège des Oratoriens, plus libéral, où il reste jusqu'à la classe de rhétorique.
En 1780, il part pour Paris où il se fait engager comme clerc chez un procureur (équivalent de l'époque de l' avoué), Me Vinot, qui l'emploie de 1780 à 1787. En 1784, il se rend à la faculté de droit de Reims pour obtenir une licence, puis regagne Paris comme avocat stagiaire.
Au café du Parnasse qu’il fréquente, « un des établissements de limonadier les plus considérés de Paris », presque en face du Palais, au coin de la place de l’École et du quai, il rencontre sa future femme, Antoinette-Gabrielle Charpentier, fille du propriétaire, « jeune, jolie et de manières douces » (son portrait peint par David est au musée de Troyes). Avec la dot de 20 000 livres qu’elle lui apporte et des prêts cautionnés par sa famille d’Arcis, il peut acheter en 1787 la charge d'avocat de Me Huet de Paisy pour la somme de 78 000 livres.
Il se marie la même année à Saint-Germain-l’Auxerrois et s’installe cour du Commerce. L’État actuel de Paris de 1788 indique au no 1 de cette cour : Cabinet de M. d'Anton[2], avocat ès conseils .
La Révolution
Avocat modeste et inconnu à la veille de la Révolution, Danton va faire ses classes révolutionnaires à la tête des assemblées de son quartier et en particulier du club des Cordeliers, dont il devient un orateur réputé. C’est la chute de la monarchie (journée du 10 août 1792) qui le hisse à des responsabilités gouvernementales et en fait un des chefs de la Révolution.
Un agitateur de quartier (1789-10 août 1792)
 A l’emplacement de la maison de Danton, emportée par le percement du boulevard Saint-Germain en 1877, la Ville de Paris a érigé en 1891, en hommage à « l’âme de la défense nationale », une statue, œuvre du sculpteur Auguste Paris, qui représente le tribun debout, entouré de deux volontaires, en train de haranguer la foule.
A l’emplacement de la maison de Danton, emportée par le percement du boulevard Saint-Germain en 1877, la Ville de Paris a érigé en 1891, en hommage à « l’âme de la défense nationale », une statue, œuvre du sculpteur Auguste Paris, qui représente le tribun debout, entouré de deux volontaires, en train de haranguer la foule.
En 1789, Danton habite le district des Cordeliers (devenu en mai 1790 la section du Théâtre-Français) dans le quartier du Luxembourg[3], quartier de libraires, de journalistes et d’imprimeurs. Il demeure au no 1 de la cour du Commerce-Saint-André, passage bordé de boutiques reliant la rue Saint-André-des-Arts à la rue de l'École-de-Médecine, qui connait son heure de gloire sous la Révolution : Marat y a son imprimerie au no 8, Camille Desmoulins y séjourne, la guillotine est expérimentée sur des moutons en 1790 dans la cour du no 9[4].
Appartenant à la moyenne bourgeoisie, titulaire d’un office, il participe aux élections du tiers état aux États Généraux de 1789 ( 412 votants dans le district des Cordeliers; 11 706 pour Paris qui compte environ 650 000 habitants et doit élire 40 députés[5]) et s'enrôle dans la garde bourgeoise de son district.
Il acquiert sa renommée dans les assemblées de son quartier : assemblée de district dont il est élu et réélu président, puis assemblée de section qu’il domine comme il domine le club des Cordeliers, crée en avril 1790 dans l’ancien couvent des Cordeliers avant de s’inscrire au club des Jacobins.
Car Danton, comme Mirabeau, est une « gueule », un personnage théâtral, figure « repoussante et atroce, avec un air de grande jovialité » selon Mme Roland qui le hait. Orateur d’instinct, ses harangues improvisées (il n'écrit jamais ses discours) enflamment ses auditeurs. Les contemporains disent que ses formes athlétiques effrayaient, que sa figure devenait féroce à la tribune. La voix aussi était terrible. "Cette voix de Stentor, dit Levasseur, retentissait au milieu de l'Assemblée, comme le canon d'alarme qui appelle les soldats sur la brèche." Un autre témoin oculaire, Thibaudeau, le décrit aux Cordeliers :
« Je fus frappé de sa haute stature, de ses formes athlétiques, de l’irrégularité de ses traits labourés de petite vérole, de sa parole âpre, brusque, retentissante, de son geste dramatique, de la mobilité de sa physionomie, de son regard assuré et pénétrant, de l’énergie et de l’audace dont son attitude et tous ses mouvements étaient empreints… Il présidait la séance avec la décision, la prestesse et l’autorité d’un homme qui sent sa puissance[6]. »
L’historien Georges Lefebvre en trace le portrait suivant :
« Il était nonchalant et paresseux ; c’était un colosse débordant de vie, mais dont le souci profond et spontané était de jouir de l’existence, sans se mettre en peine de lui assigner une fin idéologique ou morale, en se tenant le plus près possible de la nature, sans souci du lendemain surtout. On le comprend encore mieux quand on le voit fier de sa force, de l’abus qu’il en faisait et de ses prouesses amoureuses ; si solide qu’il fût, il avait des moments de dépression qui aggravaient sa paresse, et dégénéraient en atonie. Et enfin, il me parait vraiment qu’il fut « magnanime » comme le dit Royer-Collard. S’il ignorait les scrupules, il ne connaissait pas non plus la haine, la rancune, la soif de vengeance qui ont tant contribué à déformer la Terreur et à l’ensanglanter.
(…) Avec son goût très vif, mais sain, pour les plaisirs de la vie, le cœur sur la main, et la dépense facile, insouciant et indulgent, d’une verve intarissable et primesautière, qui n’épargnait pas les propos salés, Danton plaisait naturellement à beaucoup de gens. (…) Aimant l’existence, il était optimiste ; débordant de sève, il respirait ordinairement l’énergie ; ainsi devait-il s’imposer aisément comme un chef : c’était un entraineur d’hommes[7]. »On sait aujourd'hui sans contestation possible[8] que Danton a touché de l’argent de la Cour selon le plan de corruption, proposé à Louis XVI par Mirabeau, qui visait notamment les journalistes et les orateurs de club. On sait qu’avec cet argent il a remboursé les emprunts faits pour acquérir son office d’avocat et acheté des biens nationaux à Arcis-sur-Aube. Mais on ne sait rien de précis sur les services qu’il a pu rendre à ceux qui le payaient. « Ils sont imperceptibles » dit Mona Ozouf[9]. « Sur ce que la Cour obtint de lui, nous ne savons rien » écrit Georges Lefebvre[10].
Sa renommée grandit vite. Le district qu’il préside s’illustre aussi dans la lutte contre Bailly, le maire de Paris et contre La Fayette. Il s’insurge en janvier 90 pour soustraire Marat aux poursuites judiciaires. Si Danton ne participe pas directement aux grandes « journées » révolutionnaires – 14 juillet, 6 octobre, 20 juin, 10 août – il les arrange, les prépare. Le 13 juillet, il harangue les troupes cordelières. Début octobre, il rédige l’affiche des Cordeliers qui appelle les Parisiens aux armes. Le 16 juillet 1791 dans l’après-midi, la veille de la fusillade du Champ-de-Mars, il va lire la pétition des Jacobins au Champ-de-Mars sur l’autel de la patrie. Mais le 17, il est absent lorsque la garde nationale commandée par La Fayette tire sur les pétitionnaires, faisant une cinquantaine de victimes. Une série de mesures répressives contre les chefs des sociétés populaires suit cette journée dramatique, l’obligeant à se réfugier à Arcis-sur-Aube, puis en Angleterre.
Après l'amnistie votée à l'Assemblée le 13 septembre, il revient à Paris. Il tente de se faire élire à l'Assemblée législative mais l'opposition des modérés à l'assemblée électorale de Paris l'en empêche. En décembre 1791, lors du renouvellement partiel de la municipalité, marqué par une forte abstention (la défaite de La Fayette à la mairie au poste de Bailly démissionnaire marque le déclin du parti « constitutionnel » qui a jusque-là dominé l'Hôtel de Ville), il est élu second substitut adjoint du procureur de la Commune Manuel. Dans le débat sur la guerre au club des jacobins commencé au début de décembre 1791, il penche plutôt du côté de Robespierre que de Brissot sans adopter une position antibelliciste aussi vigoureuse que celles de son ami[11]. Mais le 30 décembre 1791 les deux hommes firent font commun avec succès contre une tentative déguisée de Brissot de musellement de l’opinion antibelliciste» au club des jacobins, selon les critères invoqués par le député de la Gironde dans son discours du jour(«soumission aux lois» et "respect de la constitution")[12]. On peut difficilement croire Legendre quand sans doute pour sauver sa tête en mars 1794 il rapporte à Robespierre cette phrase que Danton aurait prononcé dans ce long débat : "s'il (Robespierre) veut se perdre, qu'il se perde tout seul."
Car, élu président du club le 27 avril 1792 le 10 mai, en réaction à des insultes des Brissotins à l'encontre d'un présumé « despotisme d’opinion »,de Robespierre, Danton proteste :
"M. Robespierre n'a jamais exercé ici que le despotisme de la raison[13]".
A la veille de la chute de la monarchie (journée du 10 août 1792), Danton est un des hommes en vue du clubisme parisien (Cordeliers, Jacobins).
Premier passage au gouvernement (août – septembre 1792) - Ministre de la Justice
 Le nouveau conseil général de la Commune (288 membres) se réunit en permanence comme une assemblée nationale. Un homme se détache : Robespierre.
Le nouveau conseil général de la Commune (288 membres) se réunit en permanence comme une assemblée nationale. Un homme se détache : Robespierre.
 Le comité de surveillance de la Commune est chargé de la police politique et de la coordination des comités de surveillance des sections. Dix membres y siègent, dont Marat.
Le comité de surveillance de la Commune est chargé de la police politique et de la coordination des comités de surveillance des sections. Dix membres y siègent, dont Marat.
Danton est un des grands bénéficiaires de cette journée à laquelle il n’a pas participé personnellement. Il s’est targué au Tribunal révolutionnaire d’avoir « fait » le 10 août mais on ne sait rien de précis sur son rôle, les témoignages étant rares et contestés.
Face à la Commune insurrectionnelle qui s’appuie sur les sections insurgées et qui tient Paris, l’Assemblée législative n’a d’autres choix que de suspendre Louis XVI et de lui substituer un Conseil exécutif provisoire de six membres composé des anciens ministres girondins (Roland à l’Intérieur, Servan à la Guerre, Clavière aux Finances) avec Monge à la Marine et Lebrun aux Affaires étrangères. Les Girondins, hostiles au Paris révolutionnaire, ont besoin d’un homme populaire et engagé avec les insurgés pour faire la liaison avec la Commune insurrectionnelle. Ils font nommer Danton au ministère de la Justice.
Condorcet, qui bien qu’adversaire malheureux de Danton aux élections de substitut et dans le débat sur la guerre, soutient sa candidature, explique son vote :
« Il fallait dans le ministère un homme qui eût la confiance de ce peuple dont les agitations venaient de renverser le trône (…) qui par son ascendant pût contenir les instruments très méprisables d’une révolution utile, glorieuse et nécessaire (…) qui par son talent pour la parole, par son esprit, par son caractère, n’avilît point le ministère. Danton seul avait ces qualités[14]. »
Et Condorcet ajoute cette considération significative :
« D’ailleurs Danton a cette qualité si précieuse que n’ont jamais les hommes ordinaires : il ne hait ou ne craint ni les lumières, ni les talents, ni la vertu. »
Danton s’installe place Vendôme, devenue place des Piques, et fait aussitôt entrer ses amis au ministère : Desmoulins est nommé secrétaire du Sceau, Fabre d'Églantine secrétaire général de la Justice (jusqu'alors un seul fonctionnaire occupait les deux postes), Robert chef des secrétaires particuliers.
Dans un climat de violence et de peur où s’opposent des autorités rivales, il va devenir, par sa personnalité et son autorité naturelle, le vrai chef du Conseil exécutif.
La Commune insurrectionnelle force l’Assemblée à faire emprisonner Louis XVI au Temple, à convoquer une Convention nationale élue au suffrage universel chargée d’élaborer une Constitution et met en place le dispositif de ce que l’on a appelé « la première Terreur » qui préfigure celle de 1793 : suppression des journaux d’opposition, perquisitions, visites domiciliaires, arrestations de prêtres réfractaires, des notables aristocrates, des anciens ministres feuillants, premier Tribunal révolutionnaire (qui ne fera guillotiner que trois « conspirateurs »). « Là où commence l’action des agents de la nation doit cesser la vengeance populaire » dit Danton.
Paris vit à l’heure des préparatifs militaires, de la patrie en danger, des volontaires. Le 21 août, on apprend la première insurrection vendéenne. À la fin du mois, les frontières sont franchies. Le duc de Brunswick avec une armée de 80 000 austro-prussiens s’avance vers Paris. Les soldats de la Révolution reculent.
Le 28 août, Roland, soutenu par Servan et Clavière, propose d’abandonner Paris et de se retirer au-delà de la Loire avec l’Assemblée et le roi. Seul des ministres Danton s’y oppose avec tant d’indignation et de menaces que les autres y renoncent. Le même jour, devant l’Assemblée, il félicite la Commune pour les mesures déjà prises, puis fait décider l’envoi dans les départements de commissaires (c’est lui qui les choisira, presque tous parmi les membres de la Commune) qui procéderont aux levées de volontaires (30 000 hommes à Paris et dans les départements voisins) et à la réquisition des denrées nécessaires au ravitaillement des armées. Il fait enfin autoriser les visites domiciliaires de suspects, décidées par la Commune.
Le 2 septembre, Paris apprend que duc de Brunswick a occupé Verdun, que ses troupes sont à deux jours de la capitale. Danton, en costume rouge, monte à la tribune de l’Assemblée et prononce son célèbre discours, salué par une ovation assourdissante :
« Il est bien satisfaisant, messieurs, pour les ministres d’un peuple libre, d’avoir à lui annoncer que la patrie va être sauvée. Tout s’émeut, tout s’ébranle, tout brûle de combattre ! (…) Le tocsin qu’on va sonner n’est point un signal d’alarme, c’est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, il nous faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace, et la France sera sauvée ! »
Grâce à lui, grâce aux décrets qu’il fait voter à l’Assemblée, une impulsion nouvelle sera donnée à la poursuite de la guerre. L’armée sent que le gouvernement, désormais, est résolu à lutter. Jusqu’à Valmy, c’est lui qui va incarner le mieux cette volonté de vaincre et cette passion de l’union révolutionnaire, mieux que la Commune et les Girondins, obsédés par leur haine réciproque.
A Paris, du 2 au 6 septembre, dans un climat de panique et de peur lié à l’invasion du territoire et aux appels au meurtre des journaux de Marat et d’Hébert, des sans-culottes massacrent entre 1 100 et 1 400 personnes détenues dans les prisons. Les contemporains et certains historiens[15]ont attribué à Danton un rôle dans ces événements, mais rien ne prouve que les massacres aient été organisés par lui, ni par aucun autre. On sait seulement que, ministre de la Justice, il n’a rien fait pour les arrêter. « L’attitude des autorités est, sur le moment, embarrassée » écrit François Furet[16] « Toutes se sentent débordées et intimidées. Ni la Commune, ni son Comité de surveillance, n’ont préparé les massacres : ils les ont laissé faire en cherchant à en limiter la portée. Ministre de la Justice, Danton s’est abstenu de toute intervention. L’opinion révolutionnaire a, dans son ensemble, non pas approuvé mais justifié l’événement. »
Le 4 septembre, pendant les massacres, le Comité de surveillance de la Commune où siège Marat lance des mandats d’arrestation contre Roland et Brissot. Cette fois Danton intervient et, s’opposant à Marat en une altercation caractéristique des deux hommes, fait révoquer les mandats ; de même, il réussit habilement à faire échapper Adrien Duport, Talleyrand et Charles de Lameth.
Le 20 septembre, Valmy sauve la France de l’invasion et donne le signal de la détente. Le même jour, la Convention se réunit, première assemblée élue au suffrage universel à deux degrés (mais seuls les militants révolutionnaires ont osé paraître aux assemblées primaires). A Paris, Robespierre est élu le premier, puis c’est le tour de Danton qui obtient le plus grand nombre de voix : 638 sur 700 présents. Ses amis, Camille Desmoulins, Legendre et Fabre d’Eglantine sont élus avec lui. Il opte pour la députation, quittant le Conseil exécutif.
La Convention nationale
 Élus par moins de 10% de la population, les 749 Conventionnels sont tous issus du mouvement révolutionnaire. Deux factions rivales, les Montagnards et les Girondins entrent aussitôt en lutte pour le contrôle de la Convention (ces factions, divisées, de composition fluctuante, sans lignes politiques claires, ne sont pas des partis au sens moderne du terme). La majorité des députés, « la Plaine ou le Marais » (qui ne sont pas des « modérés »), suivent les Montagnards ou les Girondins selon qu’ils estiment que les uns ou les autres incarnent le mieux les espoirs collectifs. Danton siège à gauche avec la Montagne. Malgré les attaques des Girondins, il sera longtemps le défenseur de l’union entre les factions.
Élus par moins de 10% de la population, les 749 Conventionnels sont tous issus du mouvement révolutionnaire. Deux factions rivales, les Montagnards et les Girondins entrent aussitôt en lutte pour le contrôle de la Convention (ces factions, divisées, de composition fluctuante, sans lignes politiques claires, ne sont pas des partis au sens moderne du terme). La majorité des députés, « la Plaine ou le Marais » (qui ne sont pas des « modérés »), suivent les Montagnards ou les Girondins selon qu’ils estiment que les uns ou les autres incarnent le mieux les espoirs collectifs. Danton siège à gauche avec la Montagne. Malgré les attaques des Girondins, il sera longtemps le défenseur de l’union entre les factions.
À la Convention, le 4 octobre, Danton propose de déclarer que la patrie n’est plus en danger. Il ne demande qu’à renoncer aux mesures extrêmes. Surtout, il mesure les risques que font courir à la Révolution les querelles fratricides entre républicains. Il prêche la conciliation et appelle plusieurs fois l'assemblée à la « sainte harmonie ». « C'est en vain que l'on se plaignait à Danton de la faction girondine, écrira Robespierre, il soutenait qu'il n'y avait point là de faction et que tout était le résultat de la vanité et des animosités personnelles[17]. » Mais les attaques des Girondins se concentrent sur lui, Marat et Robespierre - les « triumvirs » - accusés d’aspirer à la dictature. Danton défend Robespierre ( « Tous ceux qui parlent de la faction Robespierre sont, à mes yeux, ou des hommes prévenus ou de mauvais citoyens » ) mais se désolidarise de Marat (« Je n’aime pas l’individu Marat. Je dis avec franchise que j’ai fait l’expérience de son tempérament : il est volcanique, acariâtre et insociable. »). Les Girondins l’attaquent sur sa gestion des fonds secrets du ministère de la Justice. Roland, ministre de l’Intérieur donne scrupuleusement ses comptes. Danton en est incapable[18]. Harcelé par Brissot, il n’échappe que par la lassitude de la Convention et longtemps les Girondins crieront « Et les comptes ? » pour l’interrompre à la tribune. Son influence est en baisse, au profit de Robespierre qui devient le vrai chef de la Montagne.
Peut-être écœuré par ces attaques et par l’échec de ses tentatives de conciliation, Danton se fait envoyer fin novembre par la Convention en Belgique avec trois autres commissaires, pour enquêter sur les besoins de l'armée du nord. Le général Dumouriez se plaignait du directoire d’achats, mis en place par la Convention en remplacement de son fournisseur aux armées (et ami de Danton) l’abbé d’Espagnac, et accusait le directoire de laisser l’armée dans le dénuement[19]. Il part le 30 novembre alors que débute le procès de Louis XVI.
Danton aurait souhaité sauver Louis XVI. Il aurait cru que c’était une des conditions de la paix. Robespierre écrira en mars 1794 : « Il voulait qu’on se contentât de le bannir. La force de l’opinion détermina la sienne[20]. » En 1816 Théodore de Lameth, venu de Londres pour tenter de sauver le roi, raconte que Danton lui a promis de l’aider : « Je ferai avec prudence mais hardiesse tout ce que je pourrai. Je m’exposerai si je vois une chance de succès, mais si je perds toute espérance, je vous le déclare, ne voulant pas faire tomber ma tête avec la sienne, je serai parmi ceux qui le condamneront[21]. » Ajoutant cependant sans illusion : « Peut-on sauver un roi mis en jugement ? Il est mort quand il paraît devant ses juges. » Pour sauver le roi, il faut des fonds. Talon, interrogé en 1803 par la police de Bonaparte, déclare avoir proposé, de la part de Danton, à William Pitt et au roi de Prusse « de faire sauver, par un décret de déportation, la totalité de la famille royale» et ajoute : « Il me fut démontré, n'ayant pu avoir aucune réponse, que les puissances étrangères se refusaient aux sacrifices pécuniaires demandés par Danton[22] ». On sait[23] cependant que le banquier Le Couteulx versa deux millions à Ocariz, qui représentait l’Espagne à Paris pour acheter des voix durant le procès du roi. « J’admets qu’on laisse en suspens la question de savoir si Danton entendait ou non garder pour lui une portion des millions qu’il demandait, écrit Georges Lefebvre[24], mais qu’il les ait sollicités, je ne parviens pas à en douter. » De retour à Paris les 16 et 18 janvier, Danton vote la mort du roi sans sursis.
Cette vénalité politique hautement défendue par Mathiez est cependant loin d'être assurée et a été contestée[25]. On est bien obligé de redire avec Mona Ozouf que les services rendus à la Contre-révolution sont "imperceptibles" ; voire contredisent l'accusation si l'on procède à une analyse épistémologique du dossier. Le 6 novembre 1792 le tout premier il demande la publication intégrale du rapport Valazé, (premier acte énonciatif des crimes de Louis Capet) qui venait être lu, en même temps qu'il rejette l'inviolabilité de Louis XVI et appelle à la condamnation en cas de reconnaissance de sa culpabilité. Le 15 novembre, il exprime le souhait d'un rapport sur le décret du 13, présenté par Pétion sur le thème "Louis est-il jugeable ?" en précisant la nécessité de se prononcer sur l'inviolabilité, le mode de jugement et la peine. Dans cette logique le 30 novembre, avant de partir en mission il appelle à l'accélération des procédures de jugement afin d'obtenir au plus vite la condamnation à mort de Louis Capet. Il aurait même dit en privé : "il ne faut pas juger le roi mais simplement le tuer[26]". De ce fait, en février 1793 il avait la confiance pleine et entière des régicides ou pro-régicides qu'on n'a jamais dans cette affaire soupçonnés de corruption : de René Choudieu à l'abbé Grégoire et Hérault de Séchelles[27]. Si on s'en tient aux faits, par ses propres votes il a ignoré les menaces de révélations de cette corruption politique par Bertrand dans une lettre du 11 décembre 1792 qu'il a découverte à son retour de mission, c'est-à dire au moment de choisir[28]. Les tentatives vénales de sauvetage du roi ont existé mais selon René Choudieu cité toujours à charge contre Danton, elles concernaient majoritairement ceux qui n'avaient pas voté la mort du roi ou dans quelques cas contraires qui avaient assorti la peine capitale de l'appel au peuple et du sursis. Ce qui n'était évidemment pas le cas de Danton ; ni d'ailleurs des "Dantonistes" montrés du doigt dans cette affaire (Lacroix, Chabot, Bazire, Fabre d'Eglantine, Robert, Thuriot)[29]. Le 16 janvier Alors que des girondins tels que Lanjuinais et Lehardy désireux de sauver le roi réclamaient le vote de la mort une majorité des 2/3 il fit front avec des Montagnards et réclama avec succès le vote de la mort à la majorité simple[30]
"... Je demande si vous n'avez pas voté à la majorité absolue seulement la république, la guerre ; et je demande si le sang qui coule au milieu des combats ne coule pas définitivement ? Les complices de Louis n'ont-ils pas subi immédiatement la peine sans aucun recours au peuple et en vertu de l'arrêt d'un tribunal extraordinaire ? Celui qui a été l'âme de ces complots mérite-t-il une exception[31] ?"...
Toujours le 16 janvier, à propos d'une discussion futile sur une pièce de théâtre, il s'exclame : "Je vous l’avouerai citoyens , je croyais qu’il s’agissait d‘une tragédie que vous devez donner en spectacle à toute l’Europe. Je croyais qu’aujourd’hui vous deviez faire tomber la tête du tyran et c’est d’une misérable comédie dont vous vous occupez."[32]
Il se trouve que l'Espagne qui aurait tenté de l'acheter envoya une lettre au Président de la Convention. Danton protesta fermement les risques d'une négociation visiblement destinée à faire traîner le procès voire à l'annuler.
"Cependant qu'on entende si on le veut cet ambassadeur, mais que le président lui fasse une réponse digne du peuple dont il sera l'organe et qu'il lui dise que les vainqueurs de Jemmapes ne démentiront pas la gloire qu'ils ont acquise, et qu'ils retrouveront, pour exterminer tous les rois de l'Europe conjurés contre nous, les forces qui déjà les ont fait vaincre... Rejetez, rejetez, citoyens, toute proposition honteuse..."[33]
Par ailleurs contrairement à ce qu'affirme Bertrand de Molleville, Danton motiva son vote. Toujours, le 16 janvier, il s'écrie
- "Je ne suis point de cette foule d'hommes d'Etat qui ignorent qu'on ne compose pas avec les tyrans, qui ignorent qu'on ne frappe les rois qu'à la tête, qui ignorent qu'on ne doit rien attendre de ceux de l'Europe que par la force de nos armes ! Je vote la mort du tyran[34]" !
Le lendemain 17 en fin d'après-midi, le vote terminé avec une très courte majorité favorable à la mort inconditionnelle, on préfère décider du sursis. Tallien, montagnard comme lui, demande qu'il soit ouvert sur le champ. Danton s'y oppose :
"Il ne faut pas décréter, en sommeillant, les plus chers intérêts de la patrie. Je déclare que ce ne sera ni par la lassitude, ni par la terreur qu'on parviendra à entraîner la Convention nationale à statuer, dans la précipitation d'une délibération irréfléchie, sur une question à laquelle la vie d'un homme et le salut public sont également attachés... Je demande donc la question préalable sur la proposition de Tallien ; et que, si cette proposition était mise aux voix, elle ne pût l'être que par l'appel nominal." [35]
Il est difficile de ne pas prendre en compte les remarques de Louis Barthou quand il écrivait
"Quand il parlait à la tribune, Danton avait toute la Convention pour témoin et pour juge des responsabilités qu'il assumait : il accomplissait un acte. Qui fut le témoin de ses entrevues avec Lameth ?" [36]
D’ordre économique, sa mission en Belgique déborde vite sur le terrain politique et militaire. La Belgique doit-elle s’ériger en république indépendante ou être réunie à la France ? Qui doit faire les frais de la guerre ? Si la République doit payer, dit Cambon, le « contrôleur général des finances de la Convention », il est impossible de continuer la guerre. Danton se décide pour l’annexion. Il prépare à Bruxelles, contre l’avis de Dumouriez soucieux de ménager les Belges, le célèbre décret sur l'administration révolutionnaire française des pays conquis. Ce décret qui, selon la formule de Georges Lefebvre, « entreprend, sous la protection des baïonnettes françaises, de rendre les peuples heureux sans les consulter, et à leurs frais », présenté à la Convention par Cambon le 15 décembre et adopté par acclamation, proclame la « souveraineté du peuple » dans les pays occupés, l’abolition de la noblesse et des privilèges, la confiscation des biens du clergé et de la noblesse pour servir de gage aux assignats émis et la création d’une administration provisoire.
Le 31 janvier, Danton vient demander à la Convention la réunion de la Belgique. Il développe dans un fameux discours la théorie des frontières naturelles qui va orienter pendant deux décennies la politique de la France :
« Ses limites sont marquées par la nature. Nous les atteindrons toutes, des quatre coins de l’horizon : du côté du Rhin, du côté de l’océan, du côté des Alpes. Là doivent finir les bornes de notre République et nulle puissance ne pourra nous empêcher de les atteindre. »
Danton est renvoyé en Belgique avec Camus et Delacroix. Dans cette seconde mission, les commissaires (« presque occupés que de leurs plaisirs » dit leur collègue Merlin de Douai), vont faire appliquer le décret par la force. Aux contributions et réquisitions va s'ajouter le pillage individuel. Danton et Delacroix vont acquérir une réputation de violence et de débauche sinon de déprédation[37].
Sa femme meurt en son absence à la naissance de son troisième fils. De retour en France le 16 février, désespéré, il fait exhumer le corps et mouler le buste par le sculpteur Deseine. Il reçoit une lettre de condoléance de Robespierre : « Si, dans les seuls malheurs qui puissent ébranler une âme comme la tienne, la certitude d’avoir un ami tendre et dévoué peut t’offrir quelque consolation, je te la présente. Je t’aime plus que jamais, et jusqu’à la mort. Dès ce moment, je suis toi-même. Embrasse ton ami[38]. » On ne le voit pas, du 17 février au 8 mars, reparaître à la Convention.
 Jacobin, ministre des Affaires étrangères dans le ministère girondin de mars 1792, général en chef de l’armée du Nord en août 1792, vainqueur à Valmy, Dumouriez occupe la Belgique après la victoire de Jemmapes. Général politique, soutenu par les Girondins, il nourrit l’espoir de diriger un état belge indépendant. Après la défaite de Neerwinden, il échoue dans une marche sur Paris pour rétablir la monarchie au profit du futur Louis-Philippe, lieutenant général dans son armée, et passe à l’ennemi début avril 1793. Très lié avec lui dans les premiers mois de 1793, Danton le soutiendra jusqu’au bout et sera accusé, sans aucune preuve, de complicité.
Jacobin, ministre des Affaires étrangères dans le ministère girondin de mars 1792, général en chef de l’armée du Nord en août 1792, vainqueur à Valmy, Dumouriez occupe la Belgique après la victoire de Jemmapes. Général politique, soutenu par les Girondins, il nourrit l’espoir de diriger un état belge indépendant. Après la défaite de Neerwinden, il échoue dans une marche sur Paris pour rétablir la monarchie au profit du futur Louis-Philippe, lieutenant général dans son armée, et passe à l’ennemi début avril 1793. Très lié avec lui dans les premiers mois de 1793, Danton le soutiendra jusqu’au bout et sera accusé, sans aucune preuve, de complicité.
Reparti en Belgique le 5 mars à l’appel de Delacroix, il trouve une situation désastreuse. Alors que Dumouriez vient d'entrer en Hollande, les Autrichiens battent le général Miranda qui doit abandonner Liège. Les habitants se révoltent contre l’armée française. Le 7, les commissaires, réunis à Bruxelles, décident de « dépêcher à Paris Danton et Delacroix pour hâter les grandes mesures ».
Outre les revers militaires en Belgique la situation de la République est grave : soulèvements dans les campagnes après la décision le 23 février de lever 300 000 hommes, insurrection de la Vendée, difficultés économiques entraînant à Paris une vague d’agitation orchestrée par les « Enragés » qui réclament le « maximum » des prix et des changements sociaux. Face à cette situation, il n’y a pas de direction homogène et efficace. Le gouvernement est tiraillé entre les généraux, les ministres du Conseil exécutif (qui depuis la Constituante ne peuvent être députés) et la Convention, toujours plus divisée entre Girondins et Montagnards et soumise à la pression des sans-culottes parisiens.
Le printemps 1793 fournit à Danton, qui a maintes fois proposé avec la Plaine, par la voix de Barère, un gouvernement d’union nationale, l’occasion de mettre son énergie et son éloquence au service de la Révolution. Les onze discours qu’il prononce du 8 mars au 1er avril sont empreints d’une sorte de frénésie. Sitôt arrivé à Paris le 8 mars, il monte à la tribune :
« Nous avons, dit-il, fait plusieurs fois l’expérience que tel est le caractère français qu’il faut des dangers pour retrouver toute son énergie. Eh bien, ce moment est arrivé ! Oui, il faut le dire à la France entière ; si vous ne volez pas au secours de vos frères de la Belgique, si Dumouriez est enveloppé, si son armée était obligée de mettre bas les armes, qui peut calculer les malheurs incalculables d’un pareil évènement. La fortune publique anéantie, la mort de 600 000 français pourrait en être la suite. Citoyens, vous n’avez pas une minute à perdre ! »
Il fait voter l’envoi de commissaires dans les sections pour engager les citoyens à voler au secours de la Belgique et provoquer une nouvelle expression de patriotisme.
Le 9 mars, il appelle avec succès à la libération des prisonniers pour dettes ; proposition transformée en loi d'interdiction absolue de ce type d'emprisonnements, sur l'initiative de Jeanbon Saint-André. Le 10, Danton prononce deux discours ; le matin, un appel à l’énergie et à l’union :
« Vos dissensions sont nuisibles. Vos discussions sont misérables. Battons l’ennemi et ensuite nous disputerons. Eh ! Que m’importe, pourvu que la France soit libre, que mon nom soit flétri ! J’ai consenti à passer pour un buveur de sang ! Buvons le sang des ennemis de l’humanité, mais enfin que l’Europe soit libre ! Remplissez vos destinées, point de passions, point de querelles, suivons la vague de la Liberté ! »
Le discours s’achève dans une ovation « universelle » dit le compte rendu. Le soir, les commissaires envoyés dans les sections évoquent la création d’un Tribunal révolutionnaire (celui institué le 17 août 1792 avait été supprimé le 29 novembre), tribunal extraordinaire jugeant sans appel et dont les jugements sont applicables sous 24 heures. La majorité de l’assemblée effarouchée est hésitante. Il est 6 heures. Pour en sortir, le président déclare la séance levée.
« Soudain Danton s’élance à la tribune en rugissant : « Je somme tous les bons citoyens de ne pas quitter leur poste ! ». Les députés, éberlués, regagnent leur place.
Danton :
« Quoi, citoyens, au moment où, Miranda battu, Dumouriez enveloppé va être obligé de mettre bas les armes, vous pourriez vous séparer sans prendre les grandes mesures qu’exige le salut de la chose publique ? Je sais à quel point il est important de prendre des mesures qui punissent les contre-révolutionnaires… »
Une voix dans la salle : « Septembre ! »
« Le salut du peuple exige de grands moyens et des mesures terribles. Puisqu’on a osé dans cette assemblée rappeler les journées sanglantes sur lesquelles tout bon citoyen a gémi je dirai, moi, que si un tribunal révolutionnaire eût existé le peuple auquel on a si souvent, si cruellement reproché ces journées ne les aurait pas ensanglantées. Faisons ce que n’a pas fait l’Assemblée législative, soyons terribles pour éviter au peuple de l’être et organisons un tribunal non pas bien, c’est impossible, mais le moins mal qui se pourra, afin que le peuple sache que le glaive de la liberté pèse sur la tête de tous ses ennemis. Je demande que, séance tenante, le tribunal révolutionnaire soit organisé, et que le pouvoir exécutif reçoive les moyens d’action et d’énergie qui lui sont nécessaires. »
Une voix dans la salle : « Tu agis comme un roi ! »
Danton : « Et toi comme un lâche[39]!» »Après une intervention de Robespierre visant à empêcher qu'il ne puisse toucher les patriotes, la loi instituant le Tribunal révolutionnaire - devant lequel, après la reine et les Girondins, il devait lui-même comparaître un an après - est votée.
 C'est dans la salle du Manège des Tuileries que se réunit la Convention jusqu’au 9 mai 1793.
C'est dans la salle du Manège des Tuileries que se réunit la Convention jusqu’au 9 mai 1793.
Le 15 mars, la Convention reçoit une lettre menaçante de Dumouriez, la rendant responsable de ses défaites. Malgré l’indignation générale, Danton s’oppose à un décret d’accusation contre lui et se fait envoyer en Belgique pour le raisonner. Il le rejoint le 20 ; dans l’intervalle, Dumouriez s’est fait écraser à Neerwinden le 18. Danton n’obtient qu’un vague billet de soumission (« J’ai épuisé tous les moyens de ramener cet homme aux bons principes. » dira-t-il) ; il rentre à Paris, mais au lieu de venir rendre compte de sa mission, disparaît plusieurs jours. Parti de Bruxelles le 21, il ne réapparait au Comité de défense général que le 26, ce qui a intrigué contemporains et historiens. Lorsque la Convention apprend la défaite de Neerwinden et les tractations de Dumouriez avec les Autrichiens, elle renouvelle le 25 mars, dans un élan d’union, son Comité de défense générale en y élisant des Girondins, des hommes de la Plaine et des Montagnards, Danton, Desmoulins, Dubois-Crancé et Robespierre. A la première séance, le 26, Danton, enfin réapparu, prend encore la défense de Dumouriez, reconnaît que le général a des torts, mais se porte garant de son désintéressement. Robespierre s’étonne de l’attitude de Danton et demande la destitution immédiate du général en chef. Les Girondins font bloc avec Danton pour la faire refuser. Le lendemain 27, à la Convention, Robespierre fait de nouveau le procès de Dumouriez. C’est seulement le 30 mars qu’elle se décide à envoyer des commissaires pour le citer à comparaître. Dumouriez les fait arrêter le 1er avril et les livre aux Autrichiens. Il tente ensuite d’entrainer son armée contre Paris mais se heurte à ses propres troupes et passe à l’ennemi accompagné de quelques généraux, dont Egalité fils (le duc de Chartres, futur Louis-Philippe, fils du duc d’Orléans, Philippe-Egalité, qui va être arrêté à Paris par les comités).
Jusqu'au dernier moment, Danton a cherché à établir l’union entre les républicains, contrairement à Robespierre et aux Montagnards qui jugeaient l’union avec les Girondins impossible (« Quoique assis au sommet de la Montagne, écrit le robespierriste Levasseur[40], il avait été jusque-là, sinon l’homme de la Droite, du moins en quelque sorte le chef du Marais. »). La trahison de Dumouriez va provoquer la rupture de Danton avec la Gironde. Le 1er avril, à la Convention, les Girondins l’accusent de complicité. Danton, soutenu par la Montagne (qui comprit, dit Levasseur, « que son impétueuse éloquence allait rompre toutes les digues ») répond en attaquant à son tour. Se tournant vers la Montagne, il s’écrie :
« Je dois commencer par vous rendre hommage, citoyens qui êtes placés à cette Montagne : vous avez mieux jugé que moi. J’ai cru longtemps que, quel que fût l’impétuosité de mon caractère, je devais tempérer les moyens que la nature m’a départis, je devais employer, dans les circonstances difficiles où m’a placé ma mission, la modération que m’ont paru commander les évènements. Vous m’accusiez de faiblesse ; vous aviez raison, je le reconnais devant la France entière… Eh bien ! je crois qu’il n’est plus de trêve entre la Montagne, entre les patriotes qui ont voulu la mort du tyran et les lâches qui, en voulant le sauver, nous ont calomniés dans toute la France. »
Au cours d’une séance dramatique, la Gironde et lui se renvoient l’accusation d’avoir trempé dans le complot monarchique du général en chef. Seul résultat immédiat de cette mêlée : les Girondins font décréter que les députés suspects de complicité avec l’ennemi ne seront plus protégés par l’inviolabilité parlementaire. Le soir, aux Jacobins, Robespierre prend la défense de Danton et demande la mise en accusation des Girondins.
La Plaine ne songe pas à suivre Robespierre, mais les circonstances l’inclinent vers Danton. Le 6 avril, la Convention crée enfin le Comité de Salut public, réclamé par Danton et Robespierre dès le 10 mars et y place des hommes qui ne sont pas trop impliqués dans le conflit entre Gironde et Montagne et qui souhaitent l’unité: sept députés de la Plaine, Barère en tête, la Montagne n’est représentée que par Danton et son ami Delacroix.
Second passage au gouvernement (avril - juillet 1793) – Membre du Comité de salut public
 Louise Gély (1776-1856), seconde femme de Danton, qu’elle épouse le 17 juin 1793, se tient debout derrière Antoine Danton, fils de Gabrielle Charpentier, première femme de l’avocat. Louise sera veuve à 17 ans. Peinture de Boilly gravée en couleurs par Cazenave sous le titre L'Optique.
Louise Gély (1776-1856), seconde femme de Danton, qu’elle épouse le 17 juin 1793, se tient debout derrière Antoine Danton, fils de Gabrielle Charpentier, première femme de l’avocat. Louise sera veuve à 17 ans. Peinture de Boilly gravée en couleurs par Cazenave sous le titre L'Optique.
Le Comité de salut public, chargé de surveiller et d’animer le Conseil exécutif des ministres devient très vite le véritable pouvoir exécutif de la Convention. Composé de neuf membres rééligibles tous les mois par la Convention, il se réunit au deuxième étage du pavillon de Flore, devenu le pavillon de l’Egalité et ses délibérations demeurent secrètes. Dominé par Danton, il va être réélu intégralement le 10 mai et le 10 juin (il s’agrandit à cette date de 4 adjoints, 3 robespierristes, Saint-Just, Couthon, Jean Bon Saint-André, et un ami de Danton, Hérault de Séchelles).
Danton, « le plus modéré des Montagnards[42] », se refuse aux mesures révolutionnaires réclamées par les sections et les clubs parisiens (économie dirigée, levée en masse, loi des suspects) face à une situation extérieure et intérieure de plus en plus menaçante (invasion étrangère, contre-révolution intérieure). La Terreur ne sera mise à l’ordre du jour qu’après son départ. Chargé au Comité de salut public des Affaires étrangères, il rêve d’un compromis avec l’Europe et essaie de négocier en secret pour fissurer le bloc de la coalition, prêt à offrir la libération de la reine. Le 13 avril, il détermine la Convention à désavouer la guerre de propagande et à déclarer qu’elle « ne s’immiscerait en aucune manière dans le gouvernement des autres puissances ». Mais ses tentatives n’aboutissent pas et se heurtent à une situation militaire défavorable. La Belgique et la rive gauche du Rhin reprises par les coalisés, la France ne disposait plus de monnaie d'échange. « Que pouvait offrir Danton ? se demande Georges Lefebvre[43] L’abandon des conquêtes de la République ? Les coalisés les avaient reprises et comptaient démembrer la France ; ils se moquaient des propositions dérisoires d’un régicide aux abois. Cette diplomatie, souvent louée depuis, supposait la victoire ou la capitulation déguisée en compromis. »
Cette politique de ménagements mécontente les sans-culottes exaspérés par la cherté des denrées de première nécessité ainsi que Robespierre et ses amis qui aspirent à le remplacer. « Tes formes robustes, dira Saint-Just dans son réquisitoire, semblaient déguiser la faiblesse de tes conseils (…) Tous tes exordes à la tribune commençaient comme le tonnerre et tu finissais par faire transiger la vérité et le mensonge. »
À la la Convention, la lutte entre la Gironde et la Montagne s’exacerbe. Pour écraser les Girondins, les Montagnards vont s’allier aux sans-culottes, en acceptant certaines de leurs revendications sociales. Le 13 avril, malgré Danton qui tente de s’y opposer (« N’entamez pas la Convention ! » s’écrie t-il), les Girondins font voter la mise en accusation de Marat, mais le jury du Tribunal révolutionnaire l’acquitte et il est ramené en triomphe par la foule à l’assemblée. Le 18 mai, la Convention élit une commission de douze membres, tous girondins, pour enquêter sur les agissements de la Commune. Le 24, cette commission arrête Hebert et Varlet. Le 25, Isnard répond par des menaces[44] à une délégation de la Commune venue demander leur libération. Le 26, Robespierre lance aux Jacobins un appel à une « insurrection » des députés « patriotes »contre leurs collègues accusés de trahisons. Danton tente de désamorcer la « journée » qui se prépare en faisant voter le 27 à minuit la cassation de la Commission des Douze ; en vain car elle est rétablie le lendemain. Le 31 mai, la Convention est encerclée par les sans-culottes qui réclament l’arrestation des Girondins et des mesures sociales. L’assemblée se contente de supprimer de nouveau la Commission et renvoie les pétitions au Comité de salut public. Le lendemain 2 juin, une foule de 80 000 hommes armés de 150 canons investit la Convention. Après une tentative de sortie en cortège qui se heurte aux canons de Hanriot, l’assemblée doit se résigner à décréter d’arrestation 29 de ses membres. Danton a laissé faire. Les Cordeliers l’accuseront d’avoir voulu empêcher sinon modérer l’action des sans-culottes.
Danton va essayer de ne pas achever d’anéantir la droite. Les députés girondins consignés chez eux sont gardés si mollement qu’une partie s’échappe. Encouragés par l’attitude du Comité de salut public, 73 députés signent une protestation contre le 2 juin. Le 6, Barère et Danton proposent la suppression de tous les comités révolutionnaires de sections, la destitution d’Hanriot et l’envoi d’otages aux départements dont on avait arrêté les députés (preuve que Danton ne voulait pas la mort des Girondins) mais Robespierre fait repousser ces mesures. Danton n’insiste pas.
Le 16 juin, Danton se remarie. Il épouse Louise Gély, jeune fille qui s’occupe de ses enfants, amie de sa première femme. Elle est charmante, jeune (16 ans) et pieuse. Pour l’épouser, il consent se marier devant un prêtre insermenté échappé aux massacres de septembre. La dot de 40 000 livres apportée par la jeune fille est en réalité payée par lui et le régime est celui, rare à l’époque, de la séparation des biens.
Plus occupé par son bonheur privé que par les soucis d’État, il ne vient plus aux Jacobins. Ses absences à la Convention sont remarquées. Il néglige même le Comité. Les clubs et la Commune l’accusent d’inertie. Le 23 juin Vadier dénonce les « endormeurs » du Comité. Marat attaque le Comité « de la perte publique ». Même son ami Chabot lui reproche aux Jacobins d’avoir « perdu son énergie ».
Danton semble las, usé par les défaites de l’été. Attaqué vivement le 8 à la Convention, il ne se défend pas. Le 10 juillet, lors du renouvellement du Comité de salut public, il demande à la Convention de l’écarter, par fatigue ou par calcul, ou les deux à la fois.
« Peut-être, écrit François Furet[45], fait-il un calcul politique qui va se révéler redoutable : puisque le pouvoir l’a compromis, que les autres se compromettent à leur tour et le laissent se refaire une virginité ! Le 10 juillet, à sa demande, la Convention l’écarte du Comité qu’elle renouvelle. Élu malgré lui le 5 septembre, il refuse encore sa participation au pouvoir. Jaurès a bien vu quel danger cette attitude faisait planer sur la majorité et sur lui-même : un ministrable puissant qui refuse le pouvoir risque d’être demain le pôle autour duquel se cristallisera l’opposition. »
Les robespierristes entrent au Comité. Robespierre lui-même s’y fait porter deux semaines plus tard. « Jamais substitution d’une équipe à l’autre ne se fit plus simplement » écrit Louis Madelin[46].
Le chef des « Indulgents »
 Camille Desmoulins (1760-1794), « l’homme du 14 juillet », l’ami de Danton et de Robespierre. À la fin de 1793, il veut, avec Danton et ceux qui le soutiennent, les Indulgents, arrêter la Terreur et négocier la paix. Il écrit dans son journal (Vieux Cordelier, n° 4) : « Ouvrez les prisons à 200 000 citoyens que vous appelez suspects, car, dans la Déclaration des Droits, il n’y a point de maisons de suspicion… Vous voulez exterminer tous vos ennemis par la guillotine ! Mais y eut-il jamais plus grande folie ! … Croyez-moi, la liberté serait consolidée et l’Europe vaincue si vous aviez un Comité de Clémence ! »
Camille Desmoulins (1760-1794), « l’homme du 14 juillet », l’ami de Danton et de Robespierre. À la fin de 1793, il veut, avec Danton et ceux qui le soutiennent, les Indulgents, arrêter la Terreur et négocier la paix. Il écrit dans son journal (Vieux Cordelier, n° 4) : « Ouvrez les prisons à 200 000 citoyens que vous appelez suspects, car, dans la Déclaration des Droits, il n’y a point de maisons de suspicion… Vous voulez exterminer tous vos ennemis par la guillotine ! Mais y eut-il jamais plus grande folie ! … Croyez-moi, la liberté serait consolidée et l’Europe vaincue si vous aviez un Comité de Clémence ! »
Le nouveau Comité de Salut public à peine installé, les événements désastreux se multiplient pendant l’été 1793 : soulèvements dans les provinces après l’élimination des Girondins (Lyon, Bordeaux, Marseille), victoire des vendéens à Vihiers (17 juillet), aux frontières capitulation de Valenciennes (28 juillet) et Mayence, Toulon livrée aux Anglais (29 août). La République « n’est plus, dit Barère le 23 août dans son discours sur la levée en masse, qu’une grande ville assiégée ». À Paris, où la crise économique s’accentue, les luttes pour le pouvoir entre les factions révolutionnaires s’exacerbent. Les revers militaires résultent surtout de la confusion et des désaccords sur le plan de la direction politique et du commandement militaire.
 Hébert (1757-1794), rédacteur du Père Duchesne, le journal des sans-culottes, se veut le successeur de Marat. Les Hébertistes, nom que les historiens donneront après coup à cette faction, veulent renforcer l'économie dirigée et radicaliser la terreur. Ils dirigent le mouvement sans-culotte et contrôlent le club des Cordeliers (on les appelle aussi les Cordeliers), le ministère de la Guerre dont le secrétaire général est Vincent et l’armée révolutionnaire parisienne, créée sous la pression de la rue, dont le chef est Ronsin. Autre appui : la Commune dont le maire Pache, le procureur Chaumette et le commandant de la garde nationale Hanriot leur sont favorables.
Hébert (1757-1794), rédacteur du Père Duchesne, le journal des sans-culottes, se veut le successeur de Marat. Les Hébertistes, nom que les historiens donneront après coup à cette faction, veulent renforcer l'économie dirigée et radicaliser la terreur. Ils dirigent le mouvement sans-culotte et contrôlent le club des Cordeliers (on les appelle aussi les Cordeliers), le ministère de la Guerre dont le secrétaire général est Vincent et l’armée révolutionnaire parisienne, créée sous la pression de la rue, dont le chef est Ronsin. Autre appui : la Commune dont le maire Pache, le procureur Chaumette et le commandant de la garde nationale Hanriot leur sont favorables.
Danton, de retour aux Jacobins dès le 12 juillet où il se fait applaudir, participe à ces luttes en essayant de déborder le Comité avec tous ceux que mécontente Robespierre et va faire pendant l’été de la surenchère révolutionnaire. Le 25, il est élu président de la Convention. Mais les Hébertistes, qui sont aussi candidats à la succession du pouvoir avec l’appui des sans-culottes, l’accusent de modérantisme : « Cet homme peut en imposer par de grands mots, cet homme sans cesse nous vante son patriotisme, mais nous ne serons jamais dupes… » dit Vincent aux Cordeliers, le vieux club de Danton. Le 2 septembre, à la nouvelle que Toulon s’est livrée aux Anglais, les sans-culottes, soutenus par la Commune, préparent une nouvelle « journée ». Les Jacobins s’y rallient pour canaliser le mouvement. Le 5, la Convention, cernée par les manifestants, met « la Terreur à l’ordre du jour ». La pression sans-culotte accélère les mesures révolutionnaires et fait entrer Billaud-Varennes et Collot d’Herbois au Comité, mais elle ne parvient pas à le remettre en cause. Désormais ce qu’on est convenu d’appeler le Grand Comité, dominé par Robespierre, va reprendre la situation en main et exercer une dictature de fait jusqu’en juillet 1794.
Le 5 et le 6 septembre, Danton prononce des discours révolutionnaires très applaudis à la Convention qui décrète « qu’il soit adjoint au Comité ». Après deux jours de réflexion, il refuse. « Je ne serai d’aucun Comité, s’écrie-t-il le 13 septembre, mais l’éperon de tous. »
Et puis, subitement, du 13 septembre au 22 novembre 1793, il va disparaître. Le 13 octobre, le président communique à la Convention la lettre suivante :
« Délivré d’une maladie grave, j’ai besoin, pour abréger le temps de ma convalescence, d’aller respirer l’air natal ; je prie en conséquence la Convention de m’autoriser à me rendre à Arcis-sur-Aube. Il est inutile que je proteste que je reviendrai avec empressement à mon poste aussitôt que mes forces me permettront de prendre part à ses travaux. »
Garat raconte : « Il ne pouvait plus parler que de la campagne… Il avait besoin de fuir les hommes pour respirer[47] ». Telle attitude indique que la neurasthénie l’assaillait et déjà le terrassait, dit son biographe Louis Madelin.
En son absence, ses amis continuent leurs attaques à la Convention contre le Comité. Le 25 Thuriot met en cause sa politique économique et sociale. L’assemblée applaudit et élit au Comité Briez, qui était en mission à Valenciennes lors de la capitulation. Robespierre doit menacer de quitter le Comité pour faire repousser la décision : « celui qui était à Valenciennes lorsque l’ennemi y est entré n’est pas fait pour être membre du Comité de Salut public. Ce membre ne répondra jamais à la question : pourquoi n’êtes-vous pas mort ? ». Il faut, exige-t-il, proclamer que vous conservez toute votre confiance au Comité. La Convention, se dressant alors en fait le serment. Fin octobre, vingt-deux Girondins comparaissent devant le Tribunal révolutionnaire. « Je ne pourrai les sauver » dit Danton à Garat, les larmes dans les yeux. Le 1er novembre, ils sont guillotinés en chantant encore « la Marseillaise » au pied de l’échafaud. Suivent Mme Roland, Bailly, Barnave, Houchard, Biron, 177 condamnations à mort dans les trois derniers mois de 1793.
Danton rentre le 20 novembre pour venir au secours de ses amis, députés montagnards compromis dans l'affaire de la falsification du décret de suppression de la Compagnie des Indes (voir le détail dans l’article en question) : Chabot et Bazire, ont été arrêtés le 19 novembre par le Comité de Salut public. Fabre d'Églantine, lié politiquement à Danton, reste libre bien que le Comité soit au courant de sa signature de complaisance. Car Robespierre a besoin de Danton et des modérés pour combattre la déchristianisation dans laquelle il voit une manœuvre politique de débordement par les Hébertistes .
L’offensive des Indulgents (décembre 1793-janvier 1794)
Pendant plus d’un mois, de décembre au milieu de janvier, il se forme comme un axe Robespierre-Danton sur la base d’une vigoureuse offensive contre la déchristianisation et les « ultra-révolutionnaires ». Les amis de Danton attaquent les leaders hébertistes avec l’approbation tacite de Robespierre. Camille Desmoulins lance un nouveau journal, Le Vieux Cordelier, dont les premiers numéros qui s’attaquent aux Hébertistes et à tout le courant déchristianisateur, obtiennent un énorme succès. En même temps, on apprend les premières victoires révolutionnaires. Les menaces militaires s’atténuent sans disparaître : la première guerre de Vendée est gagnée, Lyon révoltée capitule en octobre, l’insurrection de Toulon est battue en décembre, l’armée repousse les coalisés sur les frontières.
Danton incarne alors un courant plus modéré de la Montagne qui pense qu’avec le redressement de la situation militaire il convient de mettre fin à la Terreur et de faire la paix : « Je demande qu’on épargne le sang des hommes. », s’écrie-t-il le 2 décembre à la Convention. Il semble qu’il ait espéré détacher Robespierre des membres du Comité liés aux Hébertistes (Billaud-Varennes et Collot) et partager avec lui les responsabilités gouvernementales[48].
Le 12 décembre, Bourdon demande à la Convention le renouvellement du Comité de Salut public dont les pouvoirs expirent le lendemain et Merlin de Thionville propose de le renouveler tous les mois par tiers. La majorité ne les suit pas. Le 15, le n° 3 du Vieux Cordelier a un grand retentissement dans l’opinion. Il ne se borne plus à attaquer les Hébertistes mais s'en prend au système de la Terreur et au Gouvernement révolutionnaire lui-même. Le 17, Fabre, Bourdon et Philippeaux font décréter d’arrestation par la Convention deux chefs hébertistes Ronsin et Vincent, sans même en référer aux Comités. Le 20, des femmes viennent supplier la Convention de délivrer les patriotes injustement incarcérés et Robespierre lui-même fait nommer un « comité de clémence » chargé de réviser les arrestations. Le 24, le n° 4 du Vieux Cordelier réclame pratiquement la libération des suspects.
Mais le revirement a eu lieu le 21 décembre. Collot d’Herbois, de retour de Lyon et se voyant directement menacé, défend ses amis Ronsin et Vincent aux Jacobins et obtient que le club proteste contre leur arrestation. Billaud-Varennes fait révoquer par la Convention le comité de clémence. Robespierre met fin le 25 décembre aux espoirs d’alliance de Danton en impliquant les deux factions adverses dans un même complot : « Le Gouvernement révolutionnaire doit voguer entre deux écueils, la faiblesse et la témérité, le modérantisme et l’excès ; le modérantisme qui est à la modération ce que l’impuissance est à la chasteté ; et l’excès qui ressemble à l’énergie comme l’hydropisie à la santé .» Le 7 janvier, le 5ème numéro du Vieux Cordelier est attaqué aux Jacobins. Robespierre affecte d’abord de traiter Camille en « bon enfant gâté qui a d’heureuses dispositions et qui est égaré par de mauvaises compagnies » ; mais celui-ci, l’entendant demander que son journal soit brûlé, riposte par une citation de Rousseau : « Brûler n’est pas répondre. ». Robespierre éclate alors : « L’homme qui tient aussi fortement à des écrits perfides est peut-être plus qu’égaré .» Pour isoler Danton de Robespierre, Billaud et Collot font manœuvrer le Comité de sûreté générale qui « découvre » le faux décret de liquidation de la Compagnie des Indes signé par Fabre d’Eglantine, dont le gouvernement connaît l’existence depuis un mois. Fabre est arrêté le 12 janvier. Le lendemain, Danton prend sa défense mais il est isolé. « Malheur à celui qui a siégé aux côtés de Fabre, s’écrie Billaud-Varenne, et qui est encore sa dupe. » C’est l’échec de l’offensive des Indulgents[49].
Provisoirement, les divers courants de la Montagne tombent d'accord à la Convention pour voter le 4 février l’abolition de l'esclavage dans les colonies sur proposition de Levasseur après un rapport d’un des trois députés de Saint-Domingue arrivés à Paris. Danton intervient presque seul dans un célèbre discours où il proclame : « Lançons la liberté dans les colonies », liant le fait de libérer les esclaves à la volonté de ruiner l’Angleterre (« c’est aujourd’hui que l’anglais est mort »). Mais il se félicite également de l'entrée la veille (3 février 1794) des deux nouveaux députés de couleur à la Convention et place l'abolition sous le signe philosophique du "compas des principes" et du "flambeau de la raison[50]". L’abolition sera fêtée au Temple de la Raison (Notre-Dame) par la Commune en présence de Chaumette, d’Hébert et des nouveaux députés de Saint-Domingue le 18 février.
La contre-offensive des Hébertistes (février 1794)
La crise des subsistances, aggravée par la loi du maximum général (taxation des denrées et des salaires) et la libération de Ronsin et de Vincent (2 février) marquent une reprise de l’agitation des sans-culottes : attroupements devant les boutiques, pillages, violences. Le club des Cordeliers, dirigé par Vincent mène l’attaque. Le 12 février, Hébert dénonce la clique qui a inventé le mot « ultra-révolutionnaire » ; le 22, il réclame des solutions à la crise des subsistances. Le Comité répond par les décrets de ventôse : nouveau maximum général (Barère), confiscation des biens des suspects au profit des patriotes indigents (Saint-Just). Mais le 2 mars, Ronsin parle d’insurrection. Le 4, Hébert affirme que Robespierre est d’accord avec les Indulgents; les Cordeliers voilent les Droits de l’homme. Carrier réclame une « sainte insurrection » ; Hébert s’y rallie. Mais, mal préparée, non suivie par la Commune, elle échoue.
La liquidation des factions (mars-avril 1794)
Isolés, les dirigeants cordeliers sont arrêtés dans la nuit du 13 au 14 mars. Le procès se tient du 21 au 24 mars. La technique de l’amalgame permet de mêler à Hébert, Ronsin, Vincent et Momoro des réfugiés étrangers Cloots, Proli, Pereira, afin de les présenter comme des complices du « complot de l’étranger ». Tous sont exécutés le 24 mars sans que les sans-culottes ne bougent.
Le lendemain de l’arrestation des Hébertistes, Danton et ses amis qui ont gardé le silence pendant ces évènements, reprennent l’offensive. Le numéro 7 du Vieux Cordelier, qui ne paraîtra pas, réclame le renouvellement du Comité et une paix aussi rapide que possible. Mais Robespierre est décidé à frapper les chefs des Indulgents. « Toutes les factions doivent périr du même coup » dit-il à la Convention le 15 mars. Il semble néanmoins qu'il ait hésité à mettre Danton sur la liste en considération du passé commun et des services rendus à la République. Il a accepté de le rencontrer. On ne sait pas ce qui s’est dit entre les deux hommes mais on sait que Robespierre est sorti de l’entretien avec une froideur que tous les témoins ont notée. D’après les confidences de Barère, Robespierre aurait voulu sauver Camille, son ancien camarade de collège, celui qui l’avait choisi comme témoin de son mariage. Mais les pressions de Collot d’Herbois, Billaud-Varennes, Barère et surtout Saint-Just ont emporté la décision.
 Mandat d'arrêt de Danton et de ses amis par le Comité de Salut public et le Comité de sûreté générale le 30 mars 1794. Archives Nationales, Paris.
Mandat d'arrêt de Danton et de ses amis par le Comité de Salut public et le Comité de sûreté générale le 30 mars 1794. Archives Nationales, Paris.
On a l’impression que ces quelques lignes raturées et surchargées ont été écrites au cours d’une discussion dans un certain désarroi. Barère aurait tenu la plume. Billaud-Varenne signe fermement le premier. Carnot aurait dit en mettant sa signature[51] : « Songez-y bien, une tête comme celle de Danton en entraîne beaucoup d’autres. » Robespierre signe tout en bas un des derniers. Du Comité de Salut public, seul Lindet refuse de signer.Le 30 mars, le Comité ordonne l’arrestation de Danton, Delacroix, Desmoulins et Philippeaux. C’est Saint-Just qui est chargé du rapport devant la Convention. Soutenu par Robespierre, il veut que les accusés soient présents à la lecture du rapport et qu’on les arrête en fin de séance. La majorité du Comité s’y oppose par crainte d’un débat dangereux. « Si nous ne le faisons pas guillotiner, nous le serons. » De rage, Saint-Just aurait jeté son chapeau au feu[52].
Le lendemain, à la Convention consternée, Legendre demande que les accusés puissent venir se défendre. Une partie de l’assemblée est prête à le suivre. C’est Robespierre qui intervient : « Legendre a parlé de Danton, parce qu’il croit sans doute qu’à ce nom est attaché un privilège. Non, nous ne voulons point de privilèges ! Nous n’en voulons pas d’idoles ! Nous verrons dans ce jour si la Convention saura briser une prétendue idole pourrie depuis longtemps, ou si dans sa chute elle écrasera la Convention et le peuple français ! ». Et fixant Legendre : « Quiconque tremble est coupable. » Après son intervention et celle de Barère, Saint-Just présente son rapport rédigé à partir des notes de Robespierre[53]. Comme pour les Hébertistes, on associe aux accusés politiques, les prévaricateurs (Fabre, Chabot, Basire, Delauney) et des affairistes comme l’abbé d’Espagnac, les banquiers autrichiens Frey et le financier espagnol Guzman, étrangers de surcroit pour rattacher les accusés à la « conspiration de l’étranger ».
Le procès, ouvert le 2 avril, est un procès politique, jugé d’avance. Au bout de deux séances, l’accusateur Fouquier-Tinville et le président Herman doivent réclamer l’aide du Comité : « Un orage horrible gronde… Les accusés en appellent au peuple entier… Malgré la fermeté du tribunal, il est instant que vous vouliez bien nous indiquer notre règle de conduite, et le seul moyen serait un décret, à ce que nous prévoyons[54]. » Un projet de complot en vue d’arracher les accusés de leur prison (Lucile Desmoulins aurait proposé de l’argent « pour assassiner les patriotes et le Tribunal ») permet à Saint-Just de faire voter par la Convention un décret mettant les accusés hors des débats. La défense de Danton est étranglée comme avait été étouffée celle des Girondins.
 Danton conduit à l’échafaud. Sanguine attribuée à Wille. « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine ! »
Danton conduit à l’échafaud. Sanguine attribuée à Wille. « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine ! »
Danton est guillotiné le 5 avril à trente-quatre ans. Il existe un récit de son exécution par Arnault :
« L’exécution commençait quand, après avoir traversé les Tuileries, j’arrivai à la grille qui ouvre sur la place Louis XV. De là, je vis les condamnés, non pas monter mais paraître tour à tour sur le fatal théâtre, pour disparaître aussitôt par l’effet du mouvement que leur imprimait la planche ou le lit sur lequel allait commencer pour eux l’éternel repos (…) Danton parut le dernier sur ce théâtre, inondé du sang de tous ses amis. Le jour tombait. Je vis se dresser ce tribun, qui, à demi éclairé par le soleil mourant. Rien de plus audacieux comme la contenance de l’athlète de la Révolution ; rien de plus formidable comme l’attitude de ce profil qui défiait la hache, comme l’expression de cette tête qui, prête à tomber, paraissait encore dicter des lois. Effroyable pantomime ! Le temps ne saurait l’effacer de ma mémoire. J’y trouve toute l’expression du sentiment qui inspirait à Danton ses dernières paroles, paroles terribles que je ne pus entendre, mais qu’on répétait en frémissant d’horreur et d’admiration : « N’oublie pas surtout, n’oublie pas de montrer ma tête au peuple : elle est bonne à voir[55]. »
Le 13 avril, une dernière « fournée » envoie à la guillotine Lucile Desmoulins, la femme de Camille, Chaumette et la veuve d’Hébert.
Ayant obligé la Convention à livrer Danton, le Comité se croyait sûr de sa majorité. "« Il se trompait », écrit Georges Lefebvre, « elle ne lui pardonnait pas ces sacrifices. Tant de places vides répandaient une terreur secrète qui, aisément, tournerait en rébellion, car c’était sa position de médiateur entre l’assemblée et les sans-culottes qui avaient fait la force du Comité; en rompant avec ces derniers, il libérait l’assemblée et, pour achever de se perdre, il ne lui restait plus qu’à se diviser[56]. » »
Historiographie
Au XIXe siècle, la tradition républicaine a vite réhabilité Danton. Michelet, qui va se consacrer pendant dix ans aux sept volumes de son histoire de la Révolution française, parus entre 1847 et 1842, fait de Danton l’incarnation de la Révolution, « le vrai génie pratique, la force et la substance qui la caractérise fondamentalement ». Son génie ? « L’action, comme dit un ancien. Quoi encore ? L’action. Et l’action comme troisième élément[57]. » Edgar Quinet, dans sa Révolution de 1865 voit dans le triple appel de Danton à l’audace « la devise de tout un peuple ». Pour Auguste Comte et les positivistes, la philosophie encyclopédiste a produit au moins deux héros : « l’un théorique – c’est Condorcet, l’autre pratique – c’est Danton. »
Le véritable promoteur du culte de Danton est le docteur Robinet, un disciple de Comte, qui consacre 25 ans de sa vie à militer pour Danton. Son premier livre Danton. Mémoire sur sa vie privée date de 1865 ; son dernier, Danton, homme d’Etat, de 1889.
Les républicains fondateurs de la IIIe République qui veulent une incarnation républicaine de la Révolution (ce qui exclut Mirabeau) non compromise dans la Terreur (ce qui exclut Robespierre), font de Danton le héros par excellence de la Révolution française. Danton a alors sa rue, sa statue, son cuirassé. Son nom est évoqué dans toutes les cérémonies officielles.
Le début du XXe siècle va être marqué par une célèbre polémique entre deux grands historiens universitaires de gauche, Aulard et Mathiez (le premier est radical, le second socialiste) au sujet de Robespierre et Danton. Alphonse Aulard, le premier à occuper la chaire d’histoire de la Révolution française à la Sorbonne, créée en 1886, est un admirateur de Danton qui incarne pour lui la synthèse de la Révolution française et en qui il voit un précurseur de Gambetta. La réaction a lieu en 1908 avec Albert Mathiez, ancien collaborateur d’Aulard qui a été son directeur de thèse. C’est lui qui va établir de façon quasi irréfutable, en épluchant minutieusement ses comptes et en faisant un inventaire systématique de ses amis douteux, la corruption de Danton. Il fonde sa propre revue destinée à exalter l’œuvre de Robespierre et va reprendre, en l’étayant de documents, le réquisitoire de Robespierre et de Saint-Just contre Danton. Pour lui et pour les historiens de la Société des études robespierristes qui se réclament de lui, Danton est un vendu et un débauché qui a mené une politique de double-jeu.
Georges Lefebvre, qui occupe à son tour en 1937 la chaire d’histoire de la Révolution à la Sorbonne et sera jusqu’à sa mort en 1959 le spécialiste incontesté du domaine, adopte une position moins partisane et plus équilibrée : admettant la vénalité, il n’en tire pas toutes les conséquences qu’en déduit Mathiez sur la politique de Danton. C’est la position qu’adoptent les historiens contemporains François Furet et Mona Ozouf qui s’intéressent surtout aux contradictions et à la complexité du personnage. Pour François Furet, Danton est « un homme politique opportuniste, intermittent, peu délicat sur les moyens, en même temps qu'un orateur un peu génial dans l'improvisation, et un vrai tempérament politique dans les grandes occasions : la Patrie en danger, la levée en masse, le Salut public, son procès enfin[58] ». Il reproche à Mathiez d'avoir tout mélangé : la corruption privée très vraisemblable avec la vénalité politique qui l'était beaucoup moins : comment sinon expliquer le déroulement du procès dan lequel "le personnage fut mis hors des débats pour être plus facilement condamné sur les ordres de Robespierre[59]" ?".
Gérard Walter écrit dans son introduction au procès de Danton (Actes du Tribunal révolutionnaire, Mercure de France, 1986) :
« Que demandons-nous à Danton? Est-ce de savoir combien d’argent il a gagné au cours de sa carrière politique, et comment ? Ou quels sont les services qu’il a rendus à la Révolution ? Si l’on entend le juger sous ce dernier rapport, ce n’est pas le bilan de sa fortune qu’il y a lieu de dresser, mais celui de ses actes. Si celui-ci, en fin de compte, est en mesure d’établir que l’activité de Danton a contribué effectivement au triomphe de la Révolution, peu importe s’il a reçu de la Cour ou ailleurs, 30 000 livres, ou 300 000, ou même 3 millions. Par contre, s’il avait été démontré qu’il n’eût jamais touché un sol de personne, mais qu’il ne fut pas le sauveur de la France révolutionnaire à l’époque où les Allemands et les émigrés marchaient sur Paris, on aurait bien le devoir de le proclamer « grand honnête homme », mais aussi celui de le rayer définitivement du nombre des grands révolutionnaires. »
Citations
- Au club des Jacobins : à propos du boycottage d'un décret émancipateur des mulâtres par le député des colonies, Gouy d'Arcy
- Je tiens pour lâche sinon pour cupide, quiconque prétend opposer sa résistance particulière à un décret. Il faut que le membre s'explique soit en se justifiant soit en sortant de la société(10 juin 1791)[60].
- Au club des Jacobins : sur la guerre voulue par Brissot
Je vous prouverai les dangers de cette guerre.(14 décembre 1791)[61].
- A l’Assemblée législative et à la Convention :
- De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace et la France est sauvée (2 septembre 1792)
- Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple[62](13 août 1793).
- A la Convention:
- Sur le maintien de la liberté des cultes
- Quand vous aurez eu pendant quelque temps des officiers de morale qui auront fait pénétrer la lumière auprès des chaumières, alors il sera bon de parler au peuple morale et philosophie. (30 novembre 1792)[63]
- Sur le jugement du roi
- Le jugement du ci-devant roi est attendu avec impatience ; d'une part, le républicain est indigné de ce que ce procès semble interminable ; de l'autre, le royaliste s'agite en tous sens, et comme il a encore des moyens de finances et qu'il conserve son orgueil accoutumé, vous verrez au grand scandale et au grand malheur de la France, ces deux partis s'entrechoquer encore.(30 novembre 1792)[63]
- Sur la libération des prisonniers pour dettes
- Je demande que la Convention nationale déclare que tout citoyen français, emprisonné pour dettes, sera mis en liberté, parce qu'un tel emprisonnement est contraire à la saine morale, aux droits de l'homme, aux vrais principes de la liberté.(9 mars 1793)[64]
- Sur la création d'un Tribunal Révolutionnaire
- Faisons ce que n'a pas fait l'Assemblée législative ; soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être ; organisons un tribunal, non pas bien, cela est impossible, mais le moins mal qu'il se pourra, afin que le glaive de la loi pèse sur la tête de tous ses ennemis. (10 mars 1793)[64]
- Sur l'abolition de l'esclavage dans les colonies,
- Représentants du peuple français, jusqu'ici nous n'avions décrété la liberté qu'en égoïstes, pour nous seuls ; mais aujourd'hui nous proclamons à la face de l'univers et les générations futures trouveront leur gloire dans ce décret, nous proclamons la liberté universelle. (16 Pluviôse an II- 4 février 1794) [65]
- Notes de Robespierre contre Danton utilisées par Saint-Just dans son rapport d'accusation à la Convention le 11 Germinal an II-31 mars 1794 :
- « Le mot de vertu faisait rire Danton ; il n'y avait pas de vertu plus solide, disait-il plaisamment, que celle qu'il déployait toutes les nuits avec sa femme. »
- « Quand je montrais à Danton le système de calomnie des brissotins développé dans les papiers publics, il me répondait : "Que m'importe ! L'opinion publique est une putain, la postérité une sottise !. »
- Avant son arrestation (à ceux qui lui conseillent de fuir) :
- On n'emporte pas sa patrie sous la semelle de ses souliers.
- A son procès (le procès-verbal du Tribunal révolutionnaire a été très "arrangé" et son grand discours purement supprimé) :
- Interrogé sur ses noms, prénoms, domicile : Bientôt dans le néant, et mon nom au Panthéon.
- Moi vendu ! Moi ! Un homme de ma trempe est impayable !
- J'ai trop servi. La vie m'est à charge.
- A son exécution :
- Devant la maison de Robespierre :
- "Robespierre, tu me suis ! Ta maison sera rasée ! On y sèmera du sel !"
- Au bourreau : Tu montreras ma tête au peuple ; elle en vaut bien la peine.
Sources
Les sources principales de cet article sont :
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/699568
 votre commentaire
votre commentaire
- 1 Biographie
-
Par Dona Rodrigue le 26 Octobre 2014 à 22:39
Elle a apporté quelques éléments positifs:
Elle a aussi apporté des éléments négatifs:
On y instaura enfin un régime démocratique de gouvernement du peuple élu par le peuple avec création d'une assemblée législative.
La guerre contre l'Europe royaliste qui dura de 1792 à 1815
et qui fit quelques millions de morts.
L'aboltion des privilèges
Les dictatures de Robespierre et de Napoléon et plus tard le régime SOCIALISTE La déclaration des droits de l'homme proclamant la liberté, l'égalité et la fraternité
La guillotine qui, utilisée contre tous les ennemis de la révolution, fit plus de 10.000 morts. Louis XVI accorda que l'On crée alors les départements qui existent encore de nos jours. La guerre civile entre les royalistes et les républicains.
Les chouans, paysans de Vendée et de Bretagne fidèles à leur traditions, se révoltèrent sous les ordres des nobles royalistes. L'armée républicaine les écrasa et le massacre fit plus de
350.000 morts.
La liberté de penser
et de religion
sauf la RELIGION CATHOLIQUE
La Révolution suscita de grandes difficultés à l'Eglise catholique qui perdit ses biens et fut persécutée:
culte interdit, églises détruites, clergé condamné au nom de la raison et de la religion naturelle qu'était le culte de l'Etre Suprême.
Au contraire les protestants et les juifs obtinrent la liberté religieuse et furent favorables à la Révolution.
La grande bénéficiaire de la Révolution est la bourgeoisie qui prit le pouvoir en profitant des élections et qui s'enrichit en achetant les biens du clergé et des nobles. La noblesse fut persecutée.
Elle perdit ses biens et dut émigrer jusqu'au retour de l'empire et de la royauté.
Le peuple gagna peu et eut l'impression d'avoir été trompé, ce qui expliquera son envie de recommencer
(1830 + 1848 + 1870 + 1936 + 1968)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Dona Rodrigue le 25 Juillet 2012 à 18:15
10 juin 1794
La Grande TerreurPar le décret du 22 prairial An II (10 juin 1794), l'assemblée de la Convention réduit les procès révolutionnaires à une simple formalité.
Fuite en avantL'assemblée parisienne avait mis «la Terreur à l'ordre du jour»le 5 septembre 1793 mais la répression, les arrestations arbitraires et la peur de la guillotine n'avaient pas suffi à faire reculer les menaces qui pesaient sur la Révolution française et la République.
Celles-ci étaient tout à la fois menacées par l'opposition royaliste, les catholiques restés fidèles à leur foi et les gouvernements étrangers qui craignaient les velléités expansionnistes des armées françaises.
Devant la Convention, Maximilien de Robespierre, qui préside en dictateur le Comité de Salut Public, autrement dit le gouvernement du pays, justifie la Terreur avec des mots terribles :
«La Terreur n'est pas autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible !»
Il convainc les députés de voter le décret du 22 prairial. C'est le début de la Grande Terreur à Paris comme dans les départements où les représentants en mission répriment les menées anti-révolutionnaires avec plus ou moins de zèle.
Les noyades de NANTES
par le conventionnel Carrier en 1793
(gravure de Duplessis-Berteaux)
Au total, la chasse aux suspects par la Convention montagnarde et le Comité de Salut Public vont faire environ 40.000 victimes dans l'ensemble du pays, du 5 septembre 1793 à la chute de Robespierre, le 27 juillet 1794. 17.000 victimes sont guillotinées et les autres tuées de diverses façons (fusillades, noyades,...).
Malgré ces excès, la France se reprend à espérer. À l'intérieur, les révoltes sont étouffées, Vendée mise à part. Lyon et Toulon se soumettent et, aux frontières, les armées reprennent vigueur... La victoire de Fleurus écarte le danger d'invasion.
Le sursautÀ l'été 1794, la sécurité de la France semble enfin assurée. Beaucoup de députés de la Convention aspirent désormais à profiter tranquillement de leur pouvoir ainsi que de leurs richesses (souvent mal acquises).
Ils ont le sentiment que les principaux buts de la Révolution ont été atteints et se réjouissent des perspectives de conquête ouvertes par la victoire des armes. L'abolition des privilèges de naissance est irréversible, les «frontières naturelles» sont à portée de main et la séparation de l'Église et de l'État est entrée dans les faits.
Les députés s'impatientent devant le régime de Terreur sur lequel s'appuie Robespierre et qui constitue une menace perpétuelle au-dessus de leurs têtes. Ils reprochent par ailleurs à l'Incorruptible d'avoir instauré la Fête de l'Être suprême et de préparer ainsi le retour de la religion.
Ils s'inquiètent aussi de ses tractations secrètes avec l'Angleterre, en prélude à un accord de paix qu'ils jugent prématuré.
Fin juillet 1794, après sept semaines de folie meurtrière, le temps de la Grande Terreur...
et celui de Robespierre leur semble révolu.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique