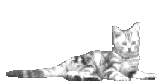La fuite de Louis XVI et de sa famille dans la nuit du 20 au 21 juin 1791 n’est pas qu’un des multiples rebondissements de la période révolutionnaire. Ses conséquences en font un des épisodes cruciaux de la Révolution. Un événement charnière qui va ternir l’image du roi et contribuera au renversement de la monarchie.
Après son installation forcée aux Tuileries, le 6 octobre 1789, la famille royale n’est plus vraiment libre de ses mouvements. Surveillée de près, ses sorties sont contrôlées.
Le 19 février 1791, le départ pour Rome des tantes de Louis XVI, inquiètes des lois anti-religieuses, jettent la suspicion sur la famille royale.
Comme l’année précédente, Louis XVI souhaite passer la Semaine Sainte puis la belle saison avec sa famille au château de Saint-Cloud. Il fixe le départ au 18 avril.
Aussitôt connue la nouvelle de ce projet, les milieux révolutionnaires affirment que le Roi veut quitter Paris pour faire ses Pâques avec un prêtre non assermenté. Au moment du départ, une foule hostile entoure le carrosse et l’empêche de partir. La famille royale doit donc rentrer aux Tuileries. En montant les marches du perron, Marie-Antoinette lance aux grenadiers : «Vous avouerez à présent que nous ne sommes pas libres !»

Comme le lui avait conseillé Mirabeau, décédé le 2 avril 1791, et encouragé par le comte suédois, Axel de Fersen, Louis XVI décide de rejoindre le quartier général du marquis de Bouillé, à Montmédy, près de la frontière du Luxembourg. Il sait que les troupes du marquis lui sont fidèles.
Un plan est échafaudé : il consiste à se faire passer pour l’équipage de la baronne de Korff (la marquise Louise-Elisabeth de Croÿ de Tourzel, gouvernante des enfants de France), veuve d’un colonel russe qui se rend à Francfort avec deux enfants (le Dauphin et Marie-Thérèse), une gouvernante, Mme Rochet (la reine), un valet de chambre (le roi) et trois domestiques (des gardes du corps du roi).
Une berline est spécialement commandée pour cette équipée. La fuite est d’autant plus délicate qu’une domestique fait courir des rumeurs sur une éventuelle fuite de la famille royale. La surveillance est renforcée, des gardes dorment à même le sol devant les portes des appartements royaux. Malgré toutes ces précautions la famille royale parvient à sortir des Tuileries. La berline passe la Barrière Saint Martin (actuelle rotonde de la Villette) vers 1h20.
Commence alors un voyage qui doit se conclure par la prise en charge de la famille par les troupes du marquis de Bouillé mais qui ne sera qu’une longue suite de contretemps et de malentendus. La berline royale prend beaucoup de retard sur l’horaire prévu.
Dans la soirée, elle arrive à Sainte-Ménehould, en Champagne, où un détachement de hussards envoyé par le marquis de Bouillé doit assurer sa protection. La berline repart sans son escorte mais le maître de poste, Drouet, qui a reconnu Louis XVI, devance la berline par des chemins de traverse et parvient à l’étape suivante à Varennes-en-Argonne. Il alerte les habitants et le procureur de la commune, l’épicier Sauce. Ce sera la fin de l’équipée.
La même nuit, le comte de Provence, futur Louis XVIII, quitte la France en suivant un autre itinéraire qui le conduit aux Pays-Bas autrichiens sans incident.
La découverte du départ du roi à Paris
Dès la découverte de la fuite du roi, c’est l’effervescence mais également l’inquiétude à Paris. Lafayette, Bailly et Alexandre de Beauharnais (le mari de Joséphine et président de l’Assemblée), se concertent et se mettent d’accord pour affirmer que le roi avait été «enlevé».
L’annonce du départ de la famille royale est faite en début de séance. M. de Laporte, intendant de la liste civile, apporte à l’Assemblée un document (le «testament politique de Louis XVI», retrouvé en 2009) que le roi a rédigé et dans lequel il explique les raisons de son départ. Le 22 juin à 22 h, on apporte la nouvelle de l’arrestation du roi. Trois commissaires sont nommés pour ramener la famille royale à Paris : Barnave, Pétion et Latour-Maubourg.
Le 23 juin, commence le retour de la famille royale à Paris. Un trajet long et difficile, ralenti ou interrompu par des manifestants qui lancent aux fugitifs injures et quolibets. A Paris, on avait affiché dans les rues : «Quiconque applaudira Louis XVI sera bâtonné ; quiconque l’insultera sera pendu». C’est donc dans un lourd silence que le roi retrouve la capitale dans la soirée du 25 juin. Le cortège passe au milieu d’une haie de gardes nationaux portant leurs crosses de fusils à l’envers.

Le prestige du roi ébranlé
La fuite manquée du roi marque un tournant dans la Révolution. La confiance dans sa sincérité et son acceptation de la Révolution sont mises en doute. Cette situation pose un redoutable problème politique aux partisans de la monarchie constitutionnelle car l’on soupçonne le roi de collusion avec l’étranger, voire de trahison. Le roi est suspendu et l’Assemblée va admettre la théorie de l’«enlèvement» du roi pour sauver ce qui peut l’être. Mais l’histoire va s’emballer.
Alors que la majorité de l’Assemblée tente de minimiser les conséquences du départ du roi, le principe monarchique commence à être remis en cause et certains parlent même ouvertement de République, une idée jusque-là très minoritaire. Mais les clubs commencent à s’agiter, sur fond d’agitation sociale engendrée par la loi le Chapelier du 14 juin interdisant toute association d’ouvriers et tout mouvement de grève.
Le 16 juillet, suite à une pétition du Club des Cordeliers demandant la déchéance du roi, les modérés du club des Jacobins font une scission et fondent le club des Feuillants. Seule, une dizaine de députés, dont Robespierre, reste au club. Le 17 juillet alors que la foule afflue au Champs-de-Mars pour signer la pétition, un incident provoque une fusillade qui fera plusieurs dizaines de victimes. Le fossé entre les classes populaires et l’Assemblée ne fera, dès lors, que s’agrandir.
La Constitution, discutée pendant tout l’été, est votée le 3 septembre et acceptée par le roi le 14, qui vient prêter serment devant l’Assemblée. L’Assemblée constituante considérant sa tâche comme achevée décide de se séparer le 30 septembre en précisant que ses membres seraient inéligibles à la nouvelle Assemblée législative. Pour beaucoup, la Révolution est terminée. La monarchie constitutionnelle semble bien installée, l’idée de République oubliée. Du moins le croit-on.
La chute de la royauté
Les mois qui suivent vont pourtant conduire à l’effondrement de la monarchie. La déclaration de guerre au «roi de Hongrie et de Bohême» (l’empereur d’Autriche), votée le 20 avril 1792, est souhaitée ouvertement par les Girondins, secrètement par le roi et combattue par Robespierre. Les défaites successives des armées françaises, les émigrés regroupés près des frontières, les rumeurs de trahison, vont créer une véritable ambiance de psychose.
Une première journée insurrectionnelle a lieu le 20 juin. Les sans culottes parisiens investissent l’Assemblée législative et les Tuileries pour forcer le roi à retirer son veto sur la déportation des prêtres réfractaires et la formation d’un camp de fédérés à Paris. Louis XVI accepte de coiffer le bonnet phrygien et de boire à la santé de la nation mais ne cède pas.
Le 5 juillet, l’Assemblée déclare la nation «en danger». Les volontaires et fédérés affluent à Paris pour rejoindre l’armée. La Commune de Paris décide d’en finir avec la monarchie. Le palais des Tuileries est pris d’assaut dans la matinée du 10 août par 15 à 20 000 insurgés. 950 gardes suisse, 200 gentilshommes et 2000 gardes nationaux assurent sa défense.
Le roi et sa famille se réfugient à l’Assemblée. Louis XVI ordonne le cessez-le-feu. 600 gardes suisses seront massacrés, le chef des gardes nationaux, Mandat, est assassiné par ses propres troupes.
Le roi est suspendu, la famille royale est installée au palais du Luxembourg puis transférée au Temple le 13 août. Début septembre, sans-culottes et populace massacrent plus de mille détenus à Paris, des centaines en province. Une nouvelle Assemblée, la Convention, est élue au suffrage universel masculin à deux degrés. Elle proclame la République le 21 septembre. C’est la fin de la monarchie.
Bibliographie :
Mona OZOUF. Varennes. La mort de la royauté. 21 juin 1791. Trente journées qui ont fait la France, Gallimard, 2005.
Marcel REINHARD, La Chute de la Royauté. 10 août 1792. Ces journées qui ont fait la France, Gallimard, 1969.
Timothy TACKETT, Le Roi s’enfuit. Varennes et l’origine de la Terreur, La Découverte, 2004
http://histoire.fdesouche.com/2311-varennes-20-25-juin-1791-la-fuite-de-la-famille-royale-et-la-fin-de-la-monarchie-2