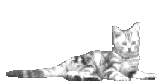-

LE CHEVALIER DE MONDION
I
Louis de Mondion de Chassigny était fils de Jean-Vincent de Mondion, écuyer, seigneur de Chassigny, près Loudun, et de Marie-Thérèse de la Châtre. Il n'avait pas encore quinze ans, lorsque éclata l'insurrection vendéenne. Emigrés dès le début de la persécution religieuse, ses parents avaient emmené avec eux ses trois frères, mais l'avaient laissé lui-même en pension à Paris, dans une institution tenue par un sieur Paulette.
Ce fut là qu'il apprit, un beau jour, la nouvelle de l'insurrection vendéenne et des premiers succès remportés par les insurgés.Tout brûlant d'enthousiasme, notre petit pensionnaire résolut aussitôt d'aller s'embrigader dans les rangs des défenseurs de la religion et de la royauté. Avec une adresse et un sang-froid qu'il eût été difficile d'attendre d'un enfant, il se fabriqué un faux passeport, escalada les murs de l'institution Paulette, prit la décampe, eut la chance de pouvoir franchir les barrières de la capitale et arriva dare-dare à Thouars, juste au moment où les Vendéens venaient eux-même d'entrer vainqueurs dans cette ville, le 5 mai 1793. La Marquise de la Rochejaquelein, qui vit le jeune volontaire au débotter, nous le dépeint ainsi dans ses Mémoires :
"Le chevalier de Mondion était un jeune homme de quatorze à quinze ans, grand et fort pour son âge, d'une belle figure, d'un courage surprenant ; il était plein d'esprit et fort vif."
Poitevin d'origine, le nouveau venu s'attacha tout naturellement à Lescure qui l'admit aussitôt au nombre de ses officiers d'ordonnance, et aux côtés duquel il ne cessa de se battre bravement, toujours au premier rang, sur tous les champs de bataille de la Grande Armée.
Espiègle autant que brave, son esprit et sa bravoure, joints à son jeune âge, lui attirèrent bien vite la sympathie générale, non seulement dans l'état-major, mais encore dans tous les rangs de l'armée. Tout le monde admirait, tout le monde aimait et chérissait cet héroïque petit bonhomme qui, toujours riant et plaisantant, s'élançait au feu le sourire aux lèvres, faisait caracoler son cheval comme s'il se fût agi d'une simple partie de plaisir, pirouettait autour des Bleus en les narguant, maniait le sabre comme un vieil officier, chantonnait au plus fort de la mêlée et, après la victoire, se reposait en égayant de ses lazzis les vainqueurs enthousiasmés !
II
Brave entre tous les braves, l'intrépide petit chevalier donna, plus d'une fois, une leçon de bravoure à de moins braves que lui. Je citerai, à ce propos, deux traits bien caractéristiques, dûment authentiques comme on va le voir.
Le premier eut pour théâtre le champ de bataille de Luçon (14 aout), et c'est un témoin oculaire, Bertrand Poirier de Beauvais, qui le rapporte dans ses Mémoires.
C'était au moment où la débandade commençait à se produire dans les rangs de l'armée vendéenne :
"Les républicains, écrit Poirier de Beauvais, apercevant la confusion, la déterminèrent par une charge de cavalerie. C'est dans ce moment que le marquis de la Roche-Saint-André, blessé d'une balle à la poitrine, et ne pouvant plus avoir son cheval qui était à quelque distance, se trouva sur le point d'être fait prisonnier. - Un cheval pour M. de Saint-André ! s'écria-t-on.
"Dans cette guerre sans quartier et un instant aussi critique, chacun ne pensant qu'à soi, le pauvre Saint-André restait, lorsque le jeune de Mondion, gentilhomme de Loudun, faible et âgé d'environ dix-sept ans, lui offrit le sien. Le généreux blessé refusa, mais Mondion descend, laisse son cheval, fuit avec les fantassins et est assez heureux pour se sauver".
Trois semaines plus tard, le 5 septembre, sur le champ de bataille de Chantonnay, la leçon devait être plus directe. Cette fois, c'est Mme de la Rochejaquelein qui va nous servir de témoin. Après avoir raconté la bataille, qui se termina par une victoire complète, elle ajoute :
"Le petit chevalier de Mondion se conduisit d'une manière surprenante pour son âge. Nous avions de très braves cavaliers, mais en général la plus grande partie de la cavalerie était médiocre ; comme il fallait nécessairement qu'elle fût quelque temps en panne, exposée au feu, ce qui ne lui arrivait pas souvent, on engagea beaucoup d'officiers à se mettre avec elle. Un officier très grand se trouva à côté du petit de Mondion ; au bout d'un instant, il lui dit :"Je suis blessé, je me retire. - Je ne vois pas cela, Monsieur. - C'est une contusion.
- Cela se peut bien, mais le sang ne coule pas ; si vous vous retirez, ne paraissant pas blessé, vous ferez prendre la fuite à la cavalerie. - Je m'en vais. - Si vous faites un mouvement, je vous brûle la cervelle", lui dit le petit de Mondion en approchant de lui son pistolet. Le pauvre homme, qui savait l'autre bien capable de le faire, n'osa plus penser à la retraite."
On peut juger, par ces deux traits, de la bravoure de notre jeune héros, et, en même temps, se faire une idée de la popularité dont il devait jouir parmi les rudes gâs de la Grande Armée.

III
Bien qu'il ne se fût ménagé sur aucun champ de bataille, et qu'il eût, au contraire, toujours affronté le feu au premier rang, l'intrépide petit chevalier n'en avait pas moins réussi, pendant longtemps, à se tirer d'affaire sans la plus légère égratignure ; ses compagnons d'armes n'en revenaient pas d'une pareille chance et nombre de paysans poitevins, chaque jour émerveillés de ses traits d'audace, en étaient arrivés à croire que le gaillard devait être quelque peu sorcier !
Il finit cependant par être blessé un beau jour. Ce fut le 22 septembre, au cours de la poursuite des Bleus qui venaient d'être battus à Saint-Fulgent.
"Ce jour-là, raconte Mme de la Rochejaquelein, le petit de Mondion et M. de Lescure s'acharnèrent tellement après les ennemis, qu'à dix heures du soir ils étaient encore à leurs trousses. Quatre soldats républicains, vêtus de blanc, s'étaient cachés derrière les haies et tiraient sur nos gens ; ces messieurs croyant que c'étaient des Vendéens, leur crièrent : "Vive le Roi ! Ne tirez pas, ce sont vos commandants" ; ils répondirent : "Vive le Roi !" et tirèrent encore. M. de Lescure leur dit : "Je vais à vous, ne tirez donc pas", et, en même temps, comme il était sur eux et avançait le bras pour leur donner des coups de plat de sabre, ils firent une décharge à bout touchant ; ils avaient rempli leurs fusils de balles et de plomb de chasse. A la lueur du feu, les généraux reconnurent des soldats républicains. M. de Lescure eut sa selle et ses habits criblés, ainsi que ces messieurs ; mais il n'y eut que le petit de Mondion qui reçut huit grains de gros plomb dans la main ; il en fut très souffrant, vu la peine qu'on eut à les retirer ; il eut longtemps la main et le bras enflés."
Ce fut à l'occasion de cette blessure que l'héroïque aide de camp du Saint du Poitou reçut le surnom de Petit-Lapin ! "Les dames, nous dit Bouraiseaux, plaisantèrent beaucoup ce jeune homme, en lui disant qu'il avait été tiré par des braconniers qui l'avaient pris pour un petit lapin. Le nom lui en resta ..."
Le Petit-Lapin accepta de la meilleure grâce du monde une plaisanterie et un surnom qui n'avaient, d'ailleurs, rien d'offensant pour lui, et, en dépit de sa blessure, il continua à se battre plus intrépidement que jamais. Quelques semaines plus tard, nous le trouvons faisant des prodiges de valeur sous les murs de Cholet, au milieu du "bataillon sacré" qui protégea la retraite de la Grande Armée.
IV
Ce fut avec le même entrain, avec la même intrépidité qu'il fit toute la campagne d'outre-Loire.
Après le passage du fleuve, il s'était donné la mission de veiller autour de son général mourant ; il l'assista jusqu'à la fin, et devint ensuite l'un des fidèles chevaliers servants de la noble veuve du Saint du Poitou.
Il partagea le sort de la Grande Armée jusqu'à Savenay, où, aux côtés de Marigny, "plus grand dans l'adversité que dans la victoire", il renouvela les prodiges de valeur accomplis à Cholet et se dévoua, en compagnie d'une poignée de braves, pour permettre aux femmes d'échapper aux baïonnettes des féroces soldats de Kléber.
Cette fois encore il eut la chance de s'échapper lui-même, mais ce ne devait pas être pour longtemps. A quelques jours de là il trouva une mort glorieuse, dans les circonstances que rapporte ainsi Mme de la Rochejaquelein :
"J'appris, trois mois après l'amnistie, les circonstances de la mort de mon père (le Marquis de Donissan), qu'on nous laissait ignorer. Il s'était retiré (après la bataille de Savenay), avec le chevalier des Essarts, MM. de Mondion, de Beauvollier, de Tinguy et quelques autres dans la forêt du Gavre ; là, ils rencontrèrent M. Canelle, négociant à Nantes, qui se cachait, étant hors la loi ; ce dernier, depuis, m'a raconté tout ceci à Bordeaux. Il donna à mon père des lettres pour des amis du côté de Guérande, où il pourrait se réfugier ; mais au lieu de cela, livré au désespoir, il voulut tenter un coup de main et retourner faire la guerre dans la Vendée ; il rassembla environ deux cents hommes, et, trois semaines après la déroute de Savenay, ils réussirent à surprendre de nuit Ancenis.
Les Bleus, effrayés quoique nombreux, se jetèrent dans des bateaux, tandis que mon père faisait rassembler à la hâte le peu de barques qui lui restaient ; les patriotes de la ville, s'apercevant du petit nombre d'ennemis, rappelèrent les volontaires et tombèrent en foule sur cette poignée de braves. Mon père, ses trois officiers et dix ou douze cavaliers, après des efforts étonnants, se firent encore jour au milieu d'eux, à coups de sabre, et sortirent de la ville ; mais poursuivis, la plupart blessés, leurs chevaux harassés, ils furent tous pris à deux lieues de la ville, menés à Angers et guillotinés."
Ainsi mourut glorieusement, après un dernier fait d'armes en compagnie du père de Lescure, l'héroïque petit aide de camp du Saint du Poitou.
H.B
_________________
Quand la lumière du passé éclaire le présent !
SOURCES
Superbe BLOG
http://lescoeursdechouans.clicforum.fr/t335-Le-chevalier-de-Mondion-dit-petit-lapin.htm
 votre commentaire
votre commentaire
-
M. Charles RETAILLEAU, curé
1790-1793.

Chesneau, vicaire des Landes (ancien vicaire de la Séguinière près de Cholet).
M. Charles Retailleau signe au registre le 28 mars 1790 avec le titre de curé des Landes-Genusson. Il avait été précédemment vicaire des Landes de 1761 à 1779, puis, curé de Sainte-Soule, en Aunis. Ancien vicaire, originaire de la Verrie où sa famille jouissait d'une considération méritée, ce saint prêtre n'était donc pas un inconnu pour les paroissiens dont il devenait le pasteur. Nous l'avons qualifié saint, et l'épithète ne paraîtra peut-être pas exagérée quand on saura que, mettant scrupuleusement en pratique les conseils évangéliques, il vendit tous ses biens pour en employer le prix à des bonnes oeuvres : soulagement des pauvres et des infirmes, restauration et décoration de l'église, etc...
"Mon grand-oncle Retailleau, nous écrivait M. Bouchet, curé de Chambretaud, le 7 août 1795, a laissé dans ma famille le souvenir d'un saint. Il paraissait heureux quand il entendait gronder le tonnerre : on le voyait alors ouvrir sa fenêtre, comme pour mieux jouir ; et, si on lui demandait raison de sa joie et de son contentement, il répondait que, "lorsqu'il tonne, bon nombre de pécheurs demandent pardon à Dieu et qu'il se commet moins de péchés !..." Ne redoutant point la mort, il n'a jamais abandonné sa paroisse. Il avait eu soin de se débarrasser, de son vivant, de toutes les richesses qui n'ont pas cours au ciel..."
C'était bien le prêtre exemplaire qu'il fallait à la paroisse des Landes aux mauvais jours de la Révolution. Ayant refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé et ne voulant pas quitter son cher troupeau, M. Retailleau se retira dans une maison du bourg, appelée "le grand logis", et continua d'exercer son zèle et sa charité avec un dévouement qui devait le conduire à la mort.... et à la gloire.
Dans les papiers de la Fabrique on trouve une double feuille intitulée Registre des sépultures sans prêtre, au rapport des témoins. Ce titre n'est pas exact ; car M. Retailleau, curé, y est mentionné, à plusieurs reprises, comme ayant présidé à des sépultures, notamment le 5 septembre 1793, les 18 et 22 octobre de la même année. Y figure aussi au même titre le nom de M. Desjardins, qualifié desservant de la Gaubretiére. Nous y trouvons la preuve que la peur ne le retenait pas oisif dans la retraite où il se cachait, et que le bon pasteur était prêt à donner sa vie pour ses brebis, à l'exemple de son divin Maître. Cette gloire, en effet, lui était réservée. A la mairie, les registres des sépultures sont signés Minier, agent aux Landes. Le maire d'alors est un nommé Gaborit ; il est mentionné, pour la première fois, le 6 pluviôse an III.
Laissons M. Aillery nous faire, dans sa chronique, le récit des douloureux événements de cette époque.
"Le 7 février 1794, une colonne républicaine, forte de 1100 hommes, allant en correspondance de Montaigu à Mortagne par Tiffauges, et trouvant les ponts de ce dernier lieu coupés, vint par les Landes pour reprendre la route de Mortagne. Au pont de Chambrette, cinquante hommes du pays observaient ce qui se passait. A la vue des républicains, ils firent une décharge et prirent la fuite. Les républicains les poursuivirent jusqu'au bourg où ils prirent toutes les personnes qui s'y trouvèrent, femmes et enfants, et les conduisirent au nombre de cent dans un champ près du bourg, sur la route de Tiffauges, et les fusillèrent au nombre de quatre-vingt-huit. Une douzaine de personnes seulement trouva le moyen de se sauver. Après la fusillade; les républicains coupèrent par morceaux les enfants et autres qui n'étaient pas morts. Depuis ce temps-là, ce champ a toujours porté le nom de champ du massacre.

Ce même jour, une partie du bourg fut brûlée. Le dimanche de la Passion, même année, les républicains se rendant de Mortagne à Montaigu, après avoir tué les personnes qu'ils trouvèrent dans le bourg, entre autres M. Retailleau, curé de la paroisse, qui fut exécuté dans un champ appelé le patis de la Tizonnière, brûlèrent l'église et les maisons qui existaient encore.
Vers le mois de mai de la même année, les royalistes et les républicains se rencontrèrent auprès du bourg, dans un clos de vigne appelé le fief de la Pommeraie. Ces derniers furent repoussés jusqu'au bois de futaie de la Boucherie, à la distance d'un kilomètre environ. Le choc paraîtrait avoir été très fort, puisque les ouvriers qui ont exploité le bois ont trouvé une grande quantité de balles dans le tronc des arbres"
La feuille de registre des sépultures sans prêtre dont nous avons parlé plus haut contient une assez longue liste de noms ; mais trois noms de femmes seulement sont accompagnés de la mention tuée par les Républicains ; les voici : Perrine Retailleau, âgée de 50 ans, le 3 février 1794, femme de Charles Audureau, de la Vincendiére ; — Perrine Audureau, âgée de 15 ans, les deux enterrées par le sacristain ; — le 7 février, Marie Chassereau, veuve de Jean Micheneau, âgée de 70 ans, inhumée par ses parents.
Aux Landes, comme dans la plupart des paroisses du bocage, la Révolution a laissé bien des lugubres souvenirs. A la suite des faits qui précèdent, beaucoup d'autres faits mériteraient sans doute d'être rapportés dans sa chronique ; malheureusement, après un siècle révolu, la tradition orale nous les transmet sans précision et parfois même visiblement altérés. Nous recueillerons néanmoins, faute de mieux, ces miettes historiques, d'après des notes qu'on a eu l'obligeance de nous communiquer.
"A l'approche des Bleus, qui furent les auteurs du massacre, un M. Chesneau s'était enfui, laissant son jeune enfant à la garde d'une femme âgée, nommée Testaud. La pauvre femme fut arrêtée par la troupe avec l'enfant confié à ses soins ; elle demanda grâce pour lui, et réussit en affirmant qu'il était le fils d'un bourgeois retiré à Nantes, ne faisant pas partie de l'armée vendéenne. Les soldats crurent sans doute que l'enfant était le fils d'un patriote et le relâchèrent avec sa gardienne. Celle-ci se trouvait à quelques pas du champ où furent exécutés 80 de ses compatriotes..." (Témoignage de Pierre Gréau et de ses soeurs, arrière-petits-enfants de cette femme.)
"Une autre femme, du Petit-Douet, qui avait réussi à s'échapper avec deux petits enfants encore au berceau, se tint cachée avec eux dans des bruyères pendant le massacre, à quelques centaines de mètres à peine du lieu de l'exécution. Les chiens des Bleus vinrent rôder tout près d'elle et des enfants ; mais les deux innocentes créatures, qui pourtant venaient d'être bousculées, dans le sauve-qui-peut, et jetées précipitamment sur les broussailles, ne poussèrent pas le moindre cri révélateur et dormirent paisiblement jusqu'à la nuit. "La Sainte Vierge m'a sauvée, disait ensuite la mère avec un accent de foi reconnaissante ; c'est elle qui a bercé mes petits enfants ; car je n'ai pas cessé un instant de lui dire mon chapelet..."
"Le massacre terminé, les égorgeurs mirent le feu à toutes les maisons du bourg et à la petite chapelle qu'avait fait bâtir M. René Desraoul où l'on vénérait une statue miraculeuse de la Sainte Vierge. Cette statue fut renversée et brisée. Ils brisèrent ensuite la cloche de l'église : Deux malheureux habitants des Landes les aidèrent dans cette besogne impie ; mais une telle flétrissure s'attacha dès lors à leurs noms, qu'ils durent quitter le pays pour aller cacher ailleurs leur honte et leur remords. L'un des deux se nommait Bidin. C'est sur l'avis qu'il donna de frapper la cloche à l'intérieur que les vandales de la République réussirent à la mettre en pièces.
Ils firent aussi brûler quantité de précieuses reliques, objet de la vénération des fidèles de la contrée, notamment celles de saint Léger, évêque d'Autun, celles de saint Eutrope et des liasses de précieux papiers....
Pendant que le bourg était la proie d'un vaste incendie, un certain nombre de personnes blotties dans une cachette, à quelques pas de l'église, apercevaient les Bleus contemplant leur ouvrage avec une satisfaction cynique. Une poule qu'ils se mirent à poursuivre pour en faire leur pot-au-feu, se précipita vers la cachette et faillit perdre tous ceux qui s'y trouvaient. renfermés. Une femme eut alors la présence d'esprit de la rejeter vivement par dessus le mur : les tourbillons de fumée la favorisant, sa manoeuvre n'éveilla pas le moindre soupçon. Cette cachette se trouvait du côté sud de l'église, dans une maison qui est aujourd'hui la propriété de M. Brochard, épicier. C'était une sorte de couloir à ciel ouvert entre deux murs dont l'unique entrée était une porte blanchie à la chaux, et masquée par une armoire.
A dater de ce moment, le bourg n'était plus habitable ; on le quitta pour les champs de genêts et les taillis. Les soldats de la Révolution inspiraient une telle frayeur que personne n'osait plus retourner à ses foyers. On rapporte qu'après une attaque, qui avait mis tout le monde en fuite, Sapinaud, blessé, traversant le bourg, n'y put trouver qu'une seule femme, accouchée, de la nuit précédente. Elle avait été abandonnée sur son lit, à la merci de la Providence. La pauvre femme voulut cependant se lever ; elle pansa avec un soin affectueux la plaie du général qui put continuer sa route Les Bleus incendièrent aussi toutes les fermes de la paroisse, excepté le Plessis et la Nauliére, qu'ils ne purent sans doute découvrir.
Une bonne partie des habitants se tenaient cachés dans les Crépines de la Bourdonnerie. Ceux qui restaient dans les alentours des fermes, durant le jour, étaient sans cesse menacés d'être découverts par les patrouilles républicaines. C'est ainsi qu'un détachement de Bleus, se dirigeant, à travers champs, vers Saint-Symphorien, emmenèrent prisonniers les Mandin, de la Berlandière, et plusieurs femmes et enfants de la famille Challet, de l'Angenaudière, qu'ils surprirent dans le patis blanc…Leur intention évidente était de les passer par les armes ; mais le commandant de la petite garnison de Saint-Symphorien, qui improuvait les massacres inutiles exécutés par ses pareils, céda aux sentiments de l'humanité et de la pitié que lui inspirait ce groupe de femmes tremblantes et inoffensives. "Citoyennes, qu'êtes-vous venues faire ici ? leur dit-il; retournez promptement à vos foyers."
Le président de la commune des Landes, Charles Chiron, de la Grande Liziére, fut particulièrement en butte aux vexations des Bleus. Toutefois, son sang-froid imperturbable le servit à souhait en plusieurs circonstances difficiles, et il ne consentit jamais à leur livrer les clés de la mairie. Pour se venger, ils mirent le feu à sa maison. Peine inutile : le prévoyant président en avait fait enlever tous les meubles et les avait fait transporter en lieu sûr, dans des champs de genêts...
François Roy, de la Petite Bourdolliére, qui aperçut les flammes du haut d'un cerisier, accourut en toute hâte, accompagné d'un nommé Jean Brin, de la Cour, et tous les deux réussirent à éteindre en partie l'incendie. Les Bleus, de plus en plus furieux contre lui, ne s'en tinrent pas là. Dans une de leurs perquisitions, ils rencontrèrent, un jour, sa fille Jeanne, âgée de 14 ans, gardant son troupeau au Passenard. Les uns voulaient la tuer, les autres l'emmener prisonnière au camp de Mortagne. Ce dernier avis prévalut et fut exécuté. En traversant le bourg des Landes, les soldats trouvèrent une vieille femme occupée à mettre du mil dans un coffre ; ils la traînèrent sur le seuil de son habitation, et l'un d'eux lui enfonça brutalement un bâton pointu dans le corps. A Saint-Martin, le détachement rencontra encore une femme âgée qu'ils emmenèrent, celle-là, au camp de Mortagne, avec la fille du président. Pendant trois semaines, elles restèrent au service des soldats et n'en furent payées (chose étonnante) par aucun mauvais traitement. Au bout de ce temps, nos deux prisonnières réussirent à s'évader en escaladant un mur. La petite Jeanne, en sautant trop précipitamment, se brisa une côte et faillit rester sur le terrain. Mais sa compagne la traîna, comme elle put, jusqu'à un épais buisson voisin, d'où elle la fit bientôt enlever sur une civière, à la faveur de la nuit, par des gens de Saint-Martin qui la rendirent à son heureux père.
Un dernier fait qui montre bien quelle terreur inspira la présence des Bleus dans la campagne des Landes-Génusson. Une dizaine d'années environ après la Révolution, des bûcherons abattaient, un jour, un vieux chêne têtard destiné à faire du bois de chauffage, sur les terres du Plessis ou de la Nauliére, (la tradition n'a pas gardé le souvenir précis du lieu) lorsque, tout à coup, ils reculent épouvantés Quel était le motif de leur épouvante ? En ouvrant le tronc creux du vieux chêne, ils avaient trouvé un squelette d'homme debout auquel des chairs desséchées étaient encore adhérentes sur certaines parties... La présence de ce squelette dans ce cercueil naturel fut vite expliquée par tous ceux qui eurent la curiosité de le venir voir. Ce squelette, il n'y avait pas à en douter, était celui d'un homme qui s'était caché là, aux jours de la Terreur, pour échapper aux poursuites des Bleus, et y était mort de faim ou de peur.
Ce fait, ajouté à tant d'autres semblables, ne donne-t-il pas raison au poète qui a dit que, dans les champs de notre héroïque Vendée, "Aucun épi n'est pur de sang humain !..."
Le vicaire de M. Retailleau, M. Chesneau, originaire de la paroisse, refusa, comme son curé, de prêter serment à la Constitution civile du clergé, et s'embarqua pour l'Espagne. Que devint-il, depuis lors ?... La mort qu'il avait voulu éviter en quittant sa patrie l'atteignit vraisemblablement dans le lieu de son exil ; car on n’a jamais trouvé aucune trace de son retour.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Champ du massacre est situé non loin de la Préverie et à peu de distance du nouveau calvaire élevé en souvenir de la mission de 1891. Il appartient aujourd'hui à M. François Guilbaud, ancien maire des Landes. Mainte fois, le soc de la charrue y a mis à nu des ossements, des sabres et des balles qui n'ont malheureusement pas été recueillis. En 1874, on a élevé, à l'entrée du champ, l'ancienne croix du cimetière qui portait déjà gravée à sa base la date de 1830 qu'on y voit encore. Malgré nos actives recherches, nous n'avons pu trouver les noms des quatre-vingt-huit victimes Il est regrettable que leurs noms ne nous aient pas été conservés. _________________Quand la lumière du passé éclaire le présent !
SOURCES
http://lescoeursdechouans.clicforum.fr/t251-M-Charles-RETAILLEAU-cure.htm
 votre commentaire
votre commentaire
-

... Séparé de sa famille depuis le 29 septembre précédent, Louis XVI occupe le second étage, — en dessous de la Reine, enfermée au troisième avec ses enfants et Madame Élisabeth.
Du seuil, avant même de pénétrer dans l'appartement, le prêtre aperçoit un spectacle qui le bouleverse : les portes donnant sur le vestibule sont ouvertes ; dans l'une des pièces, — la chambre à coucher, qu'avoisinent celle de Cléry et la salle à manger, — le Roi est debout, entouré de Garat et des municipaux, qui viennent de lui annoncer son exécution prochaine ; alors que ceux-ci semblent fortement émus, lui, comme s'il s'agissait d'un autre, apparaît «calme, tranquille, gracieux même».
Il a tout de suite reconnu son confesseur ; d'un signe de main, il commande aux autres de se retirer, et ils obéissent sans mot dire.
Il ferme alors sa porte sur eux, et M. de Firmont, resté seul avec lui, ne pouvant maîtriser son trouble, se jette à ses pieds en sanglotant. Cette explosion d'attachement vainc l'impassibilité du prince qui ne peut, lui-même, retenir ses larmes ; après quelques instants seulement, il reprend son courage et s'excuse :
— Pardonnez, Monsieur, pardonnez à ce mouvement de faiblesse, si toutefois on peut le nommer ainsi. Depuis longtemps, je vis au milieu de mes ennemis et l'habitude m'a en quelque sorte familiarisé avec eux ; mais la vue d'un sujet fidèle parle tout autrement à mon cœur ; c'est un spectacle auquel mes yeux ne sont plus accoutumés, et il m'attendrit malgré moi...
Puis, relevant l'ecclésiastique, il l'entraîne dans son oratoire, qui occupe la tourelle contiguë à la chambre, une petite pièce ronde, sans tapisserie ni ornement, que chauffe un mauvais poêle de faïence, et où il n'y a pour tout mobilier qu'une table et trois chaises de cuir... Là, du moins, les deux hommes pourront s'entretenir à leur aise, sans risquer d'être entendus.
— C'est donc à présent, Monsieur, continue Louis XVI, en faisant asseoir près de lui M. de Firmont, la grande affaire qui doit m'occuper tout entier. Hélas ! la seule affaire importante, car que sont toutes les affaires auprès de celle-là ?... Cependant, je vous demande quelques moments de répit, car ma famille va descendre. Mais, en attendant, voilà un écrit que je suis bien aise de vous communiquer...
Et, disant ces mots, il tire de sa poche un papier cacheté, dont il brise le sceau... C'est le testament qu'il a écrit quelques semaines plus tôt, et dont il tient à donner lui-même lecture à son confesseur, d'une voix ferme, où un peu d'émotion paraît seulement quand il prononce le nom de ceux qui lui sont chers.
Cette lecture finie, comme la famille royale n'est pas encore là, le Roi pose à M. de Firmont quelques questions sur la situation du clergé ; bien qu'au secret, il connaît la triste existence des prêtres, sait que beaucoup ont dû s'expatrier, sont emprisonnés, pourchassés... Il s'intéresse particulièrement à certains, au cardinal de La Rochefoucauld, à l'évêque de Clermont, à M. de Floirac, à l'archevêque de Paris... Pour celui-ci, qui est émigré à Constance, il charge son confesseur d'une commission spéciale :
— Marquez-lui que je meurs dans sa communion et que je n'ai jamais reconnu d'autre pasteur que lui. Hélas ! je crains qu'il ne m'en veuille un peu de ce que je n'ai pas fait réponse à sa dernière lettre. J'étais encore aux Tuileries, mais, en vérité, les événements se pressaient tellement autour de moi, à cette époque, que je n'en trouvai pas le temps. Au surplus, il me pardonnera, j'en suis sûr, car il est bon...
Puis, se poursuivant, la conversation tombe sur le duc d'Orléans, et Louis XVI parle de Philippe-Égalité, sans amertume et avec plus de pitié que de courroux :
— Qu'ai-je donc fait à mon cousin pour qu'il me poursuive ainsi ?... Mais pourquoi lui en vouloir ?... Ah ! il est plus à plaindre que moi !... ma position est triste, sans doute, mais le fût-elle davantage, non, je ne voudrais pas changer avec lui !
À cet instant, un commissaire pénètre dans l'oratoire et annonce au Roi que sa famille est descendue pour lui faire ses adieux.
D'un trait, le malheureux s'élance dans sa chambre, laissant là M. de Firmont, qui va rester seul, dans l'oratoire, sans voir la scène affreuse qu'ont vulgarisée les gravures ; il en suivra, malgré lui, au bruit, toutes les péripéties : pendant près d'un quart d'heure, pas une parole n'est articulée ; ce ne sont pas des larmes ni des sanglots, mais des cris perçants qu'on doit entendre même du dehors, le Roi, la Reine, le Dauphin, Madame Élisabeth, Madame Royale, tous à la fois confondent leurs voix. Ces transports un peu apaisés, l'entretien se poursuit avec plus de calme, à voix basse, et ce n'est qu'au bout d'une heure que Louis XVI a le courage de congédier les siens, en leur donnant l'espérance de les revoir le lendemain.
Encore bouleversé, il vient alors retrouver son confesseur et s'effondre sur une chaise en gémissant :
— Ah ! Monsieur,... quelle rencontre que celle que je viens d'avoir !... Faut-il donc que j'aime si tendrement, et que je sois si tendrement aimé !... Mais c'en est fait, oublions tout le reste pour ne penser qu'à l'unique affaire. Elle seule doit concentrer dans ce moment toutes mes affections et toutes mes pensées.
Les deux hommes commencent à peine leur entretien spirituel que Cléry se présente et propose au Roi de souper... Celui-ci hésite un moment, mais, réfléchissant aux heures qui lui restent à vivre et où il lui faudra ne pas faiblir, il accepte, passe dans la salle à manger voisine, avale en hâte, mais avec appétit, deux ailes de poulet, un peu de légumes, un biscuit trempé dans du Malaga.
Cinq minutes après, il revient, exige qu'à son tour M. de Firmont prenne quelque nourriture. Celui-ci, cependant, songe au moyen de donner à Louis XVI, qui en est privé depuis si longtemps, la suprême consolation de la sainte Communion... Craignant une profanation, il n'a pas osé apporter d'hostie consacrée ; il n'y a qu'un moyen d'en ôbtenir une : dire la messe ici même.
À cette proposition, le Roi ne peut cacher son effroi, et son confesseur doit insister pour qu'il lui soit permis au moins de tenter des démarches, avec autant de prudence et de discrétion que possible... L'autorisation est, à la fin, donnée :
— Allez, Monsieur !... mais je crains bien que vous ne réussissiez pas, car je connais les hommes auxquels vous allez avoir affaire : ils n'accordent que ce qu'ils ne peuvent refuser.
Sortant de l'appartement, M. de Firmont demande à être conduit auprès du Conseil, et on le fait descendre dans la salle du bas, où sont réunis les commissaires de la Commune.
Nul d'entre eux ne s'attendait à une pareille requête, et on peut imaginer leur surprise, leur désarroi, en l'entendant formuler. Leurs exclamations en témoignent assez :
— Où trouver un prêtre à l'heure qu'il est ? s'écrie l'un d'eux.
— Et quand nous en trouverions un, ajoute un autre, comment se procurer des ornements ?
Sans se laisser troubler, M. de Firmont a réponse à tout.
— Le prêtre est tout trouvé, puisque me voici ; quant aux ornements, l'église voisine en fournira : il ne s'agit que de les envoyer chercher. Du reste, ma demande est juste, et ce serait aller contre vos propres principes que de la refuser.
— L'histoire, objecte un municipal, nous fournit assez d'exemples pour nous engager à être circonspects...
C'est toujours la même crainte qui se manifeste de voir le condamné échapper au châtiment... D'un mot, l'abbé désarme son contradicteur :
— La fouille exacte à laquelle je me suis soumis en entrant ici a dû vous prouver que je ne porte pas de poison sur moi ; si donc il s'en trouvait demain, c'est de vous que je l'aurais reçu, puisque tout ce que je demande pour dire la messe doit passer par vos mains...
Le jacobin veut répliquer, mais ses collègues lui imposent silence : finalement, on décide d'appeler les commissaires absents et de leur soumettre la requête ; on fait sortir M. de Firmont, on le rappelle au bout d'un quart d'heure, et c'est avec un joie profonde qu'il entend ce discours que lui adresse le président :
— Citoyen ministre du culte, le Conseil a pris en considération la demande que vous lui avez faite au nom de Louis Capet, et il a été résolu que sa demande, étant conforme aux lois qui déclarent que tous les cultes sont libres, lui serait accordée. Nous y mettons cependant deux conditions : la première, que vous dresserez à l'instant même une requête constatant votre demande et signée de vous ; la seconde, que l'exercice de votre culte sera achevé demain, à sept heures au plus tard, parce qu'à huit heures précises Louis Capet doit partir pour le lieu de son exécution.
Sans attendre, sur un bout de table, M. de Firmont formule sa demande, note ce qu'il lui faut pour le Saint Sacrifice et, laissant cela sur le bureau, il remonte auprès du Roi.
Celui-ci l'attend avec anxiété : son bonheur est immense en apprenant que satisfaction va être donnée à son pieux désir... L'esprit désormais en repos, il va pouvoir s'épancher avec le prêtre, en une intime causerie dont aucun détail ne sera connu. La confession durera plus de deux heures ; à minuit seulement, M. de Firmont, voyant le prince épuisé de douleur et de fatigue, obtiendra de lui qu'il prenne un peu de repos... Lui-même s'étendra sur le lit de Cléry, tandis que le Roi se couchera, après avoir donné tranquillement ses ordres à son valet de chambre :
— Cléry, vous m'éveillerez à cinq heures... Assis sur une chaise, le fidèle serviteur a passé la nuit au chevet de son maître, paisiblement endormi dans son lit à colonnes aux rideaux de damas vert.
À l'heure dite, Cléry vient allumer le feu, et ce léger bruit suffit à réveiller le Roi ; de la chambre voisine, le prêtre l'entend faire sa toilette comme à l'ordinaire.
Le prince n'a pas oublié son confesseur et un de ses premiers mots a été :
— Où est M. de Firmont ?
Aussitôt prêt, il l'appelle, l'emmène, comme la veille, dans son oratoire, et l'intime entretien reprend entre les deux hommes.
Pendant ce temps, Cléry prépare, dans la chambre, tout ce qui est nécessaire pour la messe. Vers deux heures du matin, les «ustensiles» — l'expression est d'un journaliste contemporain, — ont été apportés. Comme les sanctuaires les plus proches, l'église du Temple et Sainte-Élisabeth, sont fermés depuis 1791, il a fallu tout aller chercher à la nouvelle paroisse Saint-François-d'Assise, — l'ancienne chapelle des Capucins du Marais qui deviendra Saint-Jean-Saint-François, rue Charlot. Bien qu'ardemment constitutionnel, — il restera après le Concordat un des derniers attachés au schisme, — le curé, M. Sibire, a veillé à ce que rien ne manquât, prêté même, pour cette cérémonie insigne, ses plus riches ornements.
La pièce, où Louis XVI vient de passer ses dernières semaines, se transforme ainsi en chapelle : la commode en acajou, à dessus de marbre, servira d'autel ; elle reçoit la pierre consacrée, que recouvrent deux nappes de toile blanche, et, au-dessus d'elle, le crucifix s'encadre de flambeaux argentés, dont les cires allumées vont éclairer la scène funèbre, tout en projetant de grandes ombres sur le papier jaune à fleurs blanches qui tend les murailles.
Quand tout est disposé, Cléry vient l'annoncer ; pendant que M. de Firmont va s'habiller, le Roi demande à son valet de chambre :
— Pouvez-vous servir la messe ?
Comme le serviteur avoue ne pas savoir par cœur les répons, Louis XVI lui prête son livre, après y avoir cherché et marqué les prières rituelles ; lui-même se servira d'un autre missel, qu'on est allé demander à la Tison, — la femme du geôlier de la Reine, — puis, refusant le fauteuil préparé pour lui, il réclame le petit coussin de cuir dont il use généralement pour prier, et il s'agenouille devant l'autel improvisé... Il n'en bougera plus jusqu'à la fin de la cérémonie.
Il est six heures quand M. de Firmont commence le Saint Sacrifice, revêtu de la chasuble qu'on lui a envoyée, — une merveilleuse chasuble de drap d'or, brodée de bouquets multicolores, qu'on conserve toujours précieusement dans le trésor de Saint-Jean-Saint-François.
Les municipaux se sont retirés dans l'antichambre, dont un battant de porte restera ouvert : ils assisteront ainsi à la messe et certains, peut-être, sans en avoir l'air, s'uniront aux prières du prêtre : tous, au moins, garderont respectueusement le silence... Louis XVI, lui, suit dévotement l'office dans son livre, et, quand vient le moment de la communion, il reçoit son Dieu pour la dernière fois.
À six heures et demie, tout est fini, et le prêtre va déposer ses habits sacerdotaux dans la chambre de Cléry.
L'aube commence à poindre ; le froid est vif ; quand, rappelé, M. de Firmont revient auprès du Roi, il le trouve grelottant auprès du poêle, ne pouvant se réchauffer... Malgré tout, le prince n'a pas un mot de plainte, et il exprime seulement sa joie :
— Mon Dieu ! que je suis heureux d'avoir mes principes. Sans eux, où en serais-je maintenant ? mais, avec eux, que la mort doit me paraître douce ! Oui, il existe en haut un Juge incorruptible, qui saura bien me rendre la justice que les hommes me refusent ici-bas.
Déjà, on entend, autour du Temple, le mouvement des troupes qui se réunissent au son de la générale... M. de Firmont, à ce bruit, frémit, mais le Roi, toujours calme, y prête un moment l'oreille et dit, sans s'émouvoir :
— C'est probablement la Garde nationale qu'on commence à rassembler.
Puis, au bout d'un instant, comme la voix des officiers et le piaffement des chevaux se font plus distincts, Louis XVI écoute encore et reprend, avec le même sang-froid :
— Il y a apparence qu'ils approchent...
Le moment serait venu de revoir la Reine, comme, la veille, cela a été convenu, mais M. de Firmont croit devoir insister pour épargner aux deux époux cette suprême épreuve... Après réflexion, malgré sa douleur, le prince accepte ce sacrifice, dur entre tous.
— Vous avez raison, dit-il, Monsieur ; ce serait lui donner le coup de la mort ; il vaut mieux me priver de cette triste consolation et la laisser vivre d'espérance quelques moments de plus.
Sans cesse, cependant, des commissaires viennent frapper à la porte de l'oratoire, sous un prétexte ou sous un autre, désireux, en réalité, de s'assurer que leur victime est toujours là et ne disparaîtra pas avant l'instant fatal. Certains de ces jacobins sont même brutaux, malhonnêtes, moqueurs. Pas un instant le Roi ne se départ de sa sérénité. À peine exprime-t-il, d'un mot, le chagrin qu'il ressent :
— Voyez comme ces gens-là me traitent !... mais il faut savoir tout souffrir.
Et, un peu plus tard, il ajoute, en souriant :
— Ils voient partout des poignards et du poison ; ils craignent que je me tue. Hélas ! ils me connaissent bien mal : me tuer serait une faiblesse. Non, puisqu'il le faut, je saurai bien mourir...
La demie de huit heures sonne enfin à la petite pendule dorée qui orne la cheminée de la chambre à coucher. À nouveau, quelqu'un frappe et, cette fois, c'est le général Santerre qui vient chercher le condamné.
— Je suis en affaire, reprend le Roi avec autorité... Attendez-moi là ; dans quelques minutes je serai à vous.
Ce disant, il referme la porte et se jette aux genoux de M. de Firmont :
— Tout est consommé, Monsieur. Donnez-moi votre dernière bénédiction, et priez Dieu qu'Il me soutienne jusqu'au bout !
Dès que le prêtre a tracé sur lui le signe de la Croix, il se relève, sort du cabinet, s'avance vers la troupe qui emplit l'appartement ; sans rien perdre de sa présence d'esprit, il remet encore son testament à un membre de la Commune, fait quelques recommandations en faveur de Cléry, qui sanglote à côté, en lui tendant le chapeau qu'il a demandé.
— Marchons ! commande alors le Roi d'un ton ferme, et, encadré des miliciens, des commissaires, suivi par M. de Firmont, il s'engage dans l'escalier à vis...
Le guichet franchi, la traversée du jardin, plein d'un brouillard glacé, est vite faite ; Louis XVI peut cependant, en se retournant, jeter un ultime regard sur la Tour, qui garde derrière ses murailles ceux qui lui sont chers.
Dans un fracas d'armes, la petite troupe passe par l'ancien hôtel du comte d'Artois ; dans la cour d'honneur, un carrosse attend, au bas du perron : un officier de gendarmerie y monte le premier ; le Roi le suit, prend place dans le fond, fait mettre M.de Firmont à côté de lui ; un maréchal des logis saute le dernier.
La portière se referme et, entre une double haie de gardes nationaux, le véhicule sort dans la rue du Temple, où l'escorte l'encercle aussitôt, — une escorte formidable, faite pour décourager toute tentative d'attaque, cent gendarmes en éclaireurs, douze tambours, douze cents gardes nationaux serrés autour de l'équipage, et, fermant la marche, cent cavaliers de l'École militaire. Lentement, le triste cortège a remonté la rue du Temple et gagné les boulevards, qu'il suivra jusqu'à la rue de la Révolution, — la rue Royale actuelle, — qui le mènera, tout droit, à la place ci-devant Louis XV, — notre Concorde d'aujourd'hui, — où l'échafaud attend sa victime, dressé entre les Champs-Élysées et le piédestal, dont a été déboulonnée la statue du «Bien Aimé».
Enfermé dans la voiture, ne pouvant plus rien dire à son confesseur qui ne fût entendu, le Roi a pris le parti de se taire, et tous respectent son silence. Pas une parole ne sera échangée pendant la grande heure et demie que durera le trajet. À un moment donné seulement, M. de Firmont a l'heureuse pensée de prêter son bréviaire au condamné, et celui-ci l'accepte avec plaisir ; il indique même, d'un geste, son désir que le prêtre lui montre les psaumes convenant le mieux à sa situation : jusqu'à la fin, l'un et l'autre en réciteront alternativement les versets.
Ainsi absorbé dans ses prières, Louis XVI, semble-t-il, ne s'occupe nullement de ce qui se passe au dehors ; les vitres relevées, couvertes de buée, doivent du reste aussi bien l'empêcher de voir que d'être vu.
Conformément aux ordres de la Commune, les boutiques, sur le parcours, sont closes, les fenêtres et portes fermées, les voies transversales barrées ; tout le long de la chaussée, plus de quatre-vingt mille hommes armés font la haie, empêchant quiconque de traverser.
Il y aura pourtant, çà et là, quelques incidents : des cris de grâce seront poussés au sortir de la rue du Temple ; plus loin, à l'angle de la rue de Cléry et du faubourg Saint-Denis, le baron de Batz et trois de ses amis feront une tentative désespérée, forceront les barrages et, ne se voyant pas suivis, pourront par miracle s'échapper ; plus loin encore, un autre royaliste, Nicole-Joseph Beaugeard, ancien secrétaire des commandements de la Reine, sera massacré pour avoir voulu approcher du carrosse royal.
Le Roi ne s'est aperçu de rien, pas plus que M. de Firmont, au courant cependant, par ses amis Lézardière, des projets du baron de Batz, et qui n'a cessé d'attendre, avec un secret espoir, la tentative annoncée... Tous deux, jusqu'au bout, garderont l'impression de s'avancer dans un absolu silence, que troublent seules les batteries des tambours.
À 10 h 10, la place de la Révolution est atteinte : vingt mille hommes au moins sont encore rangés là, et toutes les issues sont garnies de canons chargés à mitraille... À l'instant où le carrosse décrit un cercle pour s'approcher de la guillotine, le Roi, pour la première fois, rompt le silence et, se penchant à l'oreille de M. de Firmont, lui murmure :
— Nous voilà arrivés, si je ne me trompe.
Le prêtre ne trouve rien à répondre... Les chevaux du reste viennent de s'arrêter, la portière s'ouvre, les gendarmes s'apprêtent à descendre. Louis XVI les arrête d'un geste et, appuyant sa main sur le genou de l'abbé, il dit à ses gardiens, «d'un ton de maître» :
— Messieurs, je vous recommande Monsieur que voilà : ayez soin qu'après ma mort il ne lui soit fait aucune insulte. Je vous charge d'y veiller.
Et, comme les deux hommes semblent faire la sourde oreille, le Roi veut insister, élève la voix, mais l'un d'eux lui coupe la parole, ripostant d'un ton goguenard, bien peu rassurant :
— Oui, oui, nous en aurons soin ; laissez-nous faire !...
L'instant fatal est venu : dès que Louis XVI a mis pied à terre, les trois bourreaux, Sanson, son fils et un aide, l'entourent, veulent lui ôter ses vêtements, mais il ne se laisse pas faire, se déshabille lui-même, défait son col, ouvre sa chemise, l'arrange avec soin. Un incident surgit quand on veut lui prendre les mains :
— Que prétendez-vous ?... s'écrie-t-il.
— Vous lier, répond Sanson.
— Me lier !... riposte le prince avec indignation. Je n'y consentirai jamais !... Faites ce qui vous est commandé, mais vous ne me lierez pas ; renoncez à ce projet !
Les voix s'élèvent, le bourreau est sur le point d'appeler à l'aide ; M. de Firmont estime qu'il faut, à tout prix, éviter une scène de violence ; du regard, le Roi semble l'interroger ; maîtrisant son émotion, le prêtre trouve les mots qui, seuls, sont susceptibles d'apaiser celui qui va mourir :
— Sire, dans ce nouvel outrage, je ne vois qu'un dernier trait de ressemblance entre Votre Majesté et le Dieu qui va être sa récompense.
À ces mots, Louis XVI lève les yeux au Ciel avec une intense expression de douleur.
— Assurément, soupire-t-il, il ne me faudra rien moins que Son exemple pour que je me soumette à un pareil affront.
Et, se tournant vers Sanson, il ajoute :
— Faites ce que vous voudrez, je boirai le calice jusqu'à la lie.
Dès que ses mains sont attachées, il gravit l'échafaud ; les marches en sont raides, et il doit s'appuyer sur le bras de M. de Firmont, qui le soutient... Celui-ci se demande une minute si le courage du Prince ne va pas fléchir, et c'est alors, peut-être, qu'il lui dit le mot qu'il ne niera pas avoir prononcé, mais dont il affirmera ne pas se souvenir :
— Fils de saint Louis, montez au Ciel !
Bien loin de faiblir, Louis XVI, au contraire, arrivé sur la plate-forme qui supporte la guillotine, se redresse, s'avance, impose du regard silence aux quinze ou vingt tambours qui l'entourent et n'ont pas cessé de battre, puis, «d'une voix si forte qu'elle dut être entendue du Pont-Tournant», il prononce distinctement les paroles à jamais célèbres :
— Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute ! Je pardonne aux auteurs de ma mort, et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France...
Il s'apprête à continuer, mais des officiers, fonçant l'épée à la main, ordonnent en hurlant aux tambours de rouler, aux bourreaux d'en finir. Ceux-ci appréhendent le Roi, l'entraînent, le font basculer, appuient sur le déclic, — et le couteau tombe dans un ruissellement de sang.
Tout cela n'a duré qu'une minute ; M. de Firmont, agenouillé près de la guillotine, se rejette en arrière pour n'être pas éclaboussé... En un éblouissement, il voit le fils de Sanson, un jeune homme d'une vingtaine d'années, ramasser dans le panier la tête décapitée, la saisir par les cheveux et la présenter au peuple, en gambadant et hurlant :
— Vive la Nation !
Quelques cris de «Vive la République !» lui répondent, et ces cris, peu à peu, s'amplifient, mille fois répétés par la multitude qui se presse autour de la place et force les barrages.
Profitant du désordre qui s'en suit, le prêtre descend de l'échafaud et se perd dans la foule.
(Aucun des dialogues et propos rapportés n'a été inventé ni arrangé.Tous ont été pris textuellement dans les dossiers des Archives ou les mémoires du temps)
JACQUES HÉRISSAY -LES AUMÔNIERS DE LA GUILLOTINE- PARIS, LIBRAIRE ARTHÈME FAYARD, 1935 _________________
Quand la lumière du passé éclaire le présent !
 votre commentaire
votre commentaire
-

Robespierre et l'affaire du paratonnerre
En 1780, vivait à Saint-Omer un riche avocat, Me de Vissery de Blois-Valé, qui s'était acquis quelque réputation comme physicien amateur, botaniste, peintre et inventeur.
Cette année là, en homme de progrès, il fit placer sur la plus haute cheminée de sa maison un paratonnerre.
Or, M. de Vissery avait pour voisins les Rengard-Debussy, qui étaient en mauvais termes avec lui à cause d'un mur de mitoyen. Voulant être désagréables au physicien, ceux-ci rédigèrent une requête aux échevins de Saint-Omer déclarant que le paratonnerre risquait d'attirer la foudre et réclamant l'enlèvement de cet engin.
Puis les Rengard-Debussy s'en furent trouver tous leurs voisins, l'avocat excepté (bien sûr), et leur demandèrent de signer leur pétition. Malgré son éloquence, le couple ne put décider que quatre ou cinq signatures au bas de leur réclamation.
Ce fut assez cependant pour pousser le conseil municipal de Saint-Omer à agir : les échevins décidèrent que, dans les 24 heures, M. de Vissery devrait abattre son paratonnerre ; faute de quoi, il serait, à ses frais, déféré au bailli.
L'accusé demanda aussitôt à s'expliquer, ce qui lui fut accordé. En présence d'une grande partie de la population de Saint-Omer, assemblée à la mairie, l'avocat plaida sa cause devant les échevins. Ce fut en vain. Peu au courant des progrès des sciences, la municipalité maintint sa première décision.
Cette fois, la foule prit peur. La pointe métallique qui surmontait la maison de Vissery n'allait-elle pas attirer la foudre sur la ville, provoquer une catastrophe ?
Ne se possédant plus, dominés par la crainte, nombre de gens se rendirent devant la maison de l'avocat-physicien s'énervèrent les uns les autres, puis exaspérés par le refus opposé par Vissery d'abattre son paratonnerre, ils menacèrent de mettre le feu à son habitation.
D'instant en instant, la situation devenait plus sérieuse. Comme l'avocat apprenait qu'une compagnie de grenadiers se dirigeait vers sa maison pour enlever le paratonnerre, il se résolut de céder… du moins en apparence. Il monta sur le toit de sa demeure, enleva la longue pointe et … la remplaça par une plus petite.
Apaisée, la foule se dispersa et l'avocat eut les rieurs pour lui.
Mais M. de Vissery ne voulut pas se contenter de cette demi-victoire. Il résolut de poursuivre l'affaire devant le Conseil d'Artois.
Pour défendre sa cause, il fit appel à Me Antoine-Joseph Buissart, avocat en vue, physicien également, membre de l'Académie d'Arras et de celle de Dijon, de la Société de Médecine et du Muséum de Paris. Comme l'indique Gérard Walter dans son étude sur Robespierre parue en 1936.
« Me Buissart était considéré comme le plus grand physicien que le barreau d'Arras possédât à cette époque . Ne collaborait-ils pas au journal de Physique ?
Voulant présenter un dossier convaincant aux juges du Conseil d'Artois et sachant que son client ne reculerait devant aucune dépense,
Me Buissart entreprit de réunir de réunir une importante documentation. I
l écrivit donc à nombre de savants de cette époque – Concordet, l'abbé Bertholon, Le roy, Jean Paul Marat … à maintes sociétés savantes – telles l'Académie de Montpellier, l'Académie des Sciences …, et à quatre jurisconsultes parisiens renommés : Target, Lacretelle, Henry et Polvorel.
Cette correspondance de l'avocat artésien fit connaître en France l'affaire du paratonnerre et détermina des prises de position de corps constitués ou de personnes au nom célèbre : c'est ainsi que l'Académie de Dijon rédigea un exposé qui affirmait que le paratonnerre de Vissery ne présentait aucun danger, que l'Académie de Montpellier jugea sévèrement la façon d'agir des échevins de Saint-Omer, que l'Académie d'Arras pris parti pour M. de Vissery, etc.
En septembre ou en octobre 1782 Me Buissart proposa au jeune Robespierrede plaider la cause, dont il avait établi le dossier et notamment un mémoire de 96 pages comportant un long exposé scientifique de la question.
Pour quelle raison Me Buissart s'adressa-t-il à Maximilien plutôt qu'à un autre confrère ? Gérard Walter pense que la « récente nomination de celui-ci (Robespierre) comme juge de la salle épiscopale a pu attirer son attention sur le jeune avocat dont la distinction, l'existence honorable et rangée, les relations utiles dans les milieux ecclésiastiques n'ont pas dû passer inaperçus non plus .
Cet historien pense aussi que Mme Buissart, « femme énergique et autoritairea pu influer sur la décision de son mari. Dans son étude sur La vie privée de Robespierre, Bernard Nabonne estime que son héros était l'amant de Mme Buissart. La chose est possible, sans être certaine.
Quoiqu'il en soit, vers la fin d'octobre 1782, M. de Vissery fut ; au courant de la collaboration envisagée, puisque, le 25 octobre, il écrivit à Buissart qu'il souhaitait que « M. de Robespierre se couvre de gloire dans sa plaidoirie .
Le procès commença le 14 mai 1783.
Voulant seulement obtenir gain de cause et non se venger du couple Regnard-Debussy, qui était à l'origine de l'affaire, M. de Vissery avait renoncé à toute action contre les auteurs de la pétition.
Quand en présence d'un nombreux public, Robespierre prit la parole, il s'efforça donc de prouver seulement que son client avait eu raison de dresser un paratonnerre sur sa maison.
« Les arts et les sciences sont le plus noble présent du ciel à l'humanité, lut-il d'une voix lente dit-on. Par quelle fatalité ont-ils trouvé tant d'obstacles pour s'établir sur la terre ?…
Pourquoi faut-il que nous ne puissions payer aux hommes qui ont inventé ou conduit à la perfection le juste titre de reconnaissance et d'admiration que leur doit l'humanité entière, sans être forcés de gémir en même temps sur les honteuses persécutions, qui ont rendu leurs sublimes découvertes aussi fatales à leur repos qu'elles étaient utiles au bonheur de la société ?…
Ayant repris son souffle, Robespierre poursuivit son discours. Et durant plusieurs heures, il démontra, avec de multiples preuves et références à l'appui, que le paratonnerre, loin d'être un engin « dangereux pour la sûreté publique , comme l'avaient affirmé les échevins de Saint-Omer, protégeait, au contraire, la vie des hommes contre les dangers de la foudre. Ce fait bien établi, il prit l'offensive contre les ennemis de M. de Vissery :
« Tout le monde savant, dit-il avec enthousiasme, l'a (le paratonnerre) adopté avec transport : toutes les nations éclairées se sont empressées de jouir des avantages qu'il leur offrait ; aucune réclamation n'a troublé ce concert universel de louanges, qui d'un bout à l'autre du monde à l'autre élevait jusqu'aux cieux la gloire de son auteur… « Je me trompe, il y a eu une réclamation …
« Dans ce siècle, au sein des lumières qui nous environnent, au milieu des hommes que la reconnaissance de la société prodiguait au philosophe à qui elle doit cette sublime invention, on a décidé qu'elle était pernicieuse au genre humain.
Bien que de style recherché et assez emphatique, la plaidoirie de Robespierre produisit un grand effet. Subjugués par l'accent d'autorité qui émanait de ce petit homme à la sobre élégance et par ses irréfutables arguments, puisés dans le mémoire de Bruissart, le 31 mai, les juges du Conseil d'Artois donnèrent gain de cause à son client : celui-ci pourrait replacer son paratonnerre sur sa maison.
Dans une lettre adressée à Me Buissart, M. de Vissery marqua sa satisfaction de l'heureuse issue de son procès et son appréciation du talent d'orateur de Robespierre.
« … nous en partageons la gloire à trois, vous monsieur, pour votre mémoire bien écrit, M. l'orateur pour son plaidoyer éloquent et moi pour le gain d'une cause que je ne pouvais perdre… selon le sentiment des personnes instruites.
Buissart fit imprimer son mémoire, qui fut mis en vente à Paris. Le 21 juin 1783, le Mercure de France ne manqua pas de signaler à ses lecteurs ce nouvel ouvrage. Au bas de l'article consacré au mémoire de Bruissart et à l'affaire du paratonnerre.
On put lire ces lignes : « M. de Robespierre, jeune avocat d'un mérite rare, a déployé dans cette cause, qui était la cause des Sciences et des Arts, une éloquence et une sagacité qui donnent la plus haute idées de ses connaissances.
Au début septembre, grâce à l'aide financière de M. de Vissery, Robespierre put faire imprimer sa plaidoirie, ou plus exactement ses deux plaidoyers, car le jeune avocat artésien avait pris deux fois la parole, au cours du procès du paratonnerre. Cette brochure fut adressé à bien des hommes en vue, tels Benjamin Franklin et l'abbé Bertholon, ainsi qu'à des revues littéraires de Paris.
A nouveau le Mercure de France consacra quelques lignes à Robespierre, parues dans la rubriques Annonces et Notices : « Ces plaidoyers font le plus grand honneur à M. de Robespierre, à peine sorti de l'adolescence.
Ainsi, grâce à l'affaire du paratonnerre, Maximilien, avocat provincial, commençait à faire parler de lui en dehors de l'Artois.
Au cours des années suivantes, Robespierre vit un de ses essais littéraires couronné par l'Académie de Metz, en 1784. L'Académie d'Arras, qui l'avait accueilli en son sein, le 15 novembre 1783, l'élut pour directeur, le 4 février 1786.
Vers le début 1787, Robespierre fut admis aux Rosati, club arrageois groupant notamment un capitaine du génie en garnison à Arras, un nommé Lazare Carnot, et un certain Joseph Fouché, jeune oratorien, professeur au petit séminaire.
Enfin le 26 avril 1789, Maximilien fut élu député du Tiers aux Etats-Généraux.
Il allait entrer dans l'Histoire, mais c'est une autre histoire !
 votre commentaire
votre commentaire
-
-

Jeanne Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, par François Hubert DROUAIS, 1763,
château de Versailles, Versailles.
Jeanne Antoinette Poisson, marquise de Pompadour
- Marquise de pompadour
- par Jean-Marc Nattier
Née à Paris en 1721, morte à Versailles en 1764, Jeanne Antoinette d’Etiolles, née Poisson, marquise de Pompadour est la fille de Louise-Madeleine de La Motte et de François Poisson. 1724 voit la naissance de sa soeur Françoise-Louise Poisson qui mourra vraisemblablement très jeune. C’est en 1725 que naît son frère François-Abel, futur comte de Marigny. En 1726 la future marquise de Pompadour entre au couvent des Ursulines pour y suivre ses études.
François Poisson son père est accusé de malversations financières et condamné le 20 mai 1727 : il s’enfuit à Hambourg. Pendant plusieurs années elle va étudier le chant, la danse, le théâtre, le dessin, la gravure et la littérature. En 1739 son père revient à Paris.
Le 9 mars 1741 elle se marie avec Charles Guillaume Le Normant D’Etiolles, fils du trésorier de la Monnaie et neveu du fermier général Charles-François Le Normant de Tournehem. C’est du reste ce dernier qui a pris en charge la famille Poisson quand le père François s’est expatrié en Allemagne.
Le 26 Décembre 1741 voit la naissance de son premier fils, mais ce dernier ne vivra que quelques mois. Puis c’est sa fille Alexandrine qui naît le 10 Août 1744.
Elle vit une partie de l’année au château d’Étioles près de la forêt de Sénart et
c’est à cet endroit où Louis XV aime chasser qu’il la remarque. Le 25 février 1745 le roi et la future marquise de Pompadour se rencontrent à un bal masqué organisé en l’honneur du mariage du Dauphin. Louis XV est déguisé en « if », taillé comme ceux de Versailles, elle est en « bergère ».
Invitée une autre fois par le roi elle se laisse séduire par Louis XV. Elle est elevée au titre de marquise le 7 Juillet 1745 et quitte Etiolles pour s’établir au palais des Tuileries. Son mari Charles Guillaume Le Normant d’Etiolles est séparé de corps et de biens de son épouse par sentence du Parlement, est nommé fermier général et doit s’effacer devant Louis XV.
Jeanne Antoinette est présentée officiellement à la Cour de Versailles le 14 septembre 1745 lors des festivités marquant le retour de campagne du roi.
Elle s’entoure de personnages importants : les frères Pâris, dont les avances sont nécessaires aux finances, le cardinal de Tencin et sa sœur, le maréchal de Richelieu [1].

Femme de goût, elle exerce un véritable mécénat. Elle accueille les écrivains dans l’entresol de son médecin Quesnay ; ce sont eux qui "ont donné le nom de Grand à Louis XIV. Elle apprécie Rousseau dont elle fait jouer Le Devin du village , réconcilie Voltaire avec le roi, qui lui donne la charge d’historiographe et de gentilhomme de la chambre.
Elle passe de nombreuses commandes à Gabriel, à Boucher, à La Tour, au graveur Cochin, à l’ébéniste Œben. Les artistes ont multiplié ses portraits : Quentin Latour, Nattier, Van Loo...
En 1753 aux environs de Noël, la marquise de Pompadour achète l’Hôtel d’Evreux qui est connu de nos jours sous le nom du Palais de l’Elysée.
Une partie des appartements sont transformés par son architecte Lassurance.

Les jardins sont aussi largement modifiés avec l’apport de portiques, de charmilles et d’une grotte dorée. Elle léguera cet Hôtel à Louis XV.
Madame de Pompadour a quarante-deux ans en ce mois de février 1764. Elle n’est pas en bonne santé et a souvent des problèmes cardiaques. C’est lors de son séjour à Choisy quelle prend froid. Mais c’est bien plus qu’un simple coup de froid.
Le 29 février elle est prise d’un malaise, elle crache le sang, les diagnostic des médecins est très clair : la marquise est atteinte d’une pneumonie.
La semaine qui suit elle est au plus mal. Louis XV reste à son chevet le plus possible. Il ne faut pas oublier que même si Madame de Pompadour n’est plus la favorite du roi, elle est sans aucun doute sa plus grande amie. Le 10 mars elle est considérée comme perdue. Le 24 mars, elle va mieux et retourne à Versailles. Dans la soirée du 7 avril, la marquise est victime d’une rechute, elle a beaucoup de mal à respirer.
 Le 14 avril, Madame de Pompadour fait ajouter un codicille au testament qu’elle a rédigé sept ans auparavant. Elle fait ses adieux à Louis XV et le curé de la Madeleine lui donne l’extrême-onction. Le 15 avril au matin elle a encore la force de recevoir son frère Abel François Poisson, marquis de Marigny, légataire universel de son immense fortune, le prince de Soubise, qu’elle a nommé son exécuteur testamentaire, et le duc de Choiseul, ministre de la Guerre. Elle s’éteint ce même jour à dix neuf heures trente.
Le 14 avril, Madame de Pompadour fait ajouter un codicille au testament qu’elle a rédigé sept ans auparavant. Elle fait ses adieux à Louis XV et le curé de la Madeleine lui donne l’extrême-onction. Le 15 avril au matin elle a encore la force de recevoir son frère Abel François Poisson, marquis de Marigny, légataire universel de son immense fortune, le prince de Soubise, qu’elle a nommé son exécuteur testamentaire, et le duc de Choiseul, ministre de la Guerre. Elle s’éteint ce même jour à dix neuf heures trente.Comme le veut le protocole mis en place par Louis XIV, seuls les rois ou les princes meurent à Versailles.
Si la marquise de Pompadour est décédée à Versailles c’est en raison d’une amitié de 20 ans avec Louis XV.
Néanmoins, juste après son décès, elle est transportée discrètement dans son hôtel particulier des Réservoirs.
C’est le 17 avril 1764 que les obsèques de la marquise auront lieu à l’église Notre-Dame dont l’intérieur a été entièrement tendu de noir. Le cortège funèbre se compose de cent prêtres, de vingt-quatre enfants de choeur, des quarante-deux domestiques de la défunte en livrée de deuil et de soixante-douze pauvres de la paroisse.

A l’issue de la cérémonie, à six heures du soir, le cercueil est placé dans un carrosse à dais ducal, attelé de douze chevaux caparaçonnés de moire d’argent et précédé par quatre gardes suisses. Madame de Pompadour doit reposer, selon son souhait, au couvent des Capucins de la place Vendôme, à Paris.
La pluie et le vent n’empêchent pas Louis XV de sortir sur le balcon de la cour de Marbre du château pour le regarder s’éloigner sur l’avenue de Paris. Le roi ne bouge pas jusqu’à ce que la procession disparaisse. Il pleure : « Voilà les seuls devoirs que j’ai pu lui rendre. Pensez, une amie de vingt ans ! »
SOURCES
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article263
 votre commentaire
votre commentaire
-

Enquête l'affaire du vol des diamants de la Couronne
« On volé les bijoux de la Couronne ! »
Le fait divers émeut Paris en septembre 1792.
Depuis il a fait rêver bien des amateurs d’histoires à scandale.
Lodace vous dévoile quelques secrets sur cette affaire.

Le vol des diamants de la Couronne, en septembre 1792, compte parmi les énigmes favorites des amateurs d’histoire à scandale.
La version « officielle », celle des petits voleurs accomplissant un larcin relevant du fait divers, version reprise par les historiens contemporains, n’est pas satisfaisante.

La Toison d'or de Louis XIV :
au milieu, le spinelle en forme de dragon dit Côte de Bretagne ; en dessous, le Bleu de France, désormais connu sous le nom de Hope.
Gouache 2008 de la Toison d'or de la parure de couleur de Louis XV, montrant le
"diamant bleu de la Couronne" ainsi que le spinel "Côte de Bretagne".

C’est ce qui a permis sans doute une floraisons d’interprétations des plus délirantes.
Ainsi Édouard Drumont, l’auteur de « La France juive » (1886), met en cause les joailliers et bijoutiers juifs de la capitale qui furent, selon lui, les principaux receleurs et revendeurs des diamants subtilisés par les petits voleurs.

Le diamant Sancy.
Peu lui importe que les patronymes d’origine juive qui apparaissent dans le cours de l’instruction désignent non pas des prévenus mais des témoins cités à l’audience !
Au-delà du « cas » Drumont, il reste que certains faits troublants demeurent inexpliqués et que les commanditaires du vol n’ont jamais été identifiés.

La tentation était grande de reprendre l’enquête.
Un observateur de taille :
les archives les plus précieuses sur le sujet, celles qui eussent définitivement levé le voile sur cette curieuse affaire, ont brûlé :
il s’agit des actes du conseil provisoire de la Commune insurrectionnelle du 10 août 1792, détruits dans l’incendie de l’Hôtel de Ville de Paris en 1871.

C’est donc moins à un travail d’enquêteur que d’archéologue que l’historien doit se livre.
Pour reconstituer le déroulement des faits, il lui faut explorer telle séries des Archives nationales, puis telle autre des Archives de Paris, qui le renvoie au Minutier central (ce fonds d’archives considérable et très bien conservé qui contient tous les répertoires et minutes des notaires parisiens).

C’est à ce prix seulement que, peu à peu, des témoignages ignorés, des copies de procès verbaux des sections, des inventaires inexploités, une fois assemblés, éclairent cette affaire d’un jour nouveau.
Reprenons les faits :
dans la nuit du 16 au 17 septembre 1792, la police surprend quelque voyous au moment où ils viennent de faire main basse sur les bijoux et diamants de la ci-devant (depuis le 10 août) Couronne de France.

Un seul cri dans tout Paris :
« Le Garde Meuble est volé !
Les diamants de la Couronne sont enlevés ! »
Les journaux se montrent prudents.
Le mardi suivant,
« Le Patriote français », rédigé par Brissot s’exprime sur l’affaire avec une réserve calculée car les spoliateurs ont été servis, plus qu’ils n’auraient pu l’être, par le hasard :
ce vol audacieux et considérable ne peut avoir été commis par des voleurs ordinaires.
« Le Thermomètre du jour », qui passe pour être payé et inspiré par le ministre de l’Intérieur Roland, est plus disert :
il laisse entendre clairement que l’opération a été dirigée « de haut » ;
il insinue de plus que les sentinelles qui faisaient le guet, les patrouilles qui circulaient sur la place avaient reçu des consignes : elles sont intervenues à un moment où le vol était largement consommé.
De fait, lorsque sous les colonnades du Garde Meuble, à l’angle de l’actuelle place de la Concorde et de la rue Saint-Florentin, on met la main sur ces voleurs, on récupère quelques mauvais diamants roulés dans des mouchoirs ; les plus prestigieux, tels que le
« Grand Diamant bleu »,
« Le Régent » et le « Sancy », ont déjà disparu.

Il aurait suffi de moins pour que, les rivalités entre girondins et montagnards aidant, l’affaire prenne, avant toute enquête, une tournure politique.

Les montagnards et les membres de la Commune accusent d’impéritie le ministre de l’Intérieur, Roland, qui a dans ses attributions la responsabilité du Garde-Meuble national.
Il est vrai que le ministre n’a pas su imposer son autorité : c’est sur lui aussi que retombera plus tard la responsabilité de la disparition de la correspondance secrète de Louis XVI découverte dans une armoire de fer aux Tuileries et qu’il avait été chargé d’inventorier.
Par une lettre à la Convention, reproduite dans les journaux, le ministre se disculpe en ces termes :
« Le vol du Garde-Meuble n’aurait point été commis sans doute s’il y avait eût une garde plus nombreuse et surtout plus vigilante.
Cependant plusieurs réquisitions avaient été faites à ce sujet et réitérées de la manière la plus pressante ;
j’en fais joindre ici les copies certifiés… »
Roland conclu qu’il a été l’objet d’une machination politique à laquelle il lui paraît inutile de donner, faute de preuves, une trop grande importance.
Le plus urgent est de rassurer l’opinion, après une instruction d’un mois, on livre à la justice quelques-uns des malandrins pris sur la dénonciations des premiers.

Marie de Médicis en costume de sacre, Frans II Pourbus Le Jeune, 1610 © RMN-GP (Musée du Louvre) / Thierry Le Mage
Dix-sept passent en jugement, cinq sont acquittés et douze condamnés à mort.
Parmi ces derniers, cinq seront exécutés, les autres bénéficieront de sursis puis, l’année suivante de remises de peine.
Cependant, chacun peut remarquer que le Tribunal criminel a assimilé les accusés à des agents de la contre-révolution en appliquant l’article II de la 2ème section du code pénal :
« Toutes conspirations et complots tendant à troubler l’État par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres ou contre l’autorité législative, seront punis de mort. »
Les interrogatoires subis par les accusés n’aident en rien à retrouver les principaux diamants qui ont, aux yeux de l’opinion, tout comme les autres objets contenus dans le Garde-Meuble, une importance symbolique égale, sinon supérieur à leur valeur réelle.
Qu’est-ce que le Garde-Meuble ?
Un magasin de dépôts mais aussi un musée, dont les salles ont été disposées pour permettre au public de visiter ses collections une fois par semaine.
On peut y voir les armures des rois de France, les lits de parades de la cour, la chapelle du cardinal de Richelieu, ainsi qu’une collection des tapisseries unique au monde.

Dans l’une de des salles du premier étages sont enfermés dans des vitrines les diamants montés en parure.
C’est François Ier qui, en faisant don à l’État, par lettres patentes, de ses pierres les plus estimées, était à l’origine du trésor des joyaux de la Couronne.
La plupart des parures provenaient d’Anne de Bretagne, qui les tenait de Marguerite de Foix.
Il y avait notamment un diamant connu au XVIème siècle sous le nom de la « Belle Pointe ».
Plus célèbre encore,
un rubis de 206 carats portait le nom de
« Côte de Bretagne ».
Son sort avait été lié à deux autres gros rubis qui, après bien des aventures lors des guerres de Religions et plus tard encore, réintégrèrent le mobilier de la Couronne grâce à Colbert.
La « Côte de Bretagne », pierre brute, fut portée par les souverains, taillée en dragon tenant la Toison d’Or dans sa gueule.

Sous le règne d’Henri IV, apparut un personnage dont le nom demeure lié à l’histoire des diamants de la Couronne : Nicolas Harlay de Sancy.
Il possédait plusieurs diamants sur lesquels il empruntait des sommes considérables qu’il mettait à la disposition du roi.
L’un des joyaux reçut son nom (le Sancy) ; il fut vendu à Jacques Ier, roi d’Angleterre.

Lors de la Révolution anglaise, Henriette de France, fille d’Henri IV, sieur de Louis XIII et épouse de Charles Ier d’Angleterre l’emporta avec elle.
Pressée d’argent, elle donna en gage en 1655 en même temps qu’un autre, le « Miroir du Portugal », au duc d’Épernon.
La reine les racheta peu après tous les deux pour les vendre en 1657 au cardinal de Mazarin qui, a sa mort les laissa à Louis XIV avec seize autres diamants de premier ordre.
Au XVIIIème siècle, deux pierres extraordinaires entrèrent dans le trésor : le « Grand Diamant bleu » et le diamant de la maison de Guise.
Quand au fameux « Régent » visible au musée du Louvres, l’achat, en 1717, en a été conté
par Saint-Simon dans ses « Mémoires ».
Lors du sacre de Louis XV, on le plaça au centre du bandeau de la couronne, elle-même surmonté d’un fleur de lys dont la pierre centrale était le « Sancy ».
A la veille de la Révolution et jusqu’en 1792, la garde des objets de la Couronne était assuré par le sieur Thierry, issu d’une famille d’ancienne et haute domesticité.
La protection de Louis XVI, dont il était l’un des quatre premiers valets de chambre, lui avait permis de constituer une fortune immense .
Sous ses ordres venait immédiatement Lemoine-Crécy, son beau-frère, qui possédait la charge de garde général de la Couronne. A partir de 1789,
Thierry délaissa sa baronnie de Ville-d’Avray pour occuper avec toute sa famille des somptueux appartement aménagés au Garde-Meuble même, dans l’actuel ministère de la Marin.
Trois jours avant la tentative de fuite de la famille royale, en juin 1791, l’Assemblée décide de faire procéder à l’inventaire complet des bijoux et diamants du Garde-Meuble.
Remis en septembre 1791, le rapport d’inventaire, comparé au précédent, révéla que le trésor avait perdu de sa valeur sous le règne de Louis XVI.
C’est seulement en 1792 que Thierry est appelé à la barre de l’Assemblée pour répondre de l’état du Garde-Meuble.
Il lui est enjoint de se tenir « aux ordres des commissaires » :
c’est un avertissement à cet administrateur d’Ancien Régime soupçonné d’infidélité.
On commence à craindre que le trésor ait été confié à des gardiens peu fidèles ou susceptibles de se laisser séduire : comment expliquer autrement la provenance des énormes subsides distribués depuis 1790 dans un but contre-révolutionnaire ?
A divers objets il manque des portions d’or, des perles ou des pierres précieuses.
Le bruit court alors - et on est aujourd’hui fondé à le croire - que Thierry aurait, sous le couvert de réparations ou de retaille, vendu en secret des diamants à l’étranger.
Une note détaillée (AN, T 399) dans les papiers de Lemoine-Crécy, révèle comment ce dernier marchandait des diamants avec les joailliers hollandais, par l’intermédiaire des fameux banquiers Vandenyver.
La famille royale avait, il est vrai, une fâcheuse tendance à confondre ses bijoux personnels avec ceux de la Couronne : en effet, si les monarques en avaient la libre disposition - les diamants notamment servait à gager les emprunts - ils n’avaient nullement la propriété de ces objets.
En 1785, Marie-Antoinette avait tant et si bien modifié la monture d’une parure de rubis qu’il fut bientôt impossible de distinguer ce qui était du Garde-Meuble et ce qui lui appartenait.
Elle avait, pour finir, obtenu du roi que la parure entière lui fut donnée en propre.
Le journaliste Gorsas se fit d’autre part l’écho
dans son « Courrier » de la maladresse insigne
de Marie-Antoinette qui avait emporté le « Sancy » avec elle lors de l’épisode de Varennes.
Dès lors, on trouve fréquemment dans les rapports les plus officiels, la mention d’arrestations, par diverses municipalités, de cargaisons de bijoux et de pierres précieuses en route, semble-t-il, pour l’étranger.
Le navire « La Jeune Cécile » est arrêté à Quillebeuf avec une cargaison de bijoux destinée à la reine de Portugais.
Le Comité des Recherches est alerté d’autre part sur « L’opportunité de garder la maison [château]
de M. Thierry de Ville-d’Avray […] pour empêcher qu’on ne la pille et qu’on en puisse distraire les diamants de la Couronne susceptibles de s’y trouver » (AN D XXIX, 36, dossier 375).
Dans un tel contexte, alors que les lois sur les biens des émigrés, votées par l’Assemblée en mars-avril 1792, s’efforcent de mettre sous surveillance les biens les plus précieux et les plus aisément transportables pour les empêcher de passer en pays ennemi, il est impensable que, dans l’entourage du roi, on ne se soit pas interrogé sur la destination des diamants de la Couronne en cas d’événement grave.
Dès le 20 juin 1792, si l’on tient au rapport d’enquête, « Louis Capet, voulant mettre à l’abri tous les diamants et richesses déposés au Garde-Meubles, fit engager l’épouse du sieur Lemoine-Crécy, par Thierry son valet de chambre, à enlever dudit Garde-Meuble tous ces objets et à les cacher dans une armoire pratiquée dans le mur de son alcôve, derrière le chevet du lit, ce qui fut fait ».
Un artisan menuisier au service de Thierry avoue d’ailleurs aux autorité qu’il s’est « chargé de faire faire des cachettes en divers endroits du Garde-Meuble et dans les châteaux [Ville-d’Avray et Montregard] de Thierry » et a « pareillement établi des petits coffres-forts pour des voitures, pour que le citoyen Thierry puisse plus commodément porter de l’or à Valenciennes... » (AN F7 4774.90).
Le dimanche et le lundi précédent le 10 août 1792, qui marque la fin de la monarchie, six malles sortent furtivement du Garde-Meuble.
Elles appartiennent au gendre de Thierry, Baude de Pont-l’Abbé, et sont acheminées par Azèle, son homme de confiance, chez Prévost d’Arlincourt, ex-fermier général qui, comme la plus part de ses anciens collègues, avait fait passer des fonds en territoire ennemi.
Que contiennent ces malles ? Nul ne le sait.
Au Garde-Meuble, on s’attend à un événement d’importance.
Aux Tuileries également, on brûle du courrier, des archives, et on attend.
Le 10 août, tandis que les combats font rage dans la cour du château des Tuileries, tandis que l’Assemblée déclare le roi suspendu, la Commune insurrectionnelle prend diverses mesures d’urgence, notamment celle de poser des scellés au Garde-Meuble.
Bien que les actes et les registres aient été détruits, on sait que le citoyen Jean-Bernard Restout (1732-1795), commissaire de la section des Tuileries, qui se chargea de le faire, en présence de Thierry et de Lemoine-Crécy, le 11 août.
Mais demeure une inconnu, et non des moindres : les grands diamants étaient-ils toujours dans leur coffre ? Il semble qu’aucune vérification n’ait été faite puisque, c’est seulement le 14 août que l’Assemblée décide de procéder à un inventaire du Garde-Meuble.
Thierry est arrêté le 14 août et c’est son beau-frère, Lemoine-Crécy, qui assure l’intérim de la garde du Mobilier national.
Le successeur de Thierry est nommé par Roland, le ministre de l’Intérieur : son choix, sur la recommandation de l’énigmatique Pache, s’arrête sur … Restout. Il entrera en fonction sitôt l’inventaire effectué.
A partir de ce moment, les événements sont de plus en plus troublants, à la fois par la lenteur avec laquelle l’opération est menée et par une série de coïncidences incitant à penser que toutes les mesures avaient été prises pour favoriser un vol providentiel, rendant inutile toute vérification.
Le 31 août 1792, des commissaires nommés par l’Assemblée des joailliers parisiens - hostiles à la Révolution -, Lemoine-Crécy et Restout se réunissent au Garde-Meuble.
Troublé, Lemoine-Crécy déclare d’emblée que « lors de l’apposition des scellés par les commissaires de la Municipalité sur une des portes de lui, sieur Crécy, il avait déclaré que pour plus grande sûreté, il avait cru devoir retirer de la salle des bijoux les diamants dit de la Couronne pour les déposer dans un cabinet attenant à son appartement ».
On lit en effet dans le procès-verbal qu’il fit retirer de son appartement neuf coffrets fermés qui furent, en présence des commissaires, replacés dans la salle des bijoux. La suite est reportée au lundi suivant. Cette journée est tout entière consacrée, non pas à l’inventaire des diamants, mais à celui des objets en bronze.
Le lendemain c’est le tour des pièces d’orfèvrerie, et ainsi de suite jusqu’au 6 septembre, date du dernier procès verbal d’inventaire.
Ce jour-là, les neuf coffrets censés contenir les diamants n’ont toujours pas été ouverts.
Pour des raisons obscures, les choses traînent de plus en plus : tel joaillier convoqué pour la séance suivante n’est pas là - il prétend n’avoir pas reçu d’ordres -, si bien que le vol du Garde-Meuble a lieu quelques jours après sans que personne, même pas le ministre de l’Intérieur Roland, ne sache ce que renfermaient les neuf coffrets de diamants retrouvés fracturés et vides.
En novembre, le procès des « petits voleurs » a lieu. On avait retrouvé sur eux que quelques diamants. Au reste, si l’on compare le nouvel inventaire, (Archives de Paris DU1 29), fait le 8 janvier 1793, à celui de 1791, il apparaît qu’il restait bien peu de chose du trésor de la ci-devant Couronne de France.
Ce qui surprend aussi, c’est la facilité avec laquelle les « petits voleurs » se sont introduits dans le Garde-Meuble, l’enquête montrant que l’opération se déroula même en trois nuits consécutives, du 13 au 16 septembre 1792, date à laquelle une patrouille les prit en fait.
On s’étonne encore que, malgré les réclamations de Restout auprès de Santerre, commandant de la Garde nationale de Paris, la surveillance n’ait pas été renforcée : il n’y avait, le 9 septembre, que six homme au lieu de vingt, comme prévu, autour du Garde-Meuble : il ne s’en trouvait que « quatre à cinq au poste du côté droit de la rue Saint-Florentin, qu’un seul » (AN, F7-4774 90 V p.11).
Restout est-il sincère et ses « réclamations » ne sont-elles pas destinées à le couvrir ?
Les déclarations d’un garde, Michel, au Tribunal révolutionnaire, en 1794, jettent un doute : il indique à Fouquier-Tinville comment, la veille du vol, vers onze heure du soir, Restout l’a fait monter dans ses appartements pour lui recommander de « laisser ses portes ouvertes en posant une sentinelle à la porte [sic], à quoi Michel a dit qu’il ne pouvait pas ».
De l’interrogatoire, il ressort encore un peu plus tard, qu’on lui a offert du vin et que, un peu plus tard, on l’a fait descendre un étage plus bas, dans un salon élégant, où il y avait plusieurs femmes « qui se mirent à vouloir l’amuser en le caressant de toutes manières possibles [..]
Ferme dans les principes, il ne fut pas tenté d’écouter les dames du second [non plus] que les messieurs du troisième » (AN, W 376, p. 67 à 66). Soupçonné de connivence avec les véritables voleurs du Garde-Meuble, Restout est arrêté en 1793 et « oublié » en prison, jusqu’au 9 thermidor, date à laquelle il est libéré.
Il mourra un an après. Thierry de Ville-d’Avray, arrêté en août 1792, est massacré à la prison de la Force le 6 septembre.
Le citoyen Duvivier, parent de Mme Lemoine-Crécy et fondé de pouvoir du mari de celle-ci, est reconnu coupable « d’avoir distrait des objets du Garde-meuble » et condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire.
Son exécution est suivie, en prairial, par celle de Mme Lemoine-Crécy, impliquée dans la « conspiration de l’étranger », puis par celle d’Alexandre Lemoine-Crécy, en messidor. Leur dossiers d’instruction sont décevants car les interrogatoires qu’ils subissent, au moins officiellement, sont restés confidentiels.
Curieusement, c’est plusieurs mois après son arrestation que Lemoine-Crécy, protégé, semble-t-il par Fabre d’Églantine, fut identifié par le Comité de sûreté général comme étant « beau-frère de Thierry » et comme ayant été « détenteur des diamants du Garde-meuble » (AN, AF+ 11 290, F°70). Mais où donc sont passé les diamants ?
La thèse officielle - celle des petits voleurs du 16 septembre - à laquelle, faute de mieux, Roland dut souscrire et que les girondins, soupçonnés, traînèrent comme un boulet, donna le champ libre aux interprétation des agents royalistes.
La duchesse de Fleury, agent de l’Angleterre, parle du député Carra, envoyé par Danton pour remettre au duc de Brunswick « grand amateur de diamants », quelques exemplaires des diamants de la Couronne : tout cela « à la connaissance de Danton et du vertueux Roland qui, pour une fois, paraît avoir su tenir sa langue devant sa femme »
(Journal, Paris, 1981, p 80).
Le comte d’Allonville, lui, raconte comment un autre député, Billaud-Varenne, fut envoyé en grand secret auprès de Brunswick pour « acheter » la victoire de Valmy
(Allonville, « Mémoires secrets », Paris 1838).
Selon lui, le produit des pillages des Tuileries et du Garde-Meuble aurait été utilisé par Danton, ministre de la Guerre en septembre 1792, pour corrompre le général prussien. Mais la propagande contre-révolutionnaire trouve aussi trace des diamants de la Couronne dans la valise de l’ambassadeur français de Sémonville enlevé par les Autrichiens alors qu’il était en route vers Constantinople pour acheter la neutralité de la Turquie …
Plus extraordinaire est la thèse lancée par l’auteur anonyme de
l’ « Histoire secrète de l’espionnage pendant la Révolution » (Francfort, 1799, p 141) : « S’il est possible de croire un coquin qui en accuse un autre, on doit soupçonner Pétion [le maire de Paris] et Manuel [procureur syndic de la Commune] d’avoir dirigé le vol du Garde-Meuble. Fouquier-Tinville en donne au moins une preuve marquante dans son exposé contre Manuel :
« Tous les auteurs du vol arrêtés, dit-il, ont été reconnus pour avoir été relâché des prisons dans les journée des 2 et 3 septembre ;
c’étaient dont des voleurs adroits épargnés à dessin ». »
L’accusation lancée contre Pétion est pareillement développée dans la dénonciation inédite d’une prisonnière des geôles de la Terreur, la citoyenne Ferniot, qui semble avoir joué le triste rôle d’indicatrice. Elle accuse ouvertement Pétion et l’administrateur de police Samson du Perron d’avoir favorisé sinon organisé le vol avant le 10 août 1792.
Sous sa plume apparaissent encore les noms de Collenot d’Angremont et des ducs de Brissac et de Broglie qui seraient chargés de mettre en lieu s^r le précieux dépôt.
« Après cette affaire faite, le restant du Garde-Meuble entre les mains des voleurs de Paris ». Avec toues les réserves qui conviennent sur la crédibilité d’un témoignage, celui-ci n’en confirme pas moins Pétion, le maire de Paris, entretenait secrètement jusqu’au 10 août, des relations privilégiés avec la famille royales.
C’est ainsi qu’il pourrait avoir aidé au succès de l’opération. D’autres personnages, Soltho-Douglas, Samson du Perron et Delattres
((d’après lesTouchard-Lafosse in Souvenirs, 1840, III, p 259) qui était chargé de l’inventaire de 1791) avaient, quant à eux, partie liée avec la contre-révolution royaliste que Collenot d’Angremont avait montée à l’instigation des Tuilerie.
Santerre lui-même qui comme Pétion, aurait été acheté par des conseillers occultes de Louis XVI pour empêcher le 10 août, avait fait preuve d’une négligence des plus suspectes en ce qui concerne la surveillance du Garde-Meuble.
Le 20 frimaire an II, Voulland, membre du Comité de sûreté général, déclara à la Convention la découverte (sans préciser chez qui, par qui et comment) du plus beau diamant, le « Régent ».
Trois mois après, le Comité de sûreté général assurait avoir découvert le « Sancy » et quelques petits diamants de moindre importance. Mais les doutes subsistent : le 4 avril 1794, la Commission temporaire des Arts charge le citoyen Nicot d’assurer la « vraie estimation » des diamants. Le rapport, en date du 25 floréal, est imprécis et ne comporte que des généralités :
« Il est évident que les puissances coalisées n’ont cessé, depuis la Révolution, de nous enlever par le moyen de leurs agents les trois quarts des objets les plus précieux que nous possédions en ce genre, et cela dans l’espérance de nous les revendre le double du prix de leur acquisition. »
Quelques jours plus tard, Cambon monte à la tribune et déclare à la Convention : « Vos Comités de salut public, des finances et de sûreté générale vous prient d’ordonner le levée des scellés apposés sur le diamant qu’on croit être celui qu’on appelait « Pitt » (l’autre nom du « Régent ») et qui était estimé à douze millions » à des fins d’expertise. Le rapport, confidentiel, n’est pas connu, ce qui évidemment jette un doute sur la valeur des trouvailles du Comité de sûreté générale.
C’est seulement après la Révolution qu’une partie seulement du Trésor fut reconstitué. Racheté, échangé, saisi chez un particulier ? On s’interroge encore sur la date et les circonstances dans lesquelles le « Régent » réintégra le Trésor.
En l’an IV, les fournisseurs étrangers exigeaient des garanties : le « Régent » fut consigné à la banque de Bâle au profit du banquier berlinois Treskow, fournisseur de chevaux, qui fut désintéressé en fructidor an VI (août 1798).
La pierre fut presque aussitôt remise en gage au profit d’un banquier hollandais qui la garda jusqu’en ventôse an IX (mars 1801). Le « Sancy » passa successivement entre les mains du marquis d’Iranda, puis de Godoï et du roi d’Espagne qui, pour les besoins de la guerre, le vendit à la famille Demidoff.
D’autres pierres furent fractionnées, vendues, dispersées et font, encore aujourd’hui, sous une taille différente, la fierté de collections étrangères. Le « Grand diamant bleu », qu’on retrouve au XIXème en Angleterre, a été acheté en novembre 1984, pour la somme record de 4,6 millions de dollars (idem euros) par un marchand arabe lors d’une ventes aux enchères à Genève.
En tous points, le vol des diamants de la ci-devant Couronne fut un succès pour ses organisateurs : girondins et montagnards se montrèrent incapables de surmonter leur antagonisme pour rechercher les vrais coupables, se bornant à se relancer périodiquement la responsabilité du vol.
Il eût d’ailleurs été peu habile de donner un retentissement particulier à cet événement, sans importance en soi, - mais dont la nature risquait de contrarier singulièrement l’opinion. L’affaire fut donc « enterrée », d’autant plus vite que, dès novembre 1792, la découverte de « l’armoire de fer » et la perspective du jugement de Louis XVI mobilisaient l’attention des uns et des autres.

Les grands diamants de la Couronne de France.
Nom Poids taillé Origine Dernière localisation Le Régent ou le Pitt 136 carats Indes - France : 1792 - Réapparaît après la Révolution - Réintègre le Trésor sous l'Empire. Le Miroir du Portugal ? Indes - France : 1792 Le Grand Diamant Bleu ou le Hope 68 carats --- XVIII ème siècle 44 carats --- XIX ème siècle Indes - France --- 1792 - Angleterre : XIX ème siècle - États-Unis : 1958 - Vendu à Genève 14,6 millions de dollars : 1984 Le Sancy 53 carats ? - France : 1792 - Espagne : XIXème siècle - J. Demidoff : 1828 - Maharadjah de Patialia : 1865 - France : 1936 Le Diamant de la maison de Guise ? Indes - France : 1792 SOURCES
http://www.lodace.net/histoire/document/diamantsdelacouronne.htm
 votre commentaire
votre commentaire
-

Sophie-Béatrice de France (1786-1787)
Marie Sophie Hélène Béatrice de France, née à Versailles le 9 juillet 1786, morte à Versailles le 19 juin 1787, dite « Madame Sophie », fut le dernier des quatre enfants du roi de France Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette.

On n'évoque peu la petite Sophie morte à seulement onze mois, j'aurais voulu savoir pourtant comment s'est déroulée cette tragédie
(était elle malade dès sa naissance ?
Son accouchement fut il difficile ?
La reine eut elle une dépression suite à la perte de son enfant ?)
En outre, Louis Joseph a-t-il eu une maladie génétique comme certains l'affirment, et d'ailleurs cette anomalie génétique (un peu comme les fils de Catherine de Médicis) se serait également développée chez Louis Charles ?
petite Sophie était née mal formée. Elle avait, paraît-il, la tête trop grosse.
Le 1er août 1787, Marie Antoinette écrit à la princesse de Hesse-Darmstadt : J'ai été bien sensible de la part que vous avez prise à la perte que j'ai faite de ma fille cadette. J'en ai été très affligée.
Malheureusement, presque depuis sa naissance je m'y attendais, cette enfant n'ayant jamais profité ni avancé pour son âge (cf. Lever, p. 848).
Une autopsie fut réalisée, qui révéla que les poumons de la petite fille étaient très atteints.Toujours est-il que la reine fut très triste, elle dit même que cet enfant aurait pu devenir une amie.
Pour les garçons, tout ce que je sais, c'est que la tuberculose était dans la famille Bourbon.Louis Auguste enfant en avait souffert, mais le bon air de Meudon l'avait guéri.
C'est de tuberculose osseuse que Louis Joseph est mort.
Qu'en était-il de Louis Charles ?
Marie Antoinette a beau se réjouir de sa constitution solide, qui le rend frais et rose comme un enfant de paysan, certains auteurs considèrent qu'il souffrait du mal qui emporta son frère dès l'arrivée au temple.
Certains vont même jusqu'à envisager
qu'il pourrait être mort avant le 8 juin 1795.

 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Dona Rodrigue dans La MODE de la COIFFURE, des PERRUQUIERS au XVIIIè siècle le 21 Juillet 2012 à 12:37

Vous remarquerez, que les hommes portent des peignes dans leurs perruques...
Si vous regardez bien ce tableau vous y verrez des dames qui semblent proposer des tissus ou dentelles, et l'homme au peigne pourrait être le coiffeur qui fouille dans un petit panier avec son aide... il viendrait de coiffer la Reine et à "rangé" son peigne pour une retouche éventuelle !!!!!!

L'étiquette ne permettait pas à des commerçants de tout poil d'entrer dans la chambre de la Reine et je pense que ce tableau est une "fantaisie" pour montrer le peintre travaillant à sa toile et son épouse (qui n'avait pas le droit d'entrer)
présente un placet à la Reine !!!!!!

Michèle SAPORI avec qui j'ai eu une grande conversation au sujet de l'étiquette pour les essayages de la Reine lors de livraison des grands habits !!!!!!!
serait d'accord sur la présence de ROSE BERTIN dans la chambre - portes fermées - avec quelques dames intimes et femmes de sa Maison !!!!
La Méridienne est trop petite - bonne pour le choix des tissus et des bonnets !!!!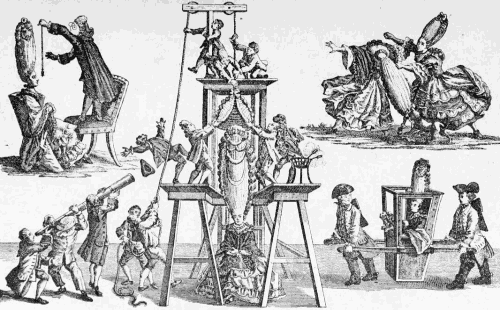
Le cabinet doré, plus grand - est très juste pour une petite compagnie regardant la Reine dans ses nouveaux atours - paniers - queue et modifications etc....
http://www.lamesure.fr/rubriques/modesmetiers.html
Mouches, souliers souples en maroquin de couleurs tranchantes, et surtout coiffures changeant de mode plus souvent encore que les chaussures, aux formes surprenantes, aux proportions démesurées et à la composition bigarrée : tels étaient les atours dont se paraient les femmes du monde au XVIIIe siècle, le temps passé pour élaborer quotidiennement leur parure du jour rivalisant avec celui de la toilette de nuit.

Le XVIIIe siècle fut le siècle du luxe non seulement en France, mais dans presque toute l’Europe et en Angleterre notamment où les artifices de la toilette avaient pris un tel développement que le grave Parlement anglais rendit le singulier arrêt suivant :
« Toute femme de tout âge, de tout rang, de toute profession ou condition, vierge, fille ou veuve, qui, à dater du dit acte, trompera, séduira ou entraînera au mariage quelqu’un des sujets de Sa Majesté, à l’aide de parfums, faux cheveux,, crépon d’Espagne (sorte d’étoffe de laine imprégnée de carmin et encore employée aujourd’hui comme rouge sous le nom de fard en crépon) et autres cosmétique, buses d’acier, paniers, souliers à talons et fausses anches, encourra les peines établies par la loi actuellement en vigueur contre la sorcellerie et autres manœuvres ;
et le mariage sera déclaré nul et de nul effet. »
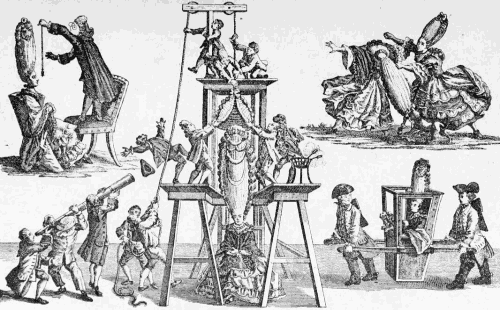
Caricature sur la mode au XVIIIe siècle Les législateurs français n’eurent pas le mauvais goût de se montrer aussi barbares et cependant quel luxe et quels artifices de toilette chez les femmes du XVIIIe siècle. Un écrivain de l’époque, Dufresny, comparait les femmes à des oiseaux amusants qui changent de plumage deux ou trois fois par jour. Il ne disait pas assez.
Au XVIIIe siècle, une femme à la mode essayait tous les jours quatre ou cinq espèces de toilette : toilette du matin, ou négligé galant, toilette pour la promenade, toilette pour le spectacle, toilette pour le souper, toilette de nuit, et cette dernière toilette n’était pas la moins riche, ni la moins compliquée.
L’invention la plus étrange que la mode ait jamais imaginée, dit le bibliophile Jacob, celle des mouches, fut remise en faveur avec une telle exagération que le visage des femmes, suivant l’expression d’un critique de mauvaise humeur, rassemblait tous les signes du zodiaque.
Les mouches de taffetas noir gommé, en effet, étaient taillées en lune, en soleil, en croissant, en étoile et en comète. Elles avaient existé à la cour de Louis XIV pour faire ressortir la blancheur de la peau, mais on n’en faisait pas abus et même les femmes brunes de teint se gardaient bien d’en mettre.
On n’en portait presque plus quand la duchesse du Maine leur rendit la vogue ; ce fut alors, pour ainsi dire, le cachet d’une belle peau et l’accessoire indispensable du jeu de la physionomie. Il y avait un art particulier pour placer ces mouches aux endroits les plus favorables du visage : sur les tempes, près des yeux, au coin de la bouche, au front.
Une femme du grand monde en avait toujours sept ou huit et ne sortait jamais sans emporter sa boîte à mouches pour remplacer celles qui viendraient à se détacher et pour en ajouter de nouvelles selon la circonstance.
Chacune de ces mouches avait un nom caractéristique : au coin de l’œil, la passionnée ; au milieu de la joue, la galante ; sur le nez, l’effrontée ; près des lèvres, la coquette ; sur un bouton la receleuse.
Qui nous rendra ce piquant artifice des mouches ! Qui sait tout le charme imprévu que ce petit ornement peut donner à la physionomie d’une femme. Revenir aux mouches serait, assurément moins ridicule et infiniment plus gracieux que le retour aux paniers, sous le nom de crinolines.
Le XVIIIe siècle donna surtout un merveilleux essor à deux industries de toilette qui furent considérées comme des arts véritables : la chaussure et la coiffure.
Le cordonnier pour femmes était devenu presque un artiste qui fabriquait des souliers si mignons et si souples, en cuir mordoré, en maroquin de couleurs tranchantes et surtout en étoffes d’or et d’argent et toujours à talons pointus rehaussés de trois ou quatre ponces, que la chaussure formait une des pièces les plus raffinées de l’habillement.
Le prix de ces souliers de grand luxe, fermés par des boucles d’or ou d’acier à facettes, égalait celui des bijoux. Le roi des cordonniers d’alors, grâce à la protection de la célèbre Mme du Barry, était un Allemand nommé Efftein, auquel succéda un Français nommé Bourbon.
Coiffure à la Belle Poule Les coiffures changeaient de mode plus souvent encore que les chaussures, et le nombre des coiffeurs de dames n’avait pas cessé de s’augmenter depuis la Régence, tellement qu’on n’en comptait pas moins de douze cents à Paris, quand la communauté des perruquiers leur intenta un procès, en 1769, comme à des faux frères et à des concurrents déloyaux.
Les coiffeurs de dames firent une belle défense ; leur avocat publia un mémoire tout à fait piquant où il rabaissait les prétentions des maîtres barbiers-perruquiers :
« L’art du coiffeur des dames, disait-il, est un art qui tient au génie et, par conséquent, un art libéral et libre. L’arrangement des cheveux et des boucles ne remplit même pas tout notre objet.
Nous avons sans cesse sous nos doigts les trésors de Golconde ;
c’est à nous qu’appartient la disposition des diamants, des croissants, des sultanes, des aigrettes. »
Au portrait du coiffeur des dames, le factum opposait le portrait caricaturé du perruquier : « Le perruquier travaille avec les cheveux, le coiffeur sur les cheveux. Le perruquier fait des ouvrages de cheveux, tels que des perruques, des boucles ; le coiffeur ne fait que maniérer les naturels, leur donner une modification élégante et agréable. Le perruquier est un marchand qui vend la matière et son ouvrage ; le coiffeur ne vend que ses services. »
Les coiffeurs l’emportèrent et les perruquiers perdirent leur procès. On vit alors le coiffeur Legros instituer une Académie de coiffure et publier un gros livre à figures intitulé : l’Art de la coiffure des dames françaises.
Un autre coiffeur, Léonard, le rival de Legros, imagina de remplacer le bonnet qui couronnait la coiffure des dames par des gazes et des chiffons artistement distribués dans les cheveux : il parvint ainsi à employer dans une seule coiffure quatorze aunes de gaze.
Ce fut Léonard qui créa les coiffures extraordinaires et magnifiques que la mode imposa pendant plus de dix ans à toutes les têtes :

la coiffure à la dauphine dans laquelle les cheveux étaient relevés et roulés en boucles qui descendaient sur le cou ;
la coiffure à la monte-au-ciel, remarquable par son élévation pyramidale ; la coiffure loge d’opéra qui donnait à la figure d’une femme soixante-douze pouces de hauteur depuis le bas du menton, jusqu’au sommet de la figure et qui divisait la chevelure en plusieurs zones,
chacune ornée et agencée d’une manière différente, mais toujours avec un accompagnement de trois grandes plumes attachées au côté gauche de la tête dans un nœud de ruban rose chargé d’un gros rubis ;

la coiffure à la quesaco avec trois plumes derrière la tête ; la coiffure en pouf c’est-à-dire n’ayant pas d’autre ordre que la confusion d’objets divers, plumes, bijoux, rubans, épingles qui entraient dans sa composition.
On accumulait, dans cette incroyable coiffure, des papillons, des oiseaux, des amours de carton peint, des branches d’arbres, des fruits et... et même des légumes ! Au mois d’avril, la duchesse de Chartres, fille du duc de Penthièvre, parut à l’opéra, coiffée d’un pouf à sentiment, sur lequel on voyait le duc de Beaujolais, son fils aîné, dans les bras de sa nourrice, un perroquet becquetant une cerise, un petit homme noir de peau, et des dessins à chiffres en cheveux, composés avec les cheveux mêmes des ducs d’Orléans, de Chartres et de Penthièvre.
Que d’autres coiffures non moins extraordinaires nous pourrions citer : les coiffures au temps présent, bonnets enjolivés d’épis de blé et surmontés de deux cornes d’abondance ; les coiffures au Colisée, à la Sylphide, au Hérisson, au Parterre galant, à la Belle-Poule, avec une vraie frégate sur la tête.
« Les coiffures parvinrent à un tel degré de hauteur, dit Mme Campan, par l’échafaudage des gazes, des fleurs et des plumes, que les femmes ne trouvaient plus de voilures assez élevées pour s’y placer et qu’on leur voyait souvent pencher la tête à la portière. D’autres prirent le parti de s’agenouiller pour ménager d’une manière encore plus sûre le ridicule édifice dont elles étaient surchargées. »

Caricature sur la mode en 1775 La toilette d’une jolie femme était une espèce de réception intime dans le sanctuaire où s’élaborait la coiffure, la déesse du lieu recevait son petit monde d’habitués, vêtue d’un simple peignoir de mousseline brodée et les cheveux épars, lorsqu’elle se mettait dans les mains du coiffeur, qui passait une heure et davantage à l’accommoder.
Si la toilette avait duré longtemps, dans la matinée et dans l’après-midi, la toilette de nuit était presque aussi longue que celle de jour, quoique personne n’y fût admis.

C’est qu’il s’agissait de défaire tout l’attirail de la coiffure, de peigner et de dépoudrer les cheveux ; .il s’agissait aussi de tenir conseil avec la femme de chambre pour savoir comment on s’habillerait le lendemain.
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article5696
http://curiosites-emmanuel.blogspot.fr/
 votre commentaire
votre commentaire
-
Exhumation des restes royaux en 1817

Exhumation des restes des rois et des reines de France dans le cimetière des Valois
par François Debret et Joseph François Heim.
Musée du château de Versailles © RMN
Les tombeaux royaux et princiers sont profanés durant la révolution française, entre le 6 août et le 25 octobre 1793.
Les corps de plus de 150 personnes sont précipités dans deux fosses communes creusées dans l’ancien cimetière des moines au Nord de la basilique.
Au total, les révolutionnaires y ont jeté les restes de :
- 43 rois
- 32 reines
- 63 princes du sang
- 10 serviteurs du royaume
- plusieurs grands abbés de Saint-Denis …
Ces restes humains vont rester enfouis dans ces deux grandes fosses pendant 23 ans.
En 1814-1815, après l’effondrement de l’empire napoléonien, la royauté est rétablie en France. Des royalistes dressent alors un tumulus à l’emplacement présumé (mais erroné !) des fosses.
Le 24 avril 1816, une ordonnance du Roi Louis XVIII décrète que les restes de toutes les tombes violées seront exhumés des fosses communes et déposés dans un caveau spécial, près des dépouilles mortelles présumées de Louis XVI et Marie Antoinette que l’on venait de rapatrier à Saint-Denis.
Il faudra des mois d’enquêtes pour retrouver des témoins des profanations de 1793. On interroge notamment Alexandre Lenoir et François-Louis Scellier qui s’était enrichi en transportant les monuments brisés.
Finalement, le 10 janvier 1817 les plans d’exhumation sont établis pour guider les ouvriers.
Les fouilles commencent dans le jardin le 13 janvier 1817 à 8 heures du matin, juste au Nord du transept (ancien cimetière des moines, avant la Révolution). L’atmosphère est lugubre.
Les travaux se font en présence de Charles-Henry Dambray, grand chancelier de France, ainsi que d’Alexandre Lenoir et de Scellier. On dispose d’un rapport détaillé, établi sous la direction de Dambray, et d’un rapport d’un certain M. de Geslin, 2° aide des cérémonies, qui a assisté à tout.
Or, les sondages dans le sol le 13 janvier ne donnent rien. Alors on interroge d’autres témoins à la mairie et on consulte les archives municipales. Les recherches se poursuivent jours et nuits sous une pluie incessante, la nuit à la lumière des torches qui éclairent le terrain. Quelques squelettes sont déterrés, rien de plus. Et dans l’ancien cimetière des moines, ce n’est guère étonnant.
Enfin, le 18 janvier ,tard dans la nuit, on découvre les deux fosses. On va trouver dans chacune un paquet de squelettes d’environ 3 mètres cube. On décide de creuser tout autour pour bien délimiter les énormes masses d’ossements compacts .
Quelques cercueils en bois peint en noir et fleurdelysés avaient été préparés pour les recueillir : un énorme sarcophage pour les Bourbons, quatre cercueils pour Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens directs et Valois.
Le rapport nous apprend que « les ossements étaient tous en état de dessication (…) et il était impossible d’y rien trouver entier (…) et dans l’ordre naturel, si ce ne fut les portions inférieures de trois corps gisant dans leur situation naturelle, en état complet de dessication comme tous les autres ossements, mais sans adhérence au surplus du corps dont elles avaient été séparées par l’affaissement des terres. »
[ NB. : cette phrase est assez délicate à interpréter. Sur la question de la tête prétendue d’Henri IV retrouvée en 2010, elle a été souvent invoquée. Je renvoie au sujet voisin concernant ce problème. ]
Un petit pavillon est transformé en chapelle ardente pour recevoir les cercueils.
M. de Geslin témoigne : « Un mélange inexplicable de sentiments de joie, de douleur et de respect animait toutes les personnes présentes (…). Un silence solennel règne partout, on n’entend que la voix seule du prêtre qui, récitant des prières semble inviter les augustes mânes d’abandonner le fonds de l’abîme où le crime les avait relégués.
C’est au milieu de ce calme majestueux et à la lueur d’une prodigieuse quantité de flambeaux disséminés sur la surface irrégulière du cimetière, c’est à cette lueur rendue plus terrible encore par les reflets des recoupes du terrain et surtout par l’immense édifice de l’église que s’est passée cette scène aussi belle, aussi grande que difficile à décrire. »
Puis le lendemain, 19 janvier 1817, les cercueils sont placés dans le caveau qui avait été aménagé dans la crypte.
Aucun membre de la famille royale n’assiste aux services célébrés ce jour-là. Toutefois, 90 000 francs furent dépensés pour que les cérémonies soient convenables.
Les ossements royaux et princiers furent finalement placés dans un ossuaire, dans l’ancien caveau du maréchal de Turenne. Ils y sont toujours.sources
http://saintdenis-tombeaux.forumculture.net/t64-exhumation-des-restes-royaux-en-1817
 votre commentaire
votre commentaire
-
Pour apprécier cette jolie vidéo - cliquer sur le logo central, en bas - colonne de gauche..
Le fond musical de ce blog sera supprimé


La destruction des maisons du pont Notre Dame, en 1786, par Hubert ROBERT, XVIII° siècle, musée Carnavalet, Paris
(les habitations étant insalubres, elles furent détruites sur l'ordre de Louis XVI.).

L'Accident
par Hubert Robert,Huile sur toile (22 mai 1733, Paris - 15 avril 1808, Paris) Hubert Robert est l'un des principaux artistesfrançais du XVIIIe siècle qui s’illustra notamment comme paysagiste, aquafortiste, dessinateur et à travers la peinture. Pendant la Révolution, il est arrêté en octobre 1793.

Détenu à la prison Sainte-Pélagie et à la prison Saint-Lazare, il y a survécu en peignant sur des assiettes des scènes de vie carcérale.

D’un caractère doux et modeste, Hubert Robert connut une vie heureuse et paisible qu’il termina à l’âge de 73 ans, d’une apoplexie.

Port orné d’architecture
Hubert Robert, 1769, Musée de Dunkerque

Hubert Robert a vécu à Rome et a bien connu Piranèse, qui lui a communiqué le virus des ponts sous les ponts. Au point que, revenu à Paris, il a quasiment recopié la gravure (en l’inversant dans un miroir), pour un tableau exposé au Salon de 1769, qui appartiendra au ministre Choiseul.Seule innovation importante, la lumière : chez Piranèse, le soleil très haut dans le ciel détachait tous les bossages de l’arche ; chez Hubert, celle-ci est vue à contre jour, le soleil bas se trouvant caché derrière un des pilier du second pont, très proche du point de fuite.
Diderot, dans ses salons, ne daigne pas dire un mot de cette oeuvre mineure : il est vrai qu’en dévoilant ce qui se trouve en avant et au dessus du pont, en fermant le premier plan par un quai encombré de figurants, Hubert a perdu la profondeur de champ vertigineuse et la rigueur fractale qui faisait la magnifiscence du pont de Piranèse.
La Bièvre
Hubert Robert, 1768, Collection particulière
Dans un autre tableau parisien de la même époque, Hubert Robert prend la Bièvre comme prétexte pour un remake, plus convainquant, du « ponte magnifico » en version « populo ». Cette fois, plus de bossages impeccables, de colonnes glorieuses et de statues. Le seul élement noble est une petite niche avec son fronton triangulaire, à l’aplomb du bec d’une pile : arcature miniscule et aveugle au dessus d’un élément de défense contre les flots, elle sert de faire-valoir à l’arche immense qui s’ouvre à côté, et au fleuve qui s’y engouffre.
Les leçons de Piranèse ont été bien apprises : l’arche qui sert de cadre à une enfilade d’autres, l’arche dans le lointain parallèle à la première, l’arche latérale par laquelle passe une barque. Même les linges qui pendent semblent rendre hommage aux plantes tombantes du maître italien.

L'écroulement des maisons du Pont Notre-Dame en 1499.
Tableau de Hubert Robert XVIIIè siècleLe Pont triomphal
Hubert Robert 1782-83
Quinze ans plus tard, Hubert Robert reprend le thème du pont sous le pont pour une commande conséquente (207 x 296 cm), destinée à la décoration du Palais de Pavlovsk. Une copie de taille réduite se trouve au musée de Valence.
Hubert s’est maintenant émancipé de l’inflence de Piranèse : il s’intéresse moins aux effets perspectifs qu’à ceux de l’ombre et de la lumière. Le point de fuite et le soleil sont exclus du tableau, relégués en hors champ, très à gauche : au lieu de fuir dans la profondeur, le tableau fuit latéralement.
Nous comprenons alors que nous sommes dans un bateau qui n’est pas en train de passer sous l’arche que nous voyons, mais sous l’arche de gauche que nous en voyons pas.
Dernier raffinement : la tente rouge de la barque, réplique en tissu des arches de pierre.
Architecture avec un canal
Hubert Robert, 1783, Musée de l’Ermitage, Saint Petersbourg
A l’apogée de son métier, Hubert nous livre un dernier avatar du thème, libéré de toute influence : ici les deux ponts sont réduits à une arche unique, tandis que les colonnes ont proliféré en largeur comme en profondeur. Le soleil, très haut en hors champ, est totament distinct du point de fuite, et l’effet de contre-jour est maximal, transformant en ombres chinoises tous les passants et toutes les barques : sauf justement celle à la tente rouge qui, baignée de lumière, se dirige vers le lointain.

démolition de la Bastille en 1789
Un Pont sous lequel on découvre les campagnes de Sabine (la Passerelle)
Hubert Robert, 1767, Philadelphia Museum of Art
Revenons en arrière, à la période italienne, pour un aperçu d’une autre branche du thème : celle des ponts campagnards. Dans ce tableau lumineux et aérée, Hubert Robert combine avec bonheur les deux mots d’ordre piranésiens : vive les ruines et gloire aux arches !
Voici comment, non sans exagération, Diderot le décrit dans le « Salon de 1767″ :
« Imaginez, sur deux grandes arches cintrées, un pont de bois, d’une hauteur et d’une longueur prodigieuses. Il touche d’un bout à l’autre de la composition, et occupe la partie la plus élevée de la scène. Brisez la rampe de ce pont dans son milieu, et ne vous effrayez pas, si vous le pouvez, pour les voitures qui passent dans cet endroit. Descendez de là. Regardez sous les arches, et voyez dans le lointain, à une grande distance de ce premier pont, un second pont de pierre qui coupe la profondeur de l’espace en deux, laissant entre l’une et l’autre fabrique une énorme distance. Portez vos yeux au-dessus de ce second pont, et dites-moi, si vous le savez, quelle est l’étendue que vous découvrez. Je ne vous parlerai point de l’effet de ce tableau. Je vous demanderai seulement sur quelle toile vous le croyez peint. Il est sur une très-petite toile, sur une toile d’un pied dix pouces de large, sur un pied cinq pouces de haut. »
Diderot a très bien vu que l’intérêt du tableau n’est pas dans les figurines anecdotiques qui peuplent le haut (les chevaux tirant les voitures) et le bas du pont (les femmes qui tirent un enfant qui attire un chien, tandis qu’un berger mène ses vaches à boire). Il est dans cette composition en abysse qui place un tableau dans le tableau, et un pont sous un autre pont.
Ce que Diderot n’avait pas mentionné, c’est l’aqueduc qui, dans le lointain, au delà de la forêt, fournit une troisième occurrence, démultipliée, du thème du pont sous le pont.
Le Pont Sur Le Torrent
Hubert Robert, vers 1785, collection privée
A l’apogée de sa carrière de décorateur et de peintre de ponts, Hubert Robert a réalisé un étonnant record : celui du plus grand tableau (616 x 416 cm) jamais passé en vente publique (Christies en 2010).
Sous le pont des bras
Ce monstre , commandé par le Duc de Luynes pour orner sa salle à manger, enjoliva ensuite la résidence secondaire du millionnaire William Randolph Hearst.

Pas étonnant que ce décor hypertrophié plaise aux puissants ! L’arche unique plantée sur les rochers s’enfle jusqu’à évoquer un arc en ciel sur fond d’orage ; le torrent s’arcboute sur les rochers jusqu’à devenir lui-même une sorte d’arche liquide ; enfin la courbe de la colline qui porte la résidence à l’italienne s’incurve en une troisième arche : emboîtement savamment conçu pour magnifier le château-résidence aux proportions d’une montagne.Les oeuvres de la nature et celles de l’homme rivalisent dans le grandiose. Et la puissance du riche, matérialisée par les tours du rempart et la grille qui ferme le pont, s’inscrit dans cette mise en scène avec la légitimité d’une force naturelle.
Au comble de son amour pour les Ponts, pour les Ruines et pour la Nature, Hubert Robert édifie ici une arche véritablement triomphale : à la gloire du Conquérant ou du Dieu anonyme dont la statue, comme chez Piranèse, se dresse au beau milieu du pont.
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Le saviez-vous ?.. l'invention de la mitraillette.... invention française.....
Le saviez-vous ?.. l'invention de la mitraillette.... invention française.....
C'est en En 1775, un ingénieur français, Du Perron, présenta au jeune Louis XVI un "orgue militaire" qui, actionné par une manivelle, lançait simultanément ving...t-quatre balles.
Un mémoire accompagnait cet instrument embryon des mitrailleuses modernes.
La machine parut si meurtrière au roi, à ses ministres Malesherbes et Turgot, qu'elle fut refusée et son inventeur considéré comme un ennemi de l'humanité.
Extrait du matin des magiciens! votre commentaire
votre commentaire
-

Savez-vous l'itinériare exacte de la Dauphine de Vienne jusqu'à Versailles et les villes traversées ?

On y voit bien les pièces françaises, les pièces autrichiennes, et la pièce centrale où
Marie-Antoinette a été "livrée" à la France
Concernant ce pavillon et son ameublement, il est dit que le meuble était disparate et venait de France... ce furent aussi les riches strasbourgeois qui fournirent des meubles et effet complétés par le garde meuble de la couronne.
En fait l'ameublement n'était pas du tout "conforme" à la symbolique de l'événement ( on avait même placé les superbes tapisseries mais celles représentant Médée !!! celle qui tua ses enfants....) et le pavillon de bois résista mal à la pluie car le jour de la remise certaines dames eurent l'impression à voir leurs vêtements trempées d'être dehors alors que la faute en revenait à la mauvaise toiture de bois du Pavillon.
Madame la DAUPHINE MARIE-ANTOINETTE est une jeune fille de 15 ans, au physique agréable, assez petite. Elle est blonde, ses yeux sont bleu pâle. Son visage, au vaste front bombé, offre un ovale un peu trop allongé mais la jeune DAUPHINE a, néanmoins, beaucoup de grâce.
son voyage .... son arrivée
Un itinéraire précis est donné dans le livre de Jallut et Huisman : Marie Antoinette quitte la Hofburg le 21 avril à 9h30 du matin.
Au début de l'après-midi, elle arrive à Melk.
Le lendemain, elle repart pour Enns, le 23, elle est à Lambach,
le 24 à Altheim,
le 25 à Alt Ettingen en Bavière, après avoir passé l'Inn.
Le 26 et le 27, Marie Antoinette est au château de Nymphenburg près de Munich.Le 28, elle gagne Augsbourg. Elle reste auprès de sa tante Charlotte de Lorraine à Günsburg jusqu'au 2 mai, parce qu'elle est enrhumée.
Le soir même, elle arrive à Riedlingen, sur le Danube,le 3, elle est à Stockach,
le 4, à Donaueschingen,
le 5 à Fribourg-en-Brisgau.
Le 6, le cortège atteint l'abbaye de Schütter près de Kehl.
Le 7 mai, Marie Antoinette est en territoire français, à Strasbourg, où est prévue la remise.
Elle repart le 8 sur la route de Paris, jusqu'à Saverne.Elle parcourt tout l'est de la France, par Nancy et Lunéville, Commercy, Châlons, Reims et Soissons et,
le 14 mai, elle est à Compiègne, pour y rencontrer le roi et le dauphin.

 votre commentaire
votre commentaire
-
Ces coussins et tissus sont réputés avoir été utilisés lors de la Cérémonie de remise sur le rhin.

 votre commentaire
votre commentaire
-
la reine se reposait dans sa salle de bains après s'être baignée, et que c'est la raison pour laquelle on y a placé le magnifique lit des bains livré par Boulard pour Louis XVI à Compiègne, et qui a conservé sa garniture d'origine :

La pièce présente d'ailleurs une dimension suffisante pour permettre ce double usage que l'exigüité des pièces du 1er étage n'autorisait pas. Et on voit mal la reine traverser sa bibliothèque peu chaleureusement vêtue au sortir du bain pour gagner son lit :s: .
Toujours est-il que le lit à palmettes livré par Jacob pour sa chambre du RDC a disparu .Versailles a cependant pu acquérir ces dernières années une partie des fauteuils, chaises et tabouret du même menuisier...



... ainsi que le secrétaire et la table de toilette livrés par Riesener pour cette pièce.
La commode de Benemann qui y est présentée est quant à elle d'un modèle quasi-identique à celle d'origine livrée par Riesener, car copiée pour Saint-Cloud avec une légère variante :
L'écran du même ensemble fait aujourd'hui l'orgueil de Jacques Garcia à Champs de Bataille. votre commentaire
votre commentaire
-
La passion de Marie Antoinette pour les planches remonte à sa plus petite enfance. Pratiquer les arts était chez les Habsbourg une tradition familiale et, à moins de quatre ans, l'archiduchesse Antonia, revêtue d'une somptueuse robe de cour, participe déjà à un petit spectacle en l'honneur de son père.
Plas tard, lorsqu'on songera à la préparer à sa future entrée à Versailles, on lui donnera pour professeurs deux acteurs, Aufresne pour la prononciation, nous révèle Madame Campan, et un nommé Sainville pour le goût du chant français. Choix qui déplaît à la cour de France...
Cet amour de la scène ne la quitta pas. Devenue dauphine, Marie Antoinette interprétait avec ses beaux-frères et ses belles-soeurs toutes les bonnes comédies du théâtre français, précise Madame Campan. Cette activité se passait dans le plus grand secret, pour échapper à la censure de Mesdames Tantes et à l'interdiction subséquente de Louis XV. Monsieur connaissait sa partie à merveille, le comte d'Artois ne se débrouillait pas trop mal, les princesses jouaient mal et Marie Antoinette avec finesse et sentiment. Quant au dauphin, il s'acquittait du rôle du public avec enthousiasme.
Lorsqu'elle obtient et remodèle Trianon, Marie Antoinette, fidèle à son amour de la comédie, décide d'y faire construire un théâtre. En 1777, elle demande donc à Mique de s'en charger, en s'inspirant de la salle du château de Choisy construite par Gabriel. Les travaux, commencés en juin 1778, prennent fin en août 1779. Comme à son habitude, la reine a surveillé les moindres détails de sa réalisation. Le théâtre ne sera toutefois inauguré qu’en août 1780.
Entrée du petit théatre, avec les colonnes ioniques et la scupture du fronton, due à Deschamps
Le bâtiment n'attire pas l'attention, car il devait être dissimulé entre une montagne artificielle et la charmille du jardin français. Mais les deux colonnes de style ionique, apparaissant au bout d'une allée d'arbres, signalent un édifice néoclassique. La sculpure en pierre qui orne le fronton triangulaire est consacrée à Apollon enfant entouré des attributs de la comédie et de la tragédie.Mais entrons...

Le vestibule d'entrée
L'intérieur est un véritable joyau.
La scène elle-même est pourvue de tous les perfectionnements.

La scène, récemment exploitée
http://www.fipa.tm.fr/fr/programmes/2007/mus_16187.htm
La salle est tendue de bleu. Partout, la reine a accordé une attention toute particulière aux tissus et aux drapés.
Les consoles du balcon figurent des dépouilles de lions, emblêmes des rois.
Le parterre est encadré de deux baignoires ceinturées de balustrades et d’un balcon au premier étage.
Le plafond est peint par Lagrenée.
Apollon, Melpomène et Thalie avec les Grâces et la Renommée montée sur Pégase et des amours tenant des guirlandes de fleurs
par Lagrénée, d'après Paulet
Aux temps troublés de la révolution, les visiteurs chercheront en vain les rivières de diamants coulant à flots dans cet adorable écrin bleu : si leurs dorures charment l'oeil, les décors sculptés sont en carton-pâte.
Décor de l'avant-scène, femme tenant une guirlande de fleurs sur fond de faux rideau, par Deschamps
Nulle part mieux, peut-être, que dans ce minuscule théâtre n'apparaît le goût exquis de Marie Antoinette, sa prédilection pour la beauté et l'intimité.
Torchère d'avant scène, par Deschamps
_________________Dans son petit théâtre bâti pour une souveraine à l'échelle humaine, Marie Antoinette sera tour à tour actrice et spectatrice. Avec ses proches, elle formera la Troupe des Seigneurs, qui jouera des pièces à la mode à l'époque.
Elle sera ainsi Colette dans Le Devin du Village de Jean Jacques Rousseau, elle se produira également dans des pièces de Sedaine, dont Grimm a consigné ses impressions dans son journal à la date du 20 octobre 1780 :
Les spectacles donnés ces jours passés dans la jolie salle de Trianon intéressent trop l'honneur... et la gloire de M. Sedaine pour ne pas nous permettre d'en conserver le souvenirs dans nos fastes littéraires. On n'a jamais vu, on ne verra sans doute jamais "Le Roi et le Fermier" ni "La Gageure imprévue" joués par de plus augustes acteurs, ni devant un auditoire plus imposant et mieux choisi. La reine, à qui aucune grâce n'est étrangère, et qui sait les adopter toutes sans perdre jamais celle qui lui est propre, jouait dans la première le rôle de Jenny, dans la seconde celui de la soubrette. Tous les autres rôles étaient remplis par des personnes de la société intime de leurs Majestés et la famille royale. M. le comte d'Artois a joué le rôle du valet dans la première pièce et celui d'un garde-chasse dans la seconde. C'est Caillot et Richer qui ont eu l'honneur de former cette illustre troupe. M. le comte de Vaudreuil, le meilleur acteur de société qu'il y ait peut-être à Paris, faisait le rôle de Richard; Mme la duchesse de Guiche (la fille de Mme la comtesse Jules de Polignac) dont Horace aurait bien pu dire "matre pulchra filia pulchrior" (une fille plus charmante encore que sa charmante mère) celui de la petite Betzi, la comtesse Diane de Polignac celui de la mère, le comte d'Adhémar celui du roi.
la scène sous la lumière ambiante
Si les mauvaises langues clament à la cantonnade que c'est royalement mal joué, on s'accorde à reconnaître que le niveau est estimable pour du théâtre d'amateurs, et même l'acariâtre Mercy ne trouve à ces divertissements pas grand chose à reprocher :
Depuis un mois, rapporte-t-il à son impératrice, toutes les occupations de la reine et tous ses amusements se sont concentrés dans le seul et unique objet de deux petits spectacles représentés sur le théâtre de Trianon. Le temps nécessaire à apprendre les rôles, celui qui a dû être employé à de fréquentes répétitions, joint à d'autres détails accessoires, a été plus que suffisant pour remplir les journées. Le roi, en assistant fort assidûment à tous ces apprêts, a donné preuve du goût qu'il prend à ce genre de dissipation... La reine a persisté dans la résolution de n'admettre d'autres spectateurs que les princes et les princesses de la famille royale, sans personne de leur suite. Je sais par les gens de service en sous-ordre, les seuls qui aient entrée au théâtre, que les représentations s'y sont faites avec beaucoup d'agrément, de grâce et de gaieté, et que le roi en marque une satisfaction qui se manifeste par des applaudissements continuels, particulièrement quand la reine exécute les morceaux de son rôle.
le théâtre dans la lumière ambiante
Mais ces spectacles se font, comme le souligne Mercy, en comité restreint. C'est ainsi que la reine répond au duc de Fronsac, qui espérait en vain une invitation, mais d’ailleurs je vous ai déjà fait connaître mes volontés sur Trianon : je n’y tiens point de cour : j’y vis en particulière. Les exclus ne tardent pas à se plaindre et à répandre les pires rumeurs sur les activités du petit théâtre.
Après la mort de Marie Thérèse, survenue le 29 novembre 1780, Marie Antoinette se retire et laisse la scène aux acteurs de la Comédie Française, de la Comédie Italienne et de l'Opéra. L’Iphigénie en Tauride de Gluck est montée en l’honneur de l’empereur Joseph II en 1781. En 1782, lors de la visite discrète du Tsarévitch, fils de Catherine II de Russie, on applaudira Zémyre et Azor de Grétry.
En août 1785, Marie Antoinette remonte sur les planches pour interpréter une excellente Rosine, selon les témoins, dans Le Barbier de Séville de Beaumarchais. Ce sera son dernier rôle. votre commentaire
votre commentaire
-
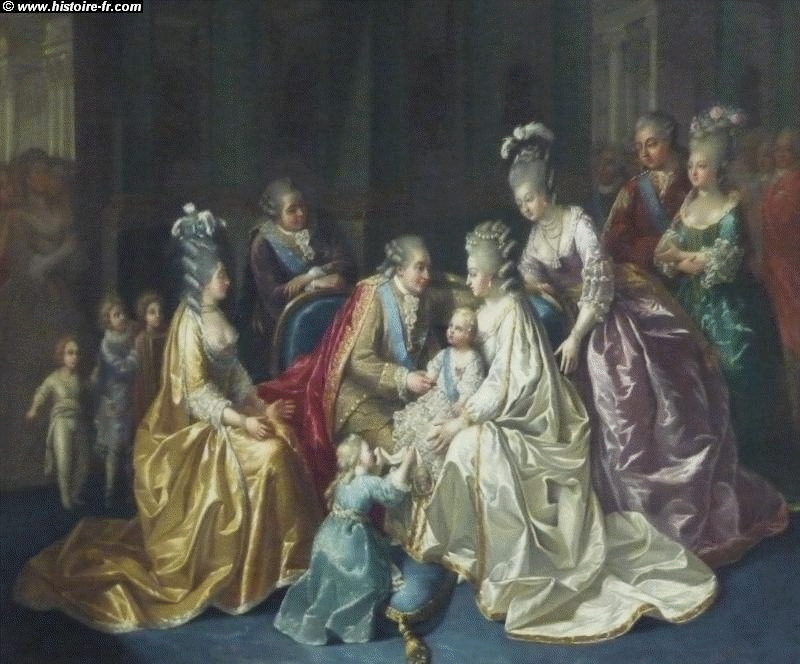
Les corps de Louis XVI et de Marie Antoinette
Louis XVI et Marie Antoinette furent guillotinés dans les circonstances que l'on sait les 21 janvier et 16 octobre 1793.
Les deux cadavres ont été enterrés en profondeur, recouverts de chaux vive, au cimetière de la Madeleine (emplacement de l'actuelle Chapelle expiatoire). Ils furent redécouvert 22 ans plus tard à la suite de recherches ordonnées par Louis XVIII, et portés par de solennelles funérailles en la basilique de Saint Denis où ils reposent aujourd'hui dans le caveau sous la crypte centrale.
Il n'est pas ici question de revenir sur ces événements qui nécessiteraient une étude très détaillée, mais de répondre à une controverse.
Il est en effet parfois dit que si le corps féminin reposant à Saint-Denis est bien celui de Marie Antoinette, il y aurait un doute pour celui de Louis XVI. On entend même certains commentaires des visites de la basilique être catégoriques : ce ne serait pas le corps de Louis XVI.
Revenons aux faits.
Etat de la crypte central de Saint-Denis (XIX° S. jusqu'en 1975) avant le nouvel aménagement de Formigé.Les cercueils de Louis XVIII et des siens, de Mesdames filles de Louis XV, de Louise de Lorraine (épouse d'Henri III), de Louis VII, de Louis XVI et de Marie Antoinette y étaient rassemblés en deux rangées sur des tréteaux. On les a descendus vers 1977 dans le caveau en dessous.
A la place ont été déposées des dalles de marbre noire avec les noms des princes .
On ne voit ici que la rangée de droite. Au fond de l'abside de la crypte, l'armoire des coeurs, aujourd'hui détruite.
On aperçoit les deux cercueils contenant les restes supposés de Louis XVI et de Marie Antoinette juste au milieu
Archives Photo
Après son exécution, son corps a été enfui dans une fosse commune du cimetière de la Madeleine, puis peu après la restauration, Louis XVIII fit retrouver les corps de Louis XVI et Marie-Antoinette pour les mettre à Saint-Denis, le 21 Janvier 1814L'exhumation des restes royaux en 1814 a donné lieu à des processions et à de belles cérémonies. Hélas, les nostalgiques de l'Empire et de la Révolution ont fait ce qu'ils ont pu pour jeter le discrédit sur ces cérémonies et les tourner en ridicule. Ils se sont ainsi amusés à persuader Louis XVIII que ce n'étaient pas les bons ossements qui avaient été déterrés et inhumés à Saint-Denis. Un archiviste nommé Peuchet a même prétendu que Louis XVIII s'était mis à douter d'avoir retrouvé les bons corps. De là est née une rumeur qui a beaucoup brouillé les pistes et continue, aujourd'hui encore, à entretenir le doute sur le trajet des dépouilles royales.
Si les ossements ne se trouvent pas à Saint Denis, ils se trouvent de toutes façons rue d'Anjou où a été édifiée la chapelle expiatoire, qui constitue le plus formidable monument élevé en hommage à Louis XVI et à Marie Antoinette.L'exhumation des restes de la Reine a été faite de façon très méthodique avec des témoins de l'époque de son inhumation, tel le Royaliste Descloseaux qui avait acheté ce bout de terre, et qui confirmait l'emplacement exact. Le fait que les intéressés trouvent aussi rapidement le corps d'une femme avec quelques indices tels les bas qu'elle portait à l'exécution etc ne laissaient personne dans le doute. Nous pouvons être aussi certains qu'il est permis de l'être qu'il s'agissait bien des restes de notre infortunée souveraine.

Buste de Louis XVI, roi de France, par Louis Simon BOIZOT, 1777, château de Versailles, Versailles.
La thèse des Girault de CoursacPaul et Pierrette Girault de Coursac sont célèbres pour leurs études consacrées à Louis XVI. Celles-ci, construites à partir de longues recherches dans les archives de plusieurs pays, ont fait considérablement avancer la connaissance de la personne du Roi et de sa politique. Elles sont aussi marquées par une objectivité légèrement dissymétrique en faveur du roi et au dépens de la reine, avec une tendance à surinterpréter certains documents dans le sens de complots permanents.
La redécouverte des corps royaux suppliciés ne fait pas exception à ce travers dans leur analyse. C'est ainsi qu'a été lancé l'affirmation que l'on n'aurait pas retrouvé le corps de Louis XVI en 1815, révélation qui allait connaître une étonnante fortune.
Selon P.et P. Girault de Coursac, on ne retrouva presque rien du corps du roi, que de la chaux et des débris de planches mêlés à de la terre - ce qui est un fait. Pour satisfaire Louis XVIII qui croyait utile à sa cause les funérailles grandioses à Saint-Denis, on aurait improvisé un cadavre de Louis XVI avec un des nombreux squelettes de décapités, enterrés là pendant la Terreur. En effet, on n'a pas retrouvé de vêtement (la chaux ne les détruit pas) ni l'anneau du sacre. Or, expliquent les Coursac, il est impossible que l'on ait pris l'anneau après l'exécution; car le cadavre avait les mains gonflées par la corde et il aurait fallu lui couper le doigt pour enlever l'anneau, ce qui aurait été impossible sans attirer l'attention des soldats de l'escorte. Le bourreau s'est donc contenté de prendre ses souliers.
On aurait donc bien retrouvé la reine - point sur lequel tout le monde est d'accord - mais pas le roi.
ExtrapolationsPartant de cette analyse, certains esprits iconoclastes ont voulu en rajouter tout en versant dans l'approximation. Comme il y avait des cadavres de guillotinés partout on a dû se tromper de corps. De toutes façons on n'aurait jamais pu reconnaître celui de Louis XVI. Des corps avec la tête entre les jambes, il y en avait beaucoup dans le secteur. Ce sont ces idées lancées qui se répercutent jusqu'au commentaire de certains guides de la basilique.
Pourtant, la plupart des historiens, même s'ils restent prudents, croient en l'authenticité de ces restes.
Retour aux sourcesCe qui frappe lorsque l'on se penche sur les archives en question, c'est que l'enquête de 1815 a été faite avec sérieux et rigueur, sans sollicitation poussive. Le désir de Louis XVIII n'était pas de monter à tout prix un faux Louis XVI ou une Marie Antoinette de paille, mais bien de retrouver les restes de son frère et de sa belle soeur, et aussi de Louis XVII et de Madame Elisabeth (j'insiste sur ce point).
Ce sont les mêmes noms d'enquêteurs qui seront plus tard chargés de retrouver les deux grandes fosses aux ossements royaux, au Nord de la basilique de St Denis, issues des profanations d'octobre 1793. La qualité de leur longue enquête, avec échecs, persévérance, puis succès, ne fait aucun doute.
Voir un complot orchestré par Louis XVIII a d'autant moins de sens que celui-ci aurait eu davantage intérêt à ce que l'on retrouve le corps de Louis XVII, plutôt que ceux de ses parents ! Retrouver le corps de l'nfant du Temple permettait de couper court à toute contestation de légitimité de l'ancien comte de Provence, tout en évitant l'apparition d'imposteurs prétendant être e fils de Louis XVI ! Or, jamais le gouvernement royal n'a été tenté d'orchestrer une enquête bidon ou de falsifier des documents. Les recherches des policiers furent exhaustives mais lorsqu'on s'aperçut que l'on ne pourrait jamais retrouver le corps, on n'en a pas construit un fictif ! Les recherches furent arrêtées. De même pour Madame Elisabeth. Le lieu où la malheureuse princesse a été jetée, face contre le fond d'une fosse, les mains liées derrière le dos, a bien été circonscrit par les policiers. Mais il s'agissait d'une fosse commune où se trouvait de nombreux corps et les crânes étaient mélangés ; les corps n'ont donc pas été exhumés et Elisabeth se trouve aujourd'hui dans le sous-sol parisien ou aux Catacombes.
A l'inverse, pour le roi et la reine, non seulement les documents d'archives étaient clairs, mais les témoins de l'inhumation ont pu être retrouvés en 1815. Il apparut vite que les circonstances de celle-ci permettaient d’être optimiste.
Dès son retour en 1814, Louis XVIII chargea Henri d’Ambray, chancelier de France, de constater toutes les circonstances qui avaient précédé, accompagné, et suivi les inhumations de Louis XVI et de Marie Antoinette. Parmi les témoins directs de l’inhumation, les plus importants, on retrouva :
- L’abbé Renard , chargé le 21 janvier 1793 par les commissaires du département et de la Commune d’enterrer le corps du roi
- Le juge de paix Lemaignière et son greffier
- Eve-Vaudremont
- le genre de Desclozeau (propriétaire du terrain), Danjou, qui avait vu les deux inhumations.
- Un ouvrier ayant participé à l’enterrement de la reine
Leurs témoignages, pris séparément, correspondaient totalement.
Le Conseil exécutif avait donné l’ordre suivant le 20 janvier 1792 :
« Le corps de Louis Capet sera transféré dans le cimetière de la Madeleine, où il sera préparé une fosse à douze pieds de profondeur. » Douze pieds, soit deux fois la profondeur légale, de façon à ce qu’aucun particulier nostalgique ne soit tenté de creuser en catimini sans être pris sur le vif.
Le corps du roi, apporté au cimetière, reposait dans une bière ouverte, vêtu d’un gilet piqué blanc, d’une culotte de soie grise et de bas de la même couleur. La tête était placé entre les jambes.
On jeta de la chaux vive au fond de la fosse, on fit descendre la bière toujours découverte dans la fosse, on la couvrit d’une seconde couche de chaux, très importante. Puis de la terre que l’on tassa à de multiples reprises.
Neuf mois plus tard, le 16 octobre 1793, le corps de Marie Antoinette venait rejoindre celui de son époux.
Desclozeau et Danjou, qui habitaient la propriété voisine, avaient pu assister aux deux inhumations et avaient méticuleusement noté les deux emplacements qu’ils pouvaient repérer depuis leurs fenêtres et qu’ils ont par la suite bien gardés en mémoire.
En 1796, le cimetière de la Madeleine avait été mis en vente. Pierre-Louis-Olivier Desclozeau, ancien avocat au Parlement de Paris, resté fervent royaliste, s’en rendit donc acquéreur. Afin d’écarter les curieux, il exhaussa les murs et entoura l’emplacement des deux fosses royales d’une haie de charmilles et d’arbustes. Il planta aussi à côté deux saules pleureurs.
L'emplacement de la tombe de Louis XVI aménagée par Desclozeau
Photo Josse-Lalance
Les fouilles commencèrent donc, après 8 mois d’enquêtes, le 18 janvier 1815, en présence de l’abbé Renard, de Danjou et de Desclozeau.
On creusa aux endroits précis indiqués par les témoins, sur huit pieds de long et huit de large. Arrivés à huit pieds de profondeur, les ouvriers rencontrèrent un lit de chaux de dix pouces d’épaisseur. Au-dessous apparaissait l’empreinte d’une bière de cinq pieds et demi de longueur. Plusieurs ébris intacts de planche s’y trouvaient. On trouve alors « un grand nombre d’ossements de femme » et le crâne entier. On relève également deux jarretières élastiques assez bien conservées (ce sont elles qui ont permis l’identification car la reine les avait elle-même confectionnées) qui seront remises à Louis XVIII en même temps que deux débris du cercueil.
Les os encore intact sont placés dans une boîte. La chaux trouvée dans le cercueil est relevée et placée dans une autre boîte. Les deux boîtes sont portées dans le salon de Desclozeau, transformé en chapelle ardente.
Puis, le lendemain, on creuse à l’emplacement indiqué pour la fosse de Louis XVI, entre celle de la reine et le mur de la rue d’Anjou. On trouve à dix pieds de profondeur quelques débris de planche dans la terre mêlée de chaux et des ossements dont certains tombent en poussière. Des morceaux de chaux encore entiers adhèrent à certains os. La tête est placée entre les fémurs.
Tous les débris qu’on peut sortir de cet amas de terre, de chaux, de bois et d’ossements sont enfermés dans deux boite, l’une aux ossements, l’autre contenant les restes qui n’ont pas pu être extraits de la chaux solidifiée, souvent –détail macabre – parce celle-ci avait « moulé » une partie du corps du défunt.
Les deux boites furent, comme pour Marie Antoinette, placées dans un cercueil.
Une découverte quasi-certainePour avoir la certitude que l’on avait bien retrouvé le corps du roi, on a fait creuser tout autour, à vingt-cinq pieds de distance et jusqu’à plus de treize pieds de profondeur : rien !
On est donc bien en présence des corps de Louis XVI et de Marie Antoinette.
Les guillotinés de la Terreur, eux, n’ont pas été enterrés dans ce secteur du cimetière qui est resté isolé.
Quant à la chemise, l’argument des Girault de Coursac tombe. Car si Louis XVI a bien été amené habillé, rien ne prouve qu’il le soit resté lorsque l'on a fait descendre la bière. Il en a été de même de beaucoup de corps de guillotinés (Robespierre par exemple, que l’on a déshabillé avant de le jeter dans la fosse commune du cimetière des Errancis). Quand bien même aurait-il été inhumé avec sa culotte de soie et sa chemise, les Girault de Coursac surestiment la résistance des tissus à la chaux vive, à l’humidité, et à un séjour de 22 ans à 10 pieds sous une terre bien tassée !
D’ailleurs, leur argument devrait se retourner contre eux s’agissant de la reine qui a été enterrée dans les mêmes conditions et dont ils ne contestent nullement l’identification ! Or, on n’a retrouvé que les jarretières ! Aurait-elle été enterrée nue ... ?!
Enfin, rien ne dit que Louis XVI a été enterré avec l’anneau du sacre. C’est une affirmation gratuite. L’histoire des doigts gonflés relève de la spéculation pure et simple et n’a rien de médical. Et même si le roi portait l’anneau, rien ne dit non plus qu’il ne se trouve pas dans le magma de paquets de chaux vives que l’on a récupérés bruts, sans les briser, mélangés à quelques ossements. Mais répétons-le, aucun document, aucun témoignage ne dit que le roi portait l’anneau du sacre au moment de son exécution. On sait même qu’il avait rendu son anneau de mariage à sa femme. Pourquoi aurait-il gardé celui du sacre et pas celui du mariage qui est aussi un sacrement ? D’autant que Louis XVI ne portait pas 36 anneaux aux doigts . Seulement son anneau de mariage.
Au total, il apparait que la probabilité d’une découverte du corps de Louis XVI est trop élevée pour qu’on la remette de façon sérieuse en question.Auteur, Monsieur Alexandre Lenoir
sources :
http://saintdenis-tombeaux.forumculture.net/t81-les-corps-de-louis-xvi-et-de-marie-antoinette
 votre commentaire
votre commentaire
-
Pour apprécier les vidéos... cliquer sur le logo central de RADIONOMY
- colonne de gauche,
en bas - le fond musical du blog sera supprimé
Une AUTOMATE du XVIIIè siècle.... la JOUEUSE de TYMPANON... une pure merveille...
La joueuse de tympanon est un androïde musicien. La reine Marie-Antoinette l'acquit en 1785 et le donna à l'Académie des Sciences. Cet objet unique fait par...tie des collections du Musée des Arts et Métiers à Paris.
Mais la joueuse, âgée de plus de deux siècles, a perdu de sa virtuosité. Le film rappelle le parcours historique de l'automate et présente le travail d'une équipe pluridisciplinaire (mécanique, musique et informatique) qui a mis au point un concept de restauration virtuelle. Celui-ci, tout en garantissant la pérennité de l'objet, nous permet de l'entendre jouer comme aux premiers jours.
Cet automate - inspiré par Marie-Antoinette - a été restauré par Robert-Houdin en 1864 (puis à nouveau à la fin des années 1990 !). Il est exposé aujourd'hui au CNAM(Conservatoire National des Arts et Métiers) votre commentaire
votre commentaire
-
Jean-Baptiste Greuze, né à Tournus (Saône-et-Loire) le 21 août 1725 et mort à Paris le 21 mars 1805 (mort a 79 ans) , est un peintre et dessinateur français.
Il est, comme Watteau, le fils d'un couvreur. Après avoir été l'élève du peintre Charles Grandon à Lyon, Greuze s'installe en 1750 à Paris, où il est l'élève de Charles-Joseph Natoire à l'Académie royale de peinture et de sculpture. En 1755, son Père de famille expliquant la Bible à ses enfants connaît un grand succès. Sa popularité se confirma avec d'autres toiles mélodramatiques. Diderot l'encense pour la moralité de ses sujets. Présent régulièrement aux Salons, sa réputation s'étendit largement au-delà des frontières, jusqu'en Russie (l'impératrice Catherine II lui acquit La piété filiale/Le paralytique l'un de ses tableaux les plus célèbres actuellement au musée de l'Ermitage considéré comme la suite de son chef d'œuvre L'accordée de village visible au Louvre.

Jeune paysan peint vers 1763 conservé au Metropolitain Museum of Art de New York (1) Véritable innovateur en matière de peinture de genre, Greuze est le premier en France à introduire la morale dans sa peinture domestique. Au moment où émerge la critique d'art, son Septime-Sévère reprochant à Caracalla d'avoir attenté à sa vie (1769) constitue un immense scandale au sein de l'Académie et les critiques y vont bon train. Se présentant comme peintre d'histoire avec cette toile, il se voit refusé le titre, pour celui de peintre de genre.
En effet, Greuze eût l'audace de vouloir dépasser les limites de la hiérarchie des genres picturaux en présentant un tableau qui ne fait appel ni à la convenance du genre noble, ni aux expressions contenues des personnages selon leur position sociale.
Jean Baptiste Greuze ,Autoportrait
En 1792, il rencontre le jeune capitaine Napoléon Bonaparte à Paris, d'une manière que l'on ignore encore, mais vraisemblablement suite aux évènements de la prise des Tuileries, et peint ce qui allait devenir une véritable œuvre de transition entre la peinture du XVIIIème et celle néoclassique du début du XIXème et un des premiers portraits connus du futur empereur. Il conserva ce tableau dans sa chambre jusqu'à sa mort (ainsi que sa fille).
Un oiseleur qui, de retour de chasse, accorde sa guitare. 1757
Greuze peignit de nombreux portraits et subit quelques critiques pour ses toiles libertines. Il s'est également essayé aux thèmes allégoriques — l'Offrande à l'Amour (1769) — mythologiques — Danaé — et religieux — Sainte Marie L'Égyptienne — mais sans convaincre. La Révolution de 1789 amena la vogue de l'antique et dévalorisa son travail, le conduisant à vivre de leçons. Déjà très diminué, son grand portrait en pied de Napoléon Bonaparte en costume de Premier Consul (Musée du Château de Versailles) qu'on lui commanda à la fin de sa vie en 1803, en grande partie réalisé par son atelier (et sa fille), et reprenant le visage du portrait d'après nature de 1792, ne l'empêcha pas de mourir dans la pauvreté.
Jeune fille pleurant son oiseau mort (1759)
Greuze était franc-maçon et faisait partie de la loge des Neuf Sœurs
Un thème récurrent chez Greuze est la perte de la virginité qu'il symbolisa notamment dans La Cruche cassée, Le Malheur imprévu, Les Œufs cassés ou encore L'Oiseau mort.
Ses représentations d'enfants et ses portraits sont conventionnels mais intéressants : Babuti, le Dauphin, Fabre d'Églantine, Fillette soulevant un coffre, Gensonné, Le Graveur Wille, La Liseuse, Le Libraire Babuti, Madame Greuze, Marquise de Chauvelin, Pigalle, Silvestre, Tête de garçon, Wille, Robespierre.

Meilleur dessinateur que coloriste, Greuze excella dans les représentations de jeunes filles, dans lesquelles pouvaient se mêler l'innocence et l'érotisme : La Jeune Femme au chapeau blanc (1780). Malgré des compositions habiles, le recours à des gestes outranciers ou des figures pâmées, rend ses toiles moralisantes souvent monotones, quand elles ne tombent pas dans le travers du sentimentalisme.
Ses nombreuses toiles sont conservées au musée du Louvre, à la Wallace Collection, au musée Fabre, au musée Condé et au musée de Tournus, sa ville natale.

La cruche cassée
Jean-Baptiste Greuze a eu entre autres pour élèves Jeanne Philiberte Ledoux (1767-1840), Marie Renée Geneviève Brossard de Beaulieu, Charles-Henri Desfossez, Anna-Geneviève Greuze, Constance Mayer, Pierre Alexandre Wille.

Mozart Enfant Sources
WIKIPEDIA
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Dona Rodrigue dans La MODE de la COIFFURE, des PERRUQUIERS au XVIIIè siècle le 20 Juillet 2012 à 22:23

Le dix-huitième siècle fut un âge d'élégance.
Jamais dans l'histoire nous voyons des hommes et des femmes si minutieusement artificielles, si très loin de leur apparence naturelle.
Ce qui ne pouvait pas être fait avec les cheveux naturels a été fait avec des perruques. Cette époque fut une explosion extravagante de coiffures étonnantes, une réaction totalement opposée à la pudeur et à la réserve des siècles antérieurs. Les coiffures étaient en concordance avec le style "Rococo", qui était le plus important presque jusqu'à la fin du siècle.
C'était un mouvement artistique dans lequel les courbes en forme de "S" ont prédominé, avec des asymétries, soulignant le contraste; un style dynamique et brillant, où les formes intégrant un mouvement harmonieux et élégant.
Un style concordant avec une époque de nouvelles idées philosophiques, comme celui des Lumières, et avec l'affluence de richesses économiques qui arrivent en Europe par les voyages vers le nouveau continent, l'Amérique. On crée de nouveaux ordres sociaux; en plus du clergé et de la noblesse, une bourgeoisie forte de nouveaux riches est apparue qui s’est positionnée dans les sphères sociales et politiques, imitant en tout les coutumes des nobles.
Un style conforme à une époque dans laquelle la science s'émancipe de plus en plus de la religion, obtient des réussites spectaculaires et développe en conséquence une technologie qui ouvrira les portes à la Révolution Industrielle.

Les gens de cette époque croyaient qu'ils vivaient dans le meilleur des mondes. À la fin du siècle, les styles artistiques et culturels changent; surgit un style appelé "néoclassique" beaucoup plus sobre et conservateur, avec un retour à l’esthétique Grecque et Romaine classique.
L'utilisation de perruques chez les hommes a commencé à être très populaire à la fin du XVIIe siècle, durant le règne, en France de Louis XIV, le Roi Soleil. Toute sa cour s’est mise à utiliser des perruques, et comme la France dictait la mode de l'Europe à cette époque, son usage s’est étendu aux autres continents. En 1680 Louis XIV avait 40 perruquiers qui dessinaient ses perruques dans la cour de Versailles.
Dès 1770, l'usage des perruques s’est aussi étendu aux femmes. Et à mesure que les années passaient, les perruques sont devenues plus hautes et plus élaborées, spécialement en France. Les perruques masculines étaient en général blanches, mais celles des femmes étaient de couleur pastel, comme rose, violet clair ou gris bleuâtre. Les perruques indiquaient, par leur ornementation, la position sociale plus ou moins importante de celui qui les utilisait.
Les gens de fortune pouvaient payer, logiquement, des dessinateurs plus chers et avoir plus de variété de matériels. Elles étaient faites en général avec du cheveu humain, mais aussi avec du poil de cheval ou de chèvre. En France, la comtesse de Matignon payait à son coiffeur Baulard 24.000 livres par an pour lui faire un nouveau dessin de perruque chaque jour de la semaine.
Vers 1715 on commence à poudrer les perruques. Les familles avaient un salon dédié à la "toilette", où elles se poudraient quotidiennement et s’arrangeaient. Les perruques étaient poudrées avec de la poudre de riz ou de l’amidon. Pour cette opération, faite par un coiffeur, on utilisait des robes de chambre spéciales et on avait l'habitude de couvrir le visage d'un cône de papier épais.


LES BARBIERS DEVIENNENT "PERRUQUIERS":
En plus de couper et de coiffer le cheveu et de raser le menton, les barbiers pratiquaient diverses opérations chirurgicales et extractions dentaires. En 1745 une loi, en Angleterre, leur interdit ces pratiques et les autorise seulement à couper et coiffer les cheveux. Cela provoque la ruine de nombreuses boutiques de barbiers et le manque de travail pour beaucoup d’entre eux en Europe, puisque des lois similaires sont promulguées en France et dans d’autres pays. Mais l'essor des perruques crée la demande de nouveaux professionnels: les fabricants et les dessinateurs de perruques, qui de plus se chargeront de les entretenir périodiquement, de les parfumer et de les retoucher.
Déjà depuis la fin du siècle antérieur des syndicats ou des unions de coiffeurs se sont créés, et exigeaient des professionnels de payer un tarif et de présenter un examen d'aptitude pour pratiquer la profession. Pendant ce siècle l'industrie des perruques croît et devient importante, en créant de nouveaux travaux et sources de recettes pour une grande partie de la population.
À son tour l'industrie des chapeliers est affectée, puisque les hommes cessent d'utiliser des chapeaux pour laisser voir leurs perruques et ils doivent fabriquer, de nouveaux styles de chapeaux qui peuvent s'adapter aux perruques. La majeure partie du peuple, disons 80 % de la population, n'utilisait pas de perruques, mais le cheveu naturel, sans trop de règle. Mais seul un pourcentage de la noblesse et de la haute bourgeoisie mobilisait une industrie remarquée pour l'époque.
VOL DE PERRUQUES DANS LA RUE:
William Andrews, un écrivain anglais du XIXe siècle, nous narrons que les vols des perruques dans la rue, dans le dix-huitième siècle, étaient monnaie courante. Et les perruques, à leur apogée, étaient très onéreux. A dû marcher avec prudence pour ne pas perdre la parruque. Malgré toutes les précautions, les vols de perruques étaient fréquentes. Il fut célèbre ce mode d' opération: un enfant était transporté, caché, sur une plateau de boucher pour un haut homme, et le garçon attrapait la perruque en moins d'une seconde. Lorsque le propriétaire, étonné, regardait partout, un complice l'empêchait-il d'avancer sur le prétexte d'aider, en tant le "boucher" échappait. (William Andrews, "At the sign of the barbers' pole", Cottingham, Yorkshire, J. R. Tuttin,1904 ).



Au début du siècle, les styles de cheveux des hommes sont beaucoup plus somptueux que ceux des femmes. C'est la mode du "style Louis XIV", avec de grandes boucles et la chevelure sur les épaules. Quand le siècle se termine, la tendance est reversée : les femmes portent des perruques exubérantes, de 50 à 80 cm de hauteur et plus, qu'elles s'emploient, avec des dessins, à commémorer les célébrations et les anniversaires. Ces perruques féminines apportaient quelques problèmes: les cadres des portes avaient été surélevés ou reconstruits pour qu'elles puissent passer, et dans plusieurs occasions la pression trop lourde des perruques leur causait une inflammation au niveau des tempes. Vers la moitié du siècle, le nouveau roi de France, Louis XV, impose un style de plus petites perruques pour les hommes et le rigoureux poudrage blanc ou de préférence grisâtre. Les hommes utilisent aussi depuis la moitié du siècle une queue de cheval sur la nuque, attachée avec un ruban, style qui devient très populaire dans toutes les cours. Les femmes continuent avec les styles extravagants jusqu'à l'arrivée de la Révolution Française, où tout le luxe et l'exubérance sont pratiquement annulés par les nouvelles idées républicaines. À partir de là, les coiffures sont plus classiques et plus simples et on recommence à utiliser le cheveu naturel.

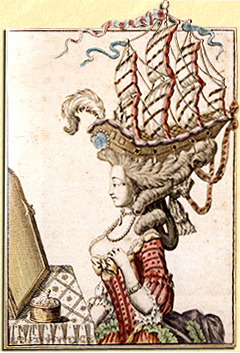
En réalité, malgré le fait qu'il soit amusant de penser que les femmes utilisaient ces perruques immenses dans leur vie quotidienne et aux fêtes où elles allaient, la réalité est différente. Ce type de présentation capillaires gigantesques a peut-être existé, mais seulement pour une occasion très spéciale ou pour des représentations théâtrales. Les perruques comme les images que nous voyons ci-dessus sont le produit de caricatures de l'époque ou d'anecdotes ou de légendes sans beaucoup de fondement. Il est pratiquement impossible de trouver dans les tableaux de peintres célèbres de l'époque ces perruques immenses. Les femmes nobles utilisaient des styles de chevelure beaucoup plus sobres et élégants, malgré le fait qu'elles étaient plus ou moins volumineuses et élaborées.


En ce qui concerne le style de cheveux des femmes du XVIIIe, au début du siècle on continue toujours à utiliser celui qui venait d'une mode de la fin du siècle antérieur : le style "Fontange". Son nom a été créé par la Duchesse de Fontange, qui lors d’une journée de chasse avec le roi de France Louis XIV, s’est pris la chevelure dans la branche d'un arbre, et pour réarranger le cheveu l'a empilé sur sa tête. Le roi est resté fasciné par cette coiffure accidentelle, et l’a priée de toujours la conserver. Ce style a été à la mode plus ou moins jusqu'en 1720.
Sous le règne de Louis XV les coutumes ont changé et les cheveux féminins ont eu un autre style plus simple. Un style dénommé "tête de mouton" (tête de brebis), avec de courtes boucles et quelques grosses mèches de cheveux sur la nuque. Les femmes n'ont pas utilisé de perruques jusqu'à 1770. À partir de là, les coiffures - artificielles - sont devenues de plus en plus hautes et plus élaborées.

EXEMPLES DE STYLES DE COIFFURES FEMININES AU XVIIIe SIECLE

EXEMPLES DE STYLES DE COIFFURES MASCULINES AU XVIIIe SIECLE:

LE CHANGEMENT APRÈS LA RÉVOLUTION FRANÇAISE:
Déjà près de la fin du siècle le style magnifique et éblouissant de la noblesse européenne était l'objet de critiques des philosophes de l'Illustration. Non seulement le style de vêtements et de coiffures, mais le style d'art même, le rococo, était fort critiqué. A ce moment, la bourgeoisie - la classe sans noblesse - devient puissante et influente; tout le système, politique, économique, social et culturel est controversé par les principaux penseurs.

Deux gravures de femmes du XVIIIe siècle coiffées de cheveux en « échelle
de boucles », rubans, plumes, fleurs, bijoux ...

La première estampe provient du « 10e Cahier de Costume Français, 4e Suite d'Habillements à la mode. » « Dessiné par Desrais » « Gravé par Voisard » « Jolie Femme en Circassienne de gaze d'Italie puce, avec la jupe de la même gaze couvrant une autre jupe rose garnie en gaze broché avec un ruban bleu attaché par des Fleurs et glands et gaze Bouilloné par en bas, et des manchettes de filet, coiffée d'un Chapeau en Coquille orné de Fleurs et de Plumes. » « A Paris chez Esnauts et rapilly rue St. Jacques à la ville de Coutances A. P. D. R. [Avec Privilège Du Roi] »
L'autre gravure est signée : « D P. Inv. » « Avec Privilège du Roi
En principe, les bourgeois riches imitaient en tout les nobles, ils voulaient être comme eux.
Mais quand ils deviennent puissants et auto-suffisants, ils critiquent tout le système de l’Ancien Régime, repoussent toute sa structure sociale et naturellement, ses coutumes.
Avec l'arrivée de la Révolution Française, le luxe et l'ostentation sont mal vus par tout le monde. La nouvelle société adopte un style plus sobre et se tourne vers la simplicité ; du rococo il passera au néo-classique, style artistique qui récupère l'esthétique grecque antique. Et ce sera aussi le style en accord avec le romantisme, qui s'imposera à la fin du XVIIIe siècle et prédominera sur presque tout le XIXe siècle.
Les changements philosophiques, la forme de pensée de la société changent la coiffure. Petit à petit, les perruques cessent de s'employer, et le cheveu s’emploie au naturel, sans poudre. La Révolution et le changement de tout le système a été brusque et subit - bien qu'il fût déjà annoncé - à la suite d'un coup législatif des députés bourgeois avec appui de la part du clergé et de la noblesse, mais le changement de coutumes n'a pas été si rapide. Toutes les images de Robespierre et Danton, deux leaders de la Révolution, les montrent avec des perruques poudrées, jusqu'à leur mort par la guillotine. En revanche, Jean Paul Marat, l'autre leader révolutionnaire, utilisait déjà la nouvelle esthétique. Et celui des gérants principaux de la Révolution, le peintre Jacques Louis David, était déjà inscrit totalement dans le style néo-classique, à travers ses oeuvres et dans son esthétique personnelle. À mesure que le néo-classicisme s'impose, les coiffures changent.
Lorsque arrive au pouvoir Napoléon Bonaparte, déjà peu utiliseront des perruques ; le style Empire montre tous les législateurs et hommes politiques avec le cheveu naturel, peigné d'une manière informelle, symbole d'une nouvelle ère d'indépendance de pensée. Les militaires sont les derniers à abandonner le vieux style, mais dans l'armée napoléonienne déjà presque tous sont avec le cheveu naturel. Les femmes, déjà à la fin de l'ère révolutionnaire, cessent complètement d'utiliser les coiffures hautes et élaborées et portent le cheveu sans le couvrir, avec une chute presque naturelle, tenue avec des peignes de coquille de tortue, des épingles, ou des rubans, au lieu des ornements complexes.

Peut-être les premiers à abandonner le vieux style de perruques et de coiffures très élaborées ont été, paradoxalement, les mêmes aristocrates qui les ont imposées. Par crainte d’être reconnus et vraisemblablement emprisonnés et guillotinés durant l'Ère de la Terreur de Robespierre (1790-1793), ils sortaient de leurs maisons habillés simplement et avec des coiffures naturelles ; sans perruques, naturellement, avec le cheveu court, sans le couvrir et une coiffure de style néoclassique. En réalité, il n'y avait pas de lieu où utiliser l’ancien style de cheveu. A cette époque, dans le reste de l'Europe on a commencé à pratiquer le même type de coupes et de coiffures. Le 19e siècle était annoncé par une mode totalement distincte.
sources : http://dona-rodrigue.eklablog.com/histoire-de-la-coiffure-au-xviiie-siecle-a12366970
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Dona Rodrigue dans Étiquettes et élégances au temps de Madame de Pompadour le 20 Juillet 2012 à 21:15

La marquise de Pompadour, François Boucher, vers 1758
Étiquettes et élégances au temps
de Madame de Pompadour
 par Henrielle Vanier
par Henrielle Vanier
A ne considérer Mme de Pompadour que sous l'aspect de reine de la mode, on écarte fort heureusement tout ce qui put être néfaste dans son rôle.
Seuls s'imposent alors sa grâce, sa beauté et son humeur inoffensive.
La voici parée de ces charmants atours que nul ne porta mieux qu'elle, plongeant en des révérences dont elle avait tôt appris la souplesse pour mieux séduire le Roi.
Moralistes et chroniqueurs, en tout temps, ont exercé leur virtuosité à l'occasion des réjouissances de la Cour.En 1751 la famille royale célèbre la naissance du duc de Bourgogne: belle occasion de critiquer les uns, de plaindre les autres! "On ne s'aperçoit point de la misère à Paris, tout est d'une grande magnificence en équipages et en habits, surtout les hommes. et ce luxe a pris dans tous les états".
"Toute la cour fait une grande dépense. On ne sait comment se retourner pour gagner".
Les ducs de Chartres et de Penthièvre font sertir de diamants les boutonnières de leurs habits; on ne parle que de velours multicolores brodes d'or, de brocarts de grand prix, de point d'Espagne d'or; le velours noir n'est pas admis.
Barbier ne faisait, en somme, que se répéter; quelques années plus tôt, lors du premier mariage du Dauphin, il récriminait bien davantage: les seigneurs commandaient chacun trois habits pour les trois jours, et à quel prix!
Le marquis de Stainville faisait doubler de martre du drap d'argent brodé d'or; le marquis de Mirepoix préférait payer fort cher, en première location, les vêtements qu'il rendrait au tailleur à la fin de chaque journée; le raisonnable et raisonneur duc de Croy n'hésitait pas à déranger son budget pour paraître avec dignité: "toujours il y a quelque occasion d'incommoder les gens de cour". gémit notre chroniqueur.
Il gémira encore lorsque les deuils de la Dauphine et de la Reine de Pologne ruineront les marchands de soieries "déjà chargés des habits de printemps et des taffetas de couleur".
Voilà les dames de la cour et de la ville," celles du bon air" évidemment, en laine pour trois mois; point de diamants; au bout de six semaines, des" effilés" de lingerie, en fait de garnitures; ensuite, le petit deuil en blanc: comment écouler les stocks et les fantaisies du dernier goût?
Vers la fin du règne, Diderot reprendra le même thème, après le mariage du duc de Chartres:
"Il faudra voir avec le temps où s'arrêtera ce délire de luxe, ou s'il trouvera le moyen de se surpasser lui-même. J'avais cru, il y a une quinzaine d'années, lorsqu’on inventa pour les habits d'homme, des étoffes à trois couleurs, que cette mode paraîtrait trop frivole et ne pourrait durer longtemps.
Je me suis bien trompé.
On a trouvé depuis le secret de mettre sur le dos d'un homme une palette entière, garnie de toutes les teintes et nuances possibles. Aujourd'hui, on met la même variété dans les broderies d'or et d'argent qu'on mêle de paillons de diverses couleurs: ces habits donnent à nos jeunes gens de la cour un avantage décidé sur les plus belles pouées de Nuremberg.
"Si j'étais Roi de France, et si j'avais à être assassiné. ce serait avec les aiguilles des faiseurs de paillettes et de paillons."Les bals parés, et celui de 1745 venait en première ligne. dans les préoccupations des courtisans, étaient une occasion de se mettre en valeur.
On n'y pouvait paraître qu'en tenue de Cérémonie, ce qui rendait la fête" plus magnifique qu'agréable". Les hommes" marqués pour danser" portaient des habits à grands parements, brodés sur toutes les tailles (c'est-à-dire, littéralement, sur toutes les coutures), avec des écharpes.
Ils devaient être en"cheveux longs avec des allonges, ou en perruques naturelles"; ceux qui ne dansaient pas étaient autorisés à les nouer en deux petites cadenettes, mais point en bourse; cette coiffure simplifiée, alors adoptée par tous les gens d'épée, ne convenait pas au cérémonial.
Les dames présentées n'étaient admises à la Cour qu'en"grand habit", le buste emprisonné par le"grand corps fermé" en forme de cône, rigoureusement baleiné, recouvert de broderies, et souvent cousu de pierreries; les épaulettes réglables, fixées à l'horizontale pour élargir le décolleté, meurtrissaient les bras, recouverts de l'épaule au coude par trois ou quatre rangs de dentelle.
Sur l'énorme panier,"artistement couvert de fleurs, de perles, d'argent, d'or, de paillons de couleurs et de pierreries, s'attachait le"bas de robe", qui était en réalité une queue assez étroite, mais d 'une longueur variant avec le rang: depuis 9 aunes pour la Reine jusqu'à 3 aunes pour les duchesses, soit de10,5 m à 3,80 m environ.
Sur la gorge découverte, 7 ou 8 rangs de gros diamants, que l'on empruntait pour l'occasion, ou qu'on louait fort cher à un joaillier; de lourdes girandoles aux oreilles, des pierreries dans la chevelure; et les belles danseuses, perchées sur les hauts talons de leurs souliers pointus enduraient le martyre en souriant à la ronde.Celles qui n'étaient plus jeunes pouvaient, à la rigueur, masquer par une mantille un" corps" ouvert moins suffocant.

Dure contrainte de la toiletteUne femme qui allait paraître à la cour pour la première fois devait, tout d'abord, faire examiner par le généalogiste officiel ses preuves de noblesse; elle prenait ensuite l'heure du Roi et de la Reine pour être introduite par une dame déjà présentée; elle avait, auparavant, répété ses révérences avec le maître à danser, et s'était exercé à endurer. pendant ces évolutions, le redoutable"grand corps".
L'habit de présentation devait être noir. orné de dentelle blanche. et tout recouvert. Pardevant de pompons et de passementeries d'or.
Puis le lendemain. pour la tournée des visites obligatoires.
"Tout ce qui était noir se changeait en or et en soieries multicolores". La présentation en grand habit donnait le droit de monter dans les carrosses du Roi et de la Reine., et de souper dans les petits appartements.
La Reine pouvait aussi accueillir des présentations secondaires, ou "subalternes". mais qui se passaient sans éclat. à sa toilette et en " robe de chambre".
La présentation des hommes autorisait à chasser avec le Roi. à être reçu dans ses carrosses. à monter ses chevaux et à souper dans les petits appartements: "toute autre présentation ne constituait point homme de cour", dira sentencieusement Mme de Genis.
Pour paraître à la messe du Roi. et lorsque la Reine était en représentation, les dames devaient encore revêtir le grand habit.
Marie Leczinska en sera réduite. à Fontainebleau. à"écouter la musique de sa chambre, si elle était dans la pièce. il faudrait être en grand habit".
Les filles de Louis XV qui menaient dans leurs appartements une vie assez casanière, passaient précipitamment. à l'heure du débotté. "un énorme panier recouvert d'une jupe chamarrée d'or et de broderie; elles attachaient autour de leur taille une longue queue.
et cachaient le négligé du reste de leur habillement par un grand mantelet de taffetas noir. qui les enveloppait jusque sous le menton" En moins d'un quart d'heure. la corvée terminée, Mesdames rentraient chez elles, dénouaient les cordons de leur jupe et de leur queue. et reprenaient leur tapisserie.
Lorsque le Roi regrettait de ne pas les voir dans l'intimité, elles faisait revenir chez lui après le souper" sans paniers".
La pieuse Reine n'a jamais prétendu tenir un rôle de coquette: que de belles toilettes, pourtant, lui préparait sa dame d'atours!
Les échantillons qui en ont été conservés, avec leurs rubriques, permettent de les évoquer:
" satin vert canard à fleurs d'or; petit jaune à mille fleurs; satin nouveau fond franchipane à fleurs d'argent; moire nouvelle d'Angleterre, Velours ciselé de Florence; taffetas peint; gros de Tours blanc garny de paquet de celery renonès avec du ruban". On en faisait, non seulement de grands habits de cérémonie, mais aussi de ces innombrables robes de toilette, robes à peigner, robes de chambre et robes abattues, qui convenaient aux circonstances et à l'emploi du temps, puisqu'il fallait changer de tenue au moins trois fois par jour, et souvent davantage.
Après avoir figuré à la Cour, en cérémonie, quelle joie pour une jolie femme de s'esquiver vers quelque fête privée, comme celle pour laquelle Choffard a gravé, dans un encadrement chantourné, ce libellé:" Bal pour lundi à 6 heures, les dames sans panier."
Dès la fin du règne de Louis XIV, on avait réussi à obtenir quelques dérogations aux rigueurs de l'étiquette: les veilles de départs, les dames étaient autorisées à paraître devant le Roi sans être en grand habit; et l'on partait souvent!
A la campagne, elles' ne faisaient que deux toilettes: pour le matin, un"négligé"; puis, au retour de la promenade," elles se paraierit avec une grande magnificence", mais en robe ouverte, et sans les pénibles contraintes de la tenue de cérémonie.
Chateau de Chevilly Larue de Madame de Pompadour
A Marly, elles étaient invitées à déjeuner, à midi, dans le grand salon, avec le Roi et la famille royale; comme on aimait l'été, retourner de nuit dans les jardins, en grande parure.
Mme de Pompadour a préparé, dit-on, pour le voyage de mai l75l, une robe garnie de dentelles d’Angleterre, coûtant plus de 22.500 livres.
Elle sut triompher de toutes
Les femmes abusaient du rouge en ce temps là, et il devait être plus rouge à la cour qu'à la ville, au point que" l'on avait peine à voir leurs yeux". "Ce rouge, qui semble vouloir être naturel, est une vraie ridiculité", reproche une mère à sa fille.
Mais il était de mauvais goût d'en mettre le matin, excepté en habit de cour. La jeune Infante qui venait épouser le Dauphin, reçue en France par ces dames trop fardées, envoya demander au Roi"la permission de mettre du rouge", afin d'être au diapason pour les fêtes des noces.
Quant aux mouches, c'était le point final du maquillage, il ne pouvait être question de les oublier.
Que de fastidieuses réglementations pour se plier aux usages! On quittait les fleurs avant l'age de 30 ou de 35 ans; on prenait une coiffe noire à 50 ans.

Quand on entrait en dévotion, ostensiblement" on quittait le rouge". Le moindre détail de ces toilettes savamment orchestrées était tout un programme.
Les rois donnajent des bals masqués dans les grandes occasions, afin que les personnes qui n'étaient pas présentées puissent y venir. On y allait en domino, ainsi qu'aux bals ordinaires de la Cour, aux bals offerts par la Municipalité de Paris, à l'Hôtel de Ville, bals masqués de l'Opéra.
Les dominos étaient taillés"comme des robes de ville, avec des plis par derrière, de très longues manches, de petites queues" et un capuchon; ils se portaient avec de petits paniers; on se divertissait d'autant mieux que le port du masque autorisait les mystifications et les galanteries.
Lors des fêtes de 1747, pour le second mariage du Dauphin, il y eut"Appartement" à 6 heures, c'est-à-dire assemblée générale de toute la famille royale avec les princes du sang et toute la Cour: Après le souper, "la Reine, en grand habit, se déshabilla pour aller au bal dans son petit appartement", où la Dauphine et Mesdames se rendaient"en habit de masque".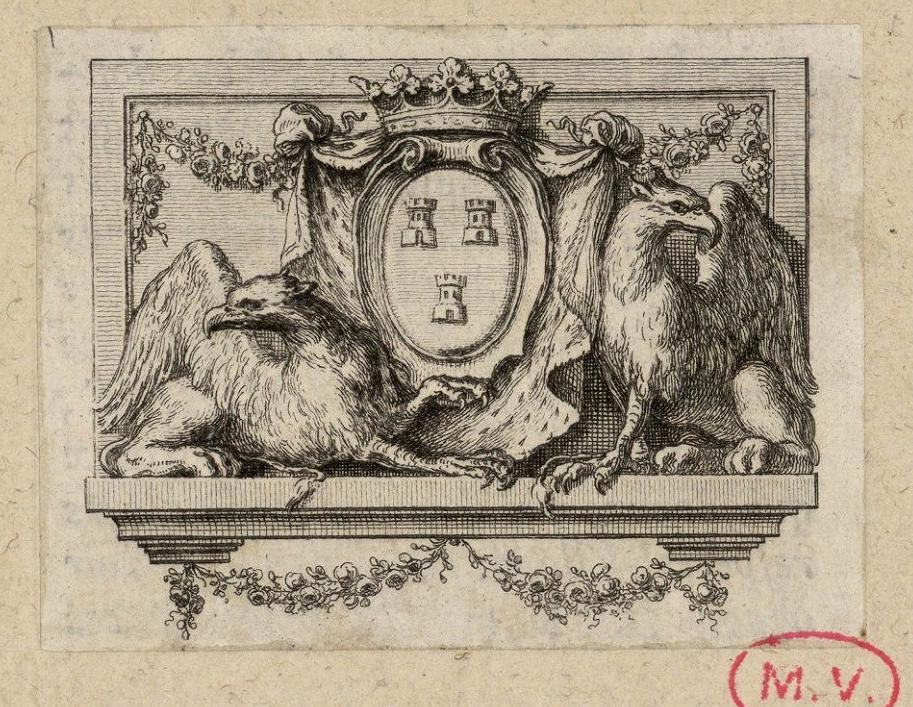
Ex-libris aux armes de la marquise de Pompadour
Banque d'Image du centre de recherche du Château de Versailles, INV.GRAV 7037
Vers minuit et demi, raconte le duc de Luynes,"la Reine, masquée. alla jusqu'au Salon d'Hercule pour voir danser la Dauphine, et rencontra la troupe du Roi, masquée et en dominos tous semblables; Mme. de Pompadour y était à visage découvert".
Ainsi, dans le réseau compliqué des subtilités de l'étiquette, s'était glissée, puis triomphalement installée, cette ravissante personne que le Président Hénault, dès l742, signalait à Mme du Deffand, pour l'avoir admirée à souper.chez Pont-de-Veyle: "Je trouvai là une des plus jolies femmes que j'ai jamais vue, c'est Madame d'Etioles; elle sait la musique parfaitement, chante avec toute la gaieté et le goût possibles, sait cent chansons, jouie la comédie à Etioles."
Cette beauté de vingt ans sut se faire remarquer, en forêt de Sénart, sur le passage des chasses royales. Bientôt la mort brutale de la duchesse de Châteauroux suggéra les commentaires que traduit "l'Espion Chinois": "Toutes les jolies femmes se mirent en campagne. n y eut de quoi travailler pour tout le monde: les marchandes de modes, les coiffeurs, les agrémanistes passèrent les nuits. " On ne vendit jamais tant d'étoffes, de rubans, de dentelles, de pompons. On eut dit que toutes les femmes étaient veuves, et qu'elles se préaraient à passer en secondes noces. " On prit des bains et on se parfuma à tout événement".
Notons au passage la place occupée, dans l’élégance féminine, par ces passementeries, fabrication des agrémanistes parisiens: associant, avec une inépuisable fantaisie, des soies multicolores, d'étroits rubans. la chenille, la blonde; déroulant des franges à houppettes, qui répondaient au nom mystérieux de sourcil.

ou" soucil d'hanneton et prétendaient imiter les cornes des hannetons, les agréments serpentent au bord des corsages, des manches en pagode et des pans entrouverts du "manteau" soulignent les volants et les falbalas, en s'inspirant du dessin et des couleurs de l'étoffe; reproduisent en miniature les guirlandes et les bouquets qui y sont tissés; et le triomphant bouquet de corsage, insér* à l'angle du décolleté, les ornements de coiffure, les aigrettes de fleurs n~ sont souvent qu'un trompe-l’oeil réalisé par les mêmes artisans.
Il, ne fut pas question d'aïeux
Dès février 1745, le duc de Luynes, confident de la Reine, note: "Tous les bals en masque ont donné l'occasion de parler des nouvelles amours du Roi", mais il présume que ce n'est" qu'une galanterie, et non pas une maîtresse".
En avril, on la remarque aux spectacles de la Cour," dans une loge fort en vue de celle du Roi, et par conséquent de la Reine, fort bien mise et fort jolie".
Le Roi soupe avec elle, en particulier,"dans ses cabinets, ou en quelque autre endroit qu'on ne sait point". Un petit groupe de courtisans de la plus haute volée se fonne autour d'elle: "ce sera dans peu à qui y soupera, des princesses et dames de la Cour". Après l'avoir installée à Versailles, le Roi achète pour elle, au prince de Conti, le marquisat de Pompadour; il faut bien que le duc de Luynes en convienne," elle sera présentée".
Elle le fut, en effet, dès le mois de septembre; introduite par la Princesse de Conti, en présence de la foule impitoyable des courtisans.La pauvre Reine en avait vu bien d'autres; sa vertu réelle et sa sincère piété lui conféraient une dignité qui imposait le respect. "On pensait que la Reine lui parlerait de son habit, mais elle crut devoir, par cette raison même, lui parler d'autre chose".
Et ce fut le Dauphin qui lui parla de son habit. Dès la semaine suivante, elle est ouvertement de toutes les parties: elle dîne, à Choisy; avec toutes les dames, à la table de la Reine; elle figure, en tenue de chasse, lors de la visite de Stanislas Leczinski." Elle est polie, elle a un fort bon maintien, elle n'est point méchante, ne dit du mal de personne, et ne souffre pas même que l'on en dise chez elle" En octobre, à Fontainebleau, elle ne sort de son appartement que pour aller chez la Reine, devant qui elle multiplie les égards et les témoignages de respect; elle lui envoie des bouquets, Elle engage le Roi à la bien traiter. Mesdames, et même la Dauphine, affectent d'être avec elle en rapports corrects, malgré leur attitude distante et certains silences pénibles, surtout de la part du Dauphin.

Les" Choisy" se succèdent pendant la saison d'automne; les dames y sont en"robes" abattues" et, à Dampierre, en robes de chambre. A Marly, le cercle de la Reine et celui de la favorite, avec le Roi, se rencontrent dans le parc;" tout se passe de bonne grâce". Au retour de la campagne de 1746, le Duc de Croy se fait présenter à la Marquise; la trouve charmante,"de figure et de caractère".
"Elle passe avec aisance sur le corps des premières duchesses, en leur faisant politesse, au grand couvert, pour s'y asseoir".
Les courtisans les plus favorisés, pour être admis d'office dans les réunions des petits châteaux, arboraient un uniforme vert galonné d'or, qui leur permettait de suivre le Roi dans ses déplacements, sans invitation particulière. Pour l'inauguration de Bellevue, la Marquise imagine de gratifier ses invités d'un" Habit d'ordonnance" en fin drap pourpre, largement borde d'or en bordure et en boutonnières, selon un dessin de son invention, avec "une veste de satin gris-blanc, travaillé en pourpre d'un dessin chenillé, et d'un grand bordé d'or mat, large de quatre doigts".
Pour les dames, les robes devaient être de ce même satin gris-blanc, tout unies et sans or. Malheureusement, Mme de Pompadour n'offrait que les tissus, et la broderie, fort coûteuse, restait à la charge des heureux élus, ainsi que les habits des valets de chambre, en drap vert, à bordure et boutonnières d'or!
Robes de bain et négligés
"Madame de Pompadour altéra un peu le ton de la cour, proclame Mme de Genlis, mais ne changea. rien aux étiquettes."
Pour esquiver les difficultés de protocole, elle recevait à sa toilette,"en peignoir et nu-tête" dans son arrière-cabinet de laque rouge. On se pressait à sa porte, il y avait du monde jusqu’au bas, de son petit escalier. Le comte d'Argenson ose, même écrire:
" la toilette de cette dame est une espèce de grande Cérémonie, on la compare au fameux déculotté du Cardinal de Fleury .. Les soirs, tous les grands y accourent pour se montrer."On y rencontre, entre autres, la Maréchale de Mirepolx, cette altière Lorraine, Dame du Palais de la Reine, le Maréchal de Saxe que la favorite appelle"mon maréchal", le duc de Richelieu pour qui elle improvise, après la prise de Minorque, un noeud d'épée appelé"à la Mahon".

Tout a été dit sur la toilette des femmes au XVIIIe siècle, sur leurs coiffeurs: ce Dagé qui"accommoda" successivement Mme de Châteauroux, la Dauphine et Mme de Pompadour; ce Legros qui publiera en 1765 un livre d'estampes:"de l’Art de la coiffure des Dames", au moment ou le"tapé" s'élève en hauteur, rehaussé de crêpons et de coussinets de crin. Mme de Genlis précise ce qu'illustrent toutes les estampes: "Les dames s'habillaient, changeaient de chemise, se laçaient devant les hommes"; elle continue, imperturbable: "On recevait des hommes lorsqu’on était dans son lit, on n’en recevait jamais lorsque on était dans son bain".
On se baignait, du reste, en longue chemise de flanelle ou de tricot, boutonnée du haut en bas, les bouts de manches, ainsi que le collet, étaient doubles de linge. Le trousseau de Mme de Pompadour, inventorié après sa mort, remplissait 9 malles, dont 3 de lingerie, dentelles et garnitures. Il s’y trouve erl quantité ces peignoirs et"manteaux de lit", en mousseline brodée, en linon Qroché ou en point d’Angleterre, ces derniers composant de véritables ensembles: le grand fichu, la coiffe. la taie d'oreiller et les draps, assortis au manteau lui même.
"Recevez, charmante Adrienne. recevez ce manteau de lit", écrivait Voltaire à Mlle Lecouvreur, bien des années auparavant: la favorite reçut évidemment nombre de semblables cadeaux. Son livre de comptes, très régulièrement tenu, précise qu'elle n’a dépense pour sa garde-robe."en 19 ans de règne",que 350.235 livres, tout compris.
Moulin à café en or ayant appartenu à Mme de Pompadour
Oeuvre de Jean Ducrollay (vers 1708 - après 1776)
Conservé au Musée du Louvre, Objets d'Arts, INV OA 11950, acquis par dation en 2000.C’était en 1764 une grosse somme, et les mémorialistes ne tarissent pas sur ses excessives dépenses. Mais aussi,. quel choix de précieuses dentelles pour ses devants de corps, ses tours de corset, ses tours de gorge, ses manchettes à 2 et à 3 rangs, ses coiffes, coiffures,"barbes, respectueuses et port-mahon"!
Valenciennes, Angleterre, Malines et point d’Argentan se fixaient dans les boucles de la chevelure par les "plis pour bec de bonnet", en brillants, rubis, diamants jaunes et saphirs.
Parmi les déshabillés, on lui attribue le lancement de ces négligés appelés à la Pompadour, "dont les formes sont telles qu’ils ressemblent aux vestes à la turque, pressent le col, et sont boutonnés au-dessous du poignet; ils sont adaptes à l'élévation de la gorge et collent juste sur les hanches, rendant sensibles toutes, les beautés de la taille. en paraissant vouloir les cacher". C'est ainsi que Van Loo la peindra en Sultane prenant le café, et l'on retrouve dans ces souples vêtements d'intérieur, d'inspiration orientale, le souvenir des costumes de théâtre et de son goût pour la scène.
Elle s'était fait applaudir en"habit à l'asiatique" ou en "doliman de satin cerise, garni d'hermine découpée, avec jupe de satin blanc peinte en, broderie d'or".
Quand elle paraissait dans le répertoire classique, c'était une tenue plus encombrante; elle portait dans Acis et Galatée une "grande jupe de taffetas blanc peinte en roseaux, coquillages et jets d'eau, avec broderie frisée d'argent bordée d'un réseau chenillé vert; un corset rose tendre, avec une grande draperie de gaze d'eau argent et vert à petites raies, le tout. orné de glands et de barrières de perles".
Elle ne dédaignait pas non plus le travesti masculin, et jouait Colin "habillée en homme, mais comme les dames le sont quand elles montent à cheval: c'est un habillement très décent".
Tombée au rang de dame de compagnie
Nos brillantes amazones montaient en longue et ample jupe et devaient être munies d'un large choix de tenues de chasse, selon qu'il s'agissait de galoper en foret, ou de suivre dans les carrosses du Roi.
C'étaient tantôt de véritables justaucorps de coupe masculine: aux larges poignets galonnés, ouvrant sur le gilet qui s'appelait alors la veste; tantôt d'amples robes à plis, fermant devant sous des ruches de passementerie d’or, qui soulignent aussi les longues manches avec une cravate de lingerie, et le petit tricorne bordé de fourrure, crânement posé sur une perruque d'homme nouée"à la brigaudière"; c'est ainsi que Nattier représente Mme Infante, fille aînée de Louis XV, dont le voyage en France, en 1748, provoque quelques difficultés, à cause des réjouissances familiales auxquelles participait la favorite.

Mme de Pompadour, à la fin de sa vie, avait dans ses bagages un habit de drap vert brodé d'or, une redingote de pou de soie avec"veste" assortie, brodée en or également, ainsi qu'un autre habit de laine tricotée, complété par la veste, la jupe et la culotte de même.
Mesdames aimaient toutes courre le cerf à cheval, mais surtout Mme Louise qui devint carmélite.
Après ces randonnées, le Roi recevait ses filles en tenue de chasse dans ses petits appartements; pendant le deuil de la Dauphine, elles chassaient habillées de noir ainsi que leurs dames, et les hommes en justaucorps gris.
En hiver, les parties de traîneau sur le Grand Canal donnaient prétexte à étaler les riches fourrures, le manteau d'hermine, les garnitures de martre zibeline et les manchons en baril.
Le velours fourré et ourlé de luxueuses pelleteries laissées à la silhouette toute sa sveltesse; c'est la favorite, blottie dans son traîneau, que Boucher a prise pour modèle en évoquant les plaisirs de l'hiver.
Mme de Pompadour partageait encore, bien entendu, les deuils de la famille royale; une de ses malles était consacrée aux toilettes imposées en ces circonstances: grands habits, robes de chambre, ou casaquins avec leur jupe, en ras de Saint-Cyr, en taffetas, velours et gaze; noirs, blancs ou gris; en satin moucheté, en taffetas rayé. garnis de plumes.
Pendant la deuxième période du deuil, on avait droit aux lingeries unies et garnies d'effilés.
Le petit deuil permettait, en noir et blanc, les perses, les indiennes, les pékins, toutes ces gracieuses fantaisies à ramages de caractère exotique, peintes ou imprimées, d'autant plus recherchées que la fabrication et la vente en resta interdite jusqu en 1759; ce qui stimulait les importations clandestines, par les vaisseaux de la Compagnie des Indes.
Le deuil termine, Mme de Pompadour reprenait avec joie ses négligés de" toile peinte" en toutes couleurs; quantité de pièces entières et de métrages pour robes figurent dans son inventaire.
En dépit de sa mauvaise santé, elle soutenait le rythme épuisant de la vie de cour; tantôt on la trouvait maigrie,"la mine défaite, coiffée de nuit à la chapelle"; puis engraissée et plus belle que jamais.
Elle obtint en 1752 le tabouret et les honneurs de duchesse; on vit son écuyer, le Chevalier d'Henin, de la Maison de Chimay, "portant sur le bras son mantelet en suivant sa chaise à pied, prêt à poser le manteau sur ses épaules dès qu'elle mettrait pied à terre".
Ensuite elle donna dans la dévotion, tint des conférences avec le Père de Sacy, fit des lectures de piété, priant ostensiblement sous ses coiffes baissées, n'allant plus au théâtre, ne recevant plus à sa toilette, mais à son métier. Le bruit courut"qu'elle allait quitter le rouge"...
Mais non, le sérieux duc de Croy l'écrit sans rire, "ce n'était qu'un quart de conversion".
N'étant plus pour le souverain qu'une amie et une" dame de compagnie", elle pouvait sans indécence et réimposée à la Reine comme Dame du Palais. La duchesse de Luynes l’introduisit en cette charge au milieu de l'étonnement des courtisans: "Entrant en semaine de service, elle y a paru à souper, au grand couvert, parée comme un jour de fête, et elle a fait son service avec un air tranquille, comme si elle n'avait jamais fait autre chose."

Parmi ses amis les plus fidèles, le duc de Choiseul et sa charmante femme tiendront chez elle, jusqu'à ses derniers jours, de ces conversations intimes et"dégantées" dont le Roi aimait le naturel.
Mais ses forces déclinaient, elle souffrait de quintes de toux, de suffocations. Pendant un séjour à Choisy, en 1764, une rechute plus grave se déclara. Ramenée à Versailles, elle se sentit perdue, et se prépara à la mort avec beaucoup de fermeté et de religion; elle n'avait que 42 ans.
Bientôt la mort prématurée du Dauphin, de la Dauphine, la disparition de la Reine, multiplièrent les deuils de la Cour. Mesdames restaient à l'écart. Mme du Barry n'eut ni le temps ni les qualités nécessaires pour s'imposer. Le sceptre de l'élégance, maintenu par Mme de Pompadour pendant "19 ans de règne", sera repris par Marie-Antoinette; et la Mode, sous son impulsion personne1le, évolua vers un style très différent.
Sources : HENRIELLE VANNIER
http://www.madamedepompadour.com
 votre commentaire
votre commentaire
-
Maurice Quentin Delatour, plus communément appelé Quentin de La Tour, né le 5 septembre 1704 à Saint-Quentin, décédé le 17 février 1788 dans la même ville, est un portraitiste pastelliste français (ne pas confondre avec Georges de La Tour, peintre du siècle précédent, ni avec Henri Fantin-Latour, peintre du siècle suivant.)

Louis XV, dessin préparatoire
Issu d'un milieu cultivé, son patronyme originel est « Delatour » que l'usage déforma en « de La Tour ».
Il part à Paris entre 1719 et 1722 dans une petite académie de peinture. À partir de 1722, il s'installe comme peintre. Il rencontre Louis Boullongne et Jean Restout, ce dernier ayant une grande influence sur lui. En 1735, il peint le portrait de Voltaire au pastel, ce qui lui assura une grande renommée. A son apogée, il a réalisé différents portraits de Louis XV de sa famille et son entourage, devenant ainsi, après Jean-Marc Nattier un artiste en vogue.

Il est surnommé alors « le prince des pastellistes » , technique qui devint à la mode à partir de 1720 notamment, à cause des progrès dans la production du verre plat. En effet, le pastel est une poudre colorée déposée sur papier, parchemin, vélin ou soie, qui doit être protégée de tout contact. A sa maturité, Latour est un excellent dessinateur, il acquiert une remarquable maitrise du portrait au pastel (il applique méthodiquement un ensemble de règle de cadrage, d'éclairage, de composition). Son succès fut incontesté, la critique unanime, à tel point qu'il sera pris d'une certaine mégalomanie et rêvera de faire du pastel la technique dominante du portrait (il cherche notamment à faire de très grands formats par collage, concentre sa clientèle sur les plus hauts personnages de l'époque, monopolise le pastel dans le cadre de l'Académie royale ).

Portrait d'une inconnue
Il tentera de fixer le pastel pour le rendre aussi durable que l'huile (la fixation du pastel se faisait avec des laques ou des vernis : elle porte toujours atteinte à "la fleur du pastel", sa surface mate qui accroche la lumière). Son perfectionnisme méticuleux lui vaudra d’endommager certains de ces portraits. Il se permettra des provocations répétées (notamment le portrait d'un esclave noir nostalgique de son pays au milieu des plus hauts dignitaires) et affirmera souvent sa sympathie pour les idées philosophiques.
.jpg)
A la différence de sa devancière Rosalba Carriera qui produisit des allégories et des portraits, il est exclusivement portraitiste. Contrairement à Jean-Baptiste Perronneau, artiste sensible et ouverte à la recherche et qu'il considère comme un rival, il est exclusivement pastelliste. En 1750, il est nommé conseiller à l'Académie royale de peinture et de sculpture.
VOLTAIRE
A la fin de sa vie, il perdit ses facultés. Son caractère ne l'avait pas conduit à transmettre ses connaissances. C'est sans doute Adélaïde Labille-Guiard qui, à la génération suivante, conservera le mieux son enseignement. Néanmoins, lors des nostalgiques retours en grâce du siècle des Lumières, Latour sera recherché des plus grands collectionneurs (Wildenstein, Gulbelkian, Getty, etc.). À la fin du XIXème siècle, beaucoup de pastels lui étaient aveuglément attribués.
Portrait de Marie Leczinska, reine de France (1748)
Indépendamment du personnage représenté, les portraits de Latour virent leur valeur fluctuer considérablement. Payés des fortunes de son vivant, ils devirent invendables après la Révolution car sa technique, le choix des sujets tout comme sa personnalité en faisaient un artiste partisan. Il n'en reste pas moins vrai que la grande rétrospective, organisée à Versailles en 2004 pour le 300ème anniversaire de sa naissance, a mis en évidence une remarquable cohérence stylistique et une incontestable maîtrise technique, qui le placent au premier plan de l'art européen sous Louis XV.
Œuvre :
Maurice Quentin de la Tour est facilement identifiable, généralement traités en grand format le sujet est bien placé dans la lumière, toujours de façon à estomper les disgrâces, toujours le coin des lèvres relevé pour évoquer un sourir, le regard est toujours franc et les carnations parfaites dans leurs teintes et leurs nuances.

Marie-Anne de Cupis,
Sa technique évoluera peu, plus ou moins estompées selon les périodes.

Un élément important de sa méthode est la préparation du portrait qui se fait par des croquis rapides au pastel, généralement en série, destinés à trouver le cadrage et l'éclairage qui met le mieux en valeur son sujet.
Marie Fel
La série des préparations pour le portrait de la Pompadour est édifiante de savoir faire. Souvent seules ses préparations sont conservées.
Madame de Pompadour
De même ses thématiques sont récurrentes : lui-même (série continue d'autoportraits), les grands de ce monde, les artistes et comédiens, les religieux et intellectuels.
Louis XV
Parmi les portraits célèbres de Maurice Quentin de la Tour, citons : Voltaire, Jean le Rond d'Alembert, Jean-Jacques Rousseau, Louis XV, la dauphine Marie-Josèphe et Madame de Pompadour…
Marie Josèphe de SAXE
Les figures de Maurice Quentin Delatour

Madame FAVART
Dans le domaine de la peinture, le 18ème siècle voit le déclin de la hiérarchie des genres au sommet de laquelle régnait la peinture d'histoire et religieuse. Apparaît alors l’idée que l’être humain est ce qu’il y a de plus difficile à dépeindre. Maurice Quentin Delatour (et non de La Tour car il n’a jamais été noble) sera un des plus grands peintres de ce siècle et consacrera toute son œuvre à faire des portraits aux pastels.

Quentin-Latour (comme le surnomment les historiens pour le distinguer rapidement de Georges de La Tour) va exceller dans le rendu des regards qui transpercent littéralement la face de ses modèles.
La force de ces regards vient qu’ils dépassent largement les seuls yeux.
Tout se concentre du front au menton. Le reste (cheveux…) n’a que peu d’importance.
Les portraits de Quentin-Latour sont vifs et pétillants. On peut aisément se douter en voyant les dessins préparatoires (ici Madame de Pompadour - cliquer sur l’image pour découvrir le tableau achevé) et les tableaux terminés (ici Jean Restout - cliquer sur l'image pour voir le tableau entier) le perfectionnisme du peintre. Il sait que la moindre ombre, tracée en plus ou en moins sur les lèvres, les paupières, les joues ou le menton, peut bouleverser du tout au tout l’expression de la personne réelle qu’il a voulu portraiturer.
Il est reçu en 1746 à l'Académie, et sa virtuosité de dessinateur lui attire très vite la célébrité
Ses nombreux portraits sont ceux de tout ce qui comptait à l'époque
Ami des philosophes et des savants, il fait de sa maison d'Auteuil le rendez-vous des beaux esprits
Mais bien qu'il soit la coqueluche de la Cour et pensionné par Louis XV, il n'est pas un courtisan
Son impatience d'artiste et son mauvais caractère le font même frôler le lèse-majesté, et il exige que plus les « portraiturés » sont riches, plus ils paient
Avec les sommes considérables qu'il reçoit, il crée des fondations d'intérêt public, des Prix à l'Académie, une donation pour les jeunes femmes en couches de St Quentin, ainsi qu'une école de dessin gratuite
Passionné de sciences occultes, son caractère fantasque tourne peu à peu à la neurasthénie, au point que son frère le ramène à St Quentin, où la population lui fait un triomphe
Il faut ensuite le faire interner, et il sombre dans la folie avant de mourir
Dans son dédain pour les représentations mythologiques, Quentin de La Tour a rendu au visage sa place et sa dignité
Il saisi au vol un regard, un sourire, un reflet, il est un voleur d'âmes
Le modèle, avec lui, a sa vie propre, aussi modeste soit-elle
Perfectionniste au-delà du raisonnable, il revient sans cesse à ses oeuvres, reprend le détail, corrige le trait, il s'y perd, s'y épuise
Il travaille avec acharnement à faire de cette chose si fragile qu'est le pastel une chose impérissable, jusqu'à la manie, jusqu'à gâter des oeuvres admirables pour expérimenter des techniques de fixation
Obsession bien inutile, les oeuvres qui ont échappé à sa fureur de toujours faire mieux sont aussi fraîches et lumineuses qu'au premier jourSources : wikipedia
photos google
 votre commentaire
votre commentaire
-
Le château de Versailles ouvre les portes des appartements de la comtesse Du Barry, dernière maîtresse royale et présente une approche du style Louis XV.
La société des amis de Versailles a pour but de réunir des admirateurs inconditionnels du château et de généreux donateurs permettant de redonner son éclat d'antan à cette œuvre magistrale voulue par Louis XIV.
Les membres ont la possibilité de visiter des lieux, généralement inconnus du grand public, avec un conférencier.
L'appartement de la "belle" Du Barry a été entièrement rénové et meublé dans l'esprit du XVIIIe siècle avec du mobilier d'époque. Quelques pièces rares, tant par leur nombre que par leur esthétique, ont pu être réunies. Elles ont appartenu à la célèbre Comtesse.
Jeanne Bécu et le Roi
Louis XV ne se trompe pas lorsqu'il croise, dans un des grands escaliers de Versailles, une jeune femme d'une grande beauté dont il tombe éperdument amoureux. Agé de 58 ans, c'est un éternel neurasthénique. L'apparition de Jeanne va transformer sa vie.
Pour être présentée à la cour, Mademoiselle Bécu doit être titrée, elle épouse donc le Comte Guillaume Du Barry avec lequel elle contracte un mariage blanc. Rien ne s'oppose plus, dès lors, à ce qu'elle vive à Versailles auprès de son royal amant.

L'installation
Sous les attiques du château, donnant sur la cour de marbre, se trouvent les cabinets privés du souverain. Très vite, ce dernier octroie à sa favorite une partie de ceux-ci. Le premier architecte du roi, Ange Jacques Gabriel est mandé pour donner une nouvelle fraîcheur à cet endroit.
En ne s'adressant qu'à des artistes, pour ne citer que les plus prestigieux, tels que Fragonard, Madame Vigée Lebrun, Watteau et Van Loo pour la peinture, Carlin pour les commodes, boîtes à bijoux et secrétaires, Germain pour l'orfèvrerie ou encore Verbeck et Desgoulon pour les boiseries et les stucs, la jeune Du Barry va réunir tous les talents particulièrement prisés à la cour en matière d'arts décoratifs.
Visite d'un chef-d'œuvre du XVIIIe siècle
Après avoir "grimpé" par l'escalier intérieur du Roi, on accède enfin à ce lieu si particulier. Les plafonds sont bas et l'appartement n'a rien de comparable avec ceux que l'on visite habituellement. Cependant, bien que situé juste sous les toits, il se dégage de ce lieu mythique un charme incontestable.

L'antichambre
Sitôt la porte d'entrée passée, on accède à la première antichambre où se trouvent des armoires. En leur temps, elles contenaient le linge de table, l'argenterie et la vaisselle.
Un magnifique service de table dit "le service aux rubans bleus" trône derrière une vitrine, il est composé de 37 pièces dont certaines au chiffre de la propriétaire. Elles sont en pâte tendre, sortent tout droit de la manufacture royale de Sèvres; elles furent acquises par Madame Du Barry le 1er septembre 1770.
La bibliothèque
Dans le même lieu se trouve un petit escalier menant à une ravissante pièce aux dimensions réduites mais merveilleusement décorée, la bibliothèque.
Les portes des armoires en verre, raffinement inouï pour le siècle, sont ornées de motifs d'or dans le goût de l'époque. Dans le fond, une petite alcôve en glace avec un canapé recouvert d'un éclatant tissu fleuri, sur la droite, face à la fenêtre, une cage (aux armes de Jeanne) où se trouvait son perroquet favori auquel on apprenait des airs d'opéra et sur la gauche l'inévitable cheminée en marbre griotte, symbole, s'il en est, du château.

Les grands salons
Le salon d'angle donne sur la cour de marbre et la cour royale, la clarté atteint un maximum apportée par des fenêtres en renfoncement, détail d'architecture visant à faire paraître plus grandes les ouvertures. Ces dernières sont richement ornées de motifs "royaux" tels que la fleur de Lys ou les initiales du roi, mais l'artiste ne dédaigne pas les feuilles et les fruits également très appréciés. Quelques meubles d'époque et un portrait du monarque peint par Van Loo se trouvent ici ainsi que les deux fameuses chaises à châssis recouvertes de soie blanche et de motifs fleuris que l'on doit au menuisier Louis Delanois (1769). Elles faisaient partie du mobilier de la jeune femme.

Un amusant détail, dans le mur derrière une porte, on peut apercevoir le minuscule réduit dans lequel, paraît-il, le Roi faisait réchauffer son café…

Puis vient le salon de compagnie qui possède une cheminée de belle facture surmontée d'un buste de Pajou, des chenêts de Caffieri, des sièges recouverts de leur soie d'origine (un must) et deux commodes de style Transition.

La salle à manger et la salle des buffets
On se dirige, ensuite, vers la salle à manger aux murs blancs, parsemés de motifs turquoise du plus bel effet. Pas de table dans cet endroit puisqu'à l'époque, l'on mettait des tréteaux sur lesquels étaient posés une simple planche. Néanmoins, une nappe damassée donnait au tout une allure royale convenant au premier invité de la Comtesse. Tout autour, se trouvaient les chaises, celle du roi avait un dossier plus haut que celui des autres, noblesse oblige!. A côté, la salle des buffets. Les verres et les bouteilles qui ne figuraient jamais sur la table de la salle à manger étaient rangés ici et sortis à la demande des convives. Les servantes et valets s'occupaient également des nombreux plats en attente.

L'alcôve
Enfin, on rentre dans la pièce privée où règne comme un parfum de scandale à peine voilé: la chambre. Elle se trouve exactement au-dessus de celle de Louis XV.

On remarque une belle cheminée en marbre blanc finement taillée, une commode Transition, une somptueuse table de Martin Carlin en marqueterie, un petit bureau et une boîte à bijoux du même auteur.

Le lit se trouvait, au XVIIIe siècle, en face des fenêtres sur la droite, il était surmonté d'une impériale, sorte de baldaquin avec de lourdes tentures. Une autre porte, ouverte, celle-ci, montre un escalier qui rejoint les toits du château et qui, sous Louis XVI, permettait l'accès à sa bibliothèque.

Les communs
La salle de bains spacieuse laisse apercevoir la place où se trouvaient les deux baignoires en cuivre épais, la première servant à se laver et la seconde à se prélasser dans une eau parfumée.
L'appartement se termine par une pièce attribuée à la femme de chambre, un cabinet de la chaise et l'immense garde robe aux habits.
La comtesse Du Barry quitte Versailles en mai 1774, le roi se meurt. Elle n'y reviendra jamais…
Louveciennes
Sources :
 votre commentaire
votre commentaire
-

La dernière reine de France fût aussi la plus critiquée
Du trottoir parisien aux couloirs de Versailles, tous ont détesté celles qui, dès son arrivée en France, fût surnommée l'Autrichienne.Comme beaucoup de mariages royaux, celui de Louis Auguste, dauphin de France et de Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, est un mariage d'Etat, visant à réconcilier deux grandes maisons d'Europe, ici les Habsbourgs et les Bourbons. Il n'y a pas d'amour dans ce mariage et la future dauphine ne recevra justement aucun amour dans ce pays étranger qui, pourtant, pouvait lui donner de grands espoirs.

L'arrivée de l'archiduchesse en France
Lorsque Marie-Antoinette arrive en France, elle doit abandonner tous ses biens autrichiens. Elle va jusqu'à renoncer à ses gens et à son petit chien, Mops. A même pas quinze ans, il est normal que l'adolescente se raccroche à sa nouvelle famille et à ce roi , Louis XV, qu'elle juge noble et bon et quel nomme affectueusement son royal grand-père.
Mais elle se rend vite compte que le roi est débauché et sa relation avec la comtesse du Barry la dégoûte. Elle se rapproche de « Mesdames Tantes », les soeurs du roi qui, comme elle, ne peuvent supporter la du Barry. Elles manipulent cependant la jeune autrichienne. Madame du Barry ne l'épargne pas non plus, voyant dans cette future reine de France une rivale qui, de plus, refuse de lui adresser la parole. Louis XV doit contraindre la dauphine de parler à la favorite. Marie-Antoinette s'exécute mais elle restera profondément humilier de s'être abaissée devant une roturière sans scrupule.
Surveillée par sa mère, la reine Marie-Thérèse, qui entretient une grande correspondance avec le comte Mercy-Argenteau, ambassadeur d'Autriche en France, manipulée par la cour la plus cruelle d'Europe, qui utilise contre elle son amour pour son pays et sa famille, Marie-Antoinette est propulsée dauphine sans être préparée, ni armée.

Une dauphine adulée par le peuple et critiquée à la cour
Marie-Antoinette est une dauphine mal entourée. Elle entretient peu de relation avec son époux qui lui est très mal assorti. Ses compagnes, les bonnes dames de la société, l'ennuient. Elle ne fait pas de vague, reste aimable et discrète. Elle est jolie et gracieuse. Pourtant, personne ne l'apprécie à la cour. Trop jeune, elle ne possède pas encore la gorge très en vogue en France. On juge aussi son front trop haut. Derrière ce jugement esthétique se cache en réalité une attaque directe à ses origines : Marie-Antoinette possède le front des Habsbourgs...
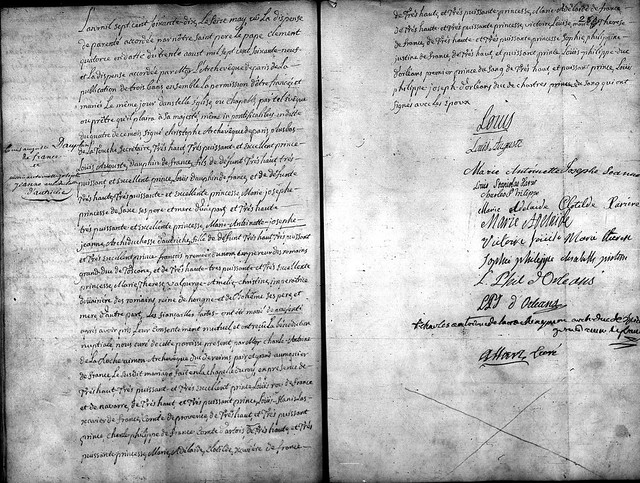
Dès son arrivée en France, le jour même de son mariage, on murmure déjà contre elle. Favorisant les princesses de Lorraine de par leur lien de parenté, elle leur permet de danser avant les duchesses. La cour murmure alors contre celle que l'on surnomme déjà l'Autrichienne.
Le peuple apprécie, lui, cette jouvencelle, promesse d'un avenir heureux. Taxé par le roi vieillissant, il voit en elle le salut.

Une reine de plus en plus contestée
A la mort de Louis XV, Marie-Antoinette devient reine de France et de Navarre. Une liberté nouvelle s'offre à elle. Elle se détache de plus en plus des contraintes de la cour, allant jusqu'à se faire offrir le château du petit Trianon où elle va séjourner de plus en plus souvent fuyant la cour.
La rupture est alors certaine entre la reine qui s'entoure de jeunes gens et la noblesse vieillissante. Il est inconcevable que la reine préfère des petites noblesses et se désintéresse complètement des plus grands. Pourtant, peut-on lui en vouloir d'avoir écouté son coeur et cherché à s'étourdir avec sa coterie pour oublier les manipulations et les soucis alors qu'elle n'a que vingt ans?

Ses séjours à Trianon ne dérangent plus que la Cour. Le peuple commence à gronder. L'avènement de Louis XVI n'a pas apporté le salut tant attendu et on commence à en vouloir à cette reine frivole qui dépense des fortunes pour ses toilettes. C'est pourtant bien peu de chose si l'on regarde les dépenses globales de l'Etat.
La reine est la cible de tous. Peut-être qu'une maîtresse royale aurait détournée l'attention. Mais Louis n'a pas de favorite, la chose l'intéresse peu. Il n'a d'ailleurs pas encore mis la reine enceinte mais c'est à elle qu'on en veut. On lui reproche de sortir toute la nuit à Paris, à l'Opéra, de s'éloigner du roi et bientôt on la soupçonne de le tromper. Le peuple gronde et la cour se gausse.

De reine honnie à reine de tragédie
Face à la haine de plus en plus féroce qu'on lui porte, la reine s'exile à Trianon, son petit paradis, son hameau irréaliste. De ce lieu de replis, le peuple fait un lieu de débauche. Les pamphlets et autres caricatures inondent les pavés parisiens. On n'hésite plus à critiquer la reine publiquement, à la traîner dans la boue comme une catin. Il n'y a plus de respect pour la reine.
L'affaire du Collier finit de la perdre. Même si elle est innocente, elle est jugée coupable par le peuple et par une partie de la noblesse. Lorsque le peuple marche sur Versailles et envahit le château, c'est pour tuer la reine. C'est elle qui a poussé le roi à fuir à Varenne, c'est elle encore qu'on accuse d'inceste lors de son procès parce qu'au fond, qu'a-t-on à lui reprocher?

Aucun coup ne fût épargné à Marie-Antoinette. Elle fût la reine d'une tragédie trop grande pour elle, une femme moderne ayant vécu à l'époque sombre de la Révolution. Pourtant, debout sur la charrette qui l'emmène à l'échafaud, c'est en reine qu'elle traverse la foule, une foule qui demeure sans voix sur son passage, qui fait même preuve de respect. A l'orée de sa mort, Marie-Antoinette devient la reine martyre adulée depuis par des générations.

 votre commentaire
votre commentaire
-
Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun
(1755-1842)1755-1773 (18 ans)
Enfance et apprentissageMarie, Louise, Élisabeth Vigée est née le 16 Avril 1755, à Paris, rue de la Coquillère. Son père, Louis Vigée (1715-1767), était un peintre portraitiste, membre de l'Académie de St. Luc et sa mère, Jeanne Maissin, coiffeuse de profession.

Elle est mise en nourrice à l'age de trois mois dans une ferme à Épernon, et à 5 ans devient pensionnaire au couvent de la Trinité, rue de Charonne dansle Fauboutg St. Antoine, où elle fait montre d'un talent précoce pour le dessin.

En 1767 après sa première communion, elle retourne chez ses parents.Elle prend des leçons de dessin auprès de son père, leçons qui ne durent que quelques mois car son père meurt le 9 mai dans son appartement rue de Cléry.

La même année sa mère se remarie avec Jacques François Le Sèvre (1724-1810), orfèvre et individu assez peu recommandable.
La famille emménage dans un appartement
rue de St. Honoré, en face du Palais Royal.

Élisabeth prend des leçons de dessin et peinture avec Mme Blaise Bocquet puis avec un peintre médiocre, Gabriel Briard.
Marie-Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun (French artist, 1755-1842)
Mademoiselle Brongniart
Chaperonnée par sa mère, elle accède à des collection privées de tableaux de vieux maîtres, dont elle fait des copies.

Madame de Polignac
Dès 1770 elle est peintre professionnel.
En 1774, son atelier est saisi par les officiers du Châtelet, pour cause de pratique sans licence de son art. Elle postule immédiatement pour l'Académie de St. Luc, où elle est reçue officiellement le 25 octobre 1774.

1774-1789 (19 ans à 34 ans) Jeune gloire sous le règne de Louis XVI
En 1775, son beau-père prend sa retraite, et la famille s'installe dans un appartement de l'Hôtel de Lubert, où vit le peintre et marchand d'art Jean Baptiste Pierre Le Brun (1748-1813).

Le Brun s'intéresse à la jeune et belle artiste, et lui permet de copier les tableaux de maîtres de sa collection.
Elle présente en 1775 à l'Académie Française les portraits du Cardinal de Fleury et de Jean de La Bruyère, et cet évènement est largement commenté par la société parisienne. Le 11 Janvier 1776 Élisabeth épouse Jean Baptiste Pierre Le Brun.
La première commande royale passée à Vigée-Lebrun est en 1776 une série de portraits du Comte de Provence, frère du roi et futur Louis XVIII .

De 1778 à 1788, elle peindra une trentaine de tableaux ayant pour sujet la reine Marie-Antoinette, dont « L'Innocence trouvant refuge dans les bras de la justice », aujourdh'ui au musée d'Angers.
Élisabeth devient l'amie et la confidente de la reine, qui a le même age qu'elle.
En 1781 Élisabeth Vigée-Lebrun vient à Louveciennespeindre la Comtesse du Barry, « en buste, en peignoir avec un chapeau de paille » ; elle peindra à nouveau la comtesse en 1782, 1787 et 1789.
Lebrun et son épouse achètent en 1778 l'Hôtel de Lubert, dont le salon devient l'un des endroits les plus à la mode du Paris pré-révolutionnaire. C'est là que se tint en 1788 le fameux « souper grec », un évènement mondain du règne de Louis XVI.

Sa fille Jeanne Louise Julie nait en 1780.
Les portraits de Julie et d'Élisabeth avec sa fille Julie sont parmi les plus réussis et touchants des tableaux de Vigée-Lebrun.

Julie demeurera fille unique, après un fausse couche d'Elisabeth en 1784.
En mai-juin 1781, Élisabeth accompagne son mari dans une tounée des Flandres et des Pays-Bas. Elle y approfondit sa connaissance des maîtres flamands (son « autoportrait au chapeau de paille » est un hommage direct à Rubens).

Vigée-Lebrun est admise à l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture en 1783, grâce à une intervention de la reine Marie-Antoinette.
Elle y présente « La Paix ramenant l'Abondance », aujourd'hui au musée du Louvre. Elle exposera régulièrement au Salon de l'Académie.

Dès 1783 et jusqu'à la Révolution, Élisabeth Vigée-Lebrun est la cible d'attaques calomnieuses : elle serait la maîtresse du Ministre des Finances Calonne, dont elle réalise le portrait en 1785, du Comte de Vaudreuil, et du peintre François Guillaume Ménageot, dont on dit qu'il serait le véritable auteur des tableaux de Vigée-Lebrun.

En 1789 est publiée une fausse correspondance entre Calonne, maintenant exilé, et la peintre. L'Hotel Lebrun est l'objet d'attaques de la part de bandes de maraudeurs. Élisabeth se réfugie chez son ami l'architecte Brongniart aux Invalides, puis chez la famille Rivière, Chaussée d'Antin.
En Octobre 1789, après l'invasion de Versailles par les foules révolutionnaires, elle part pour l'Italie en diligence publique, accompagnée de sa fille et d'une gouvernante. Son intention était de revenir à Paris dès l'ordre rétabli, mais son exil durera en fait douze ans.
1790-1801 (35 ans à 46 ans)
Exil doré pendant la révolution et la terreurAprès de cours séjours en chemin à Lyon, Turin, Parme et Florence, elle s'installe à Rome fin Novembre 1789 à l'Académie de France. Elle connait de grands succès lors de ses expositions et devient membre en1790 de l'Académie de San Luca.
Elle effectuera à partir de Rome plusieurs voyages à Naples.
Elle réalise son autoportrait pour la Galerie des Offices à Florence.
En 1791, elle est autorisée en dépit de ses opinions politiques à exposer au Salon de Paris et en 1792 elle part de Rome vers le Nord, espérant pouvoir revenir à Paris, faisant de courtes haltes à Spoleto, Foligno, Florence, Sienne, Parme, Mantoue, Venise, Verone, Turin, où la rejoint Auguste Louis Jean Baptiste-Riviere, qui demeurera son compagnon d'exil .
Marie-Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun (French artist, 1755-1842) Marquise de Aguessenau wearing a robe a la turque 1789
À Paris son nom est ajouté à la liste des émigrés et elle perd ses droits de citoyenneté. En 1793, Le Brun publie une longue plaidoirie en faveur de son épouse et fait appel pour sa réintégration.
Son appel est rejeté et Le Brun sera même incarcéré plusieurs mois.
Louis XVI et Marie-Antoinette sont guillotinés en 1793.
En 1794 Le Brun, pour se protéger, demande le divorce, qui est prononcé.
Marie-Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun (French artist, 1755-1842) Genevieve-Sophie le Coulteux du Molay 1788
En 1792 à Milan l'ambassadeur d'Autriche la persuade d'aller à Vienne, où elle restera deux ans, peignant essentiellement des portaits de nobles autrichiens et polonais, avant de partir pour St Petersbourg, via Prague, Dresde et Berlin.
À St Petersbourg, où elle restera six ans, fêtée et recommandée par la famille impériale, elle amassera une fortune considérable.
En 1798, elle envoie de St Petersbourg deux tableaux pour le Salon de Paris.
En 1799 à une session du Directoire, une délégation de huit artistes présentent une pétition signée par 255 artistes, écrivains et savants, et en Juin 1800 son nom est rayé de la liste des émigrés.
En 1800 sa fille Julie épouse, contre la volonté de sa mère, Gaetan Bernard Nigris, Secrétaire des Théâtres Impériaux de St Petersburg, et dépitée, Élisabeth part pour Moscou.
Marie-Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun (French artist, 1755-1842)
Elizabeth Alexeievna 1795
Elle retourna brièvement à St Petersbourg au printemps 1801, avant de prendre le chemin du retour définitif à Paris, via Berlin où elle restera six mois sous la protection des Hohenzolern.
1802-1808 (47 ans à 53 ans)
Retour en France Napoléonienne et séjour à LondresÉlisabeth Vigée-Lebrun arrive à Paris en Janvier 1801 et s'installe à l'hôtel Le Brun, malgré son divorce.
Elle louera plus tard une maison à Meudon où elle termine des tableaux commencés en Russie et en Allemagne.
Au Salon, elle expose son premier portrait de Stanislas II , roi de Pologne et en décembre 1801 elle demande à Le Brun le remboursement de sa dot. Pendant un certain nombre d'années, elle utilisera son nom de jeune fille.
En 1803, après la signature du traité de paix d'Amiens, Élisabeth s'installe à Londres. Elle prend un appartement à Leicester Square, puis une maison au 61 Baker Street. Elle peint des portraits du Prince de Galles, du jeune Lord Byron et de Mrs. William Chinnery.
En 1804, Julie Nigris revient à Paris avec son mari, qui la quittera bientôt pour rentrer à St. Petersbourg. À Londres Élisabeth déménage dans une maison de ville à Portman Square, puis dans Maddox Street.Le médiocre peintre anglais John Hoppner publie un volume de poésies dont la préface est une charge contre Vigée-Lebrun et son art du portrait.
Élisabeth Vigée-Lebrun retourne à Paris en 1805, après un voyage en Hollande et Belgique ; elle s'installe à nouveau à l'hôtel Le Brun.
Les relations avec sa fille Julie restent tendues.
En 1807, Élisabeth Vigée-Lebrun exécutera un portrait de Caroline Murat, la sœur de Napoléon : ce sera la seule commande de la part du gouvernement impérial.Marie-Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun (French artist, 1755-1842)
Guiseppina Grassini 1804
Elle règle de nombreuses dettes de son mari et accepte en échange des hypothèques sur les propriétés de celui-ci. Elle lui achètera en 1807 l'hôtel de Lubert.
Elle effectue aussi en 1807 un séjour en Suisse à Coppet avec Mme de Staël et est est faite membre honoraire de la Société pour l'Avancement des Beaux-Arts de Genève.
1809-1842 (54 ans à 87 ans)
Vieillesse sous l'Empire puis la restaurationÉlisabeth Vigée-Lebrun rentre définitivement en France en 1809 et s'installe l'été à Louveciennes, au Château des Sources (aujourd'hui résidence Dauphine).
"Séduite par cette vue si étendue que l'oeil peut y suivre pendant longtemps le cours de la Seine, par ces magnifiques bois de Marly, par ces vergers si délicieux, si bien cultivés qu'on se croit dans la terre promise ; enfin, par tout ce qui fait de Louveciennes l'un des plus charmants environs de Paris".

Elle y vécut 33 ans, entourée de nombreux amis, après avoir eu la douleur de perdre sa fille unique Julie en 1819. En son souvenir, elle offrit à l'Eglise de Louveciennes le portrait de Julie, représentée en Sainte Geneviève, tableau qui est maintenant exposé au Musée-Promenade de Marly-Louveciennes.
En 1834-35, elle écrit ses mémoires avec l'aide de ses nièces Caroline Rivière and Eugénie Le Franc.
Elle mourra en 1842 dans son appartement parisien de l'hôtel Le Coq , rue St Lazare, affaiblie depuis un an par une attaque cérébrale.
Élisabeth Vigée-Lebrun laisse 660 portraits et 200 tableaux de paysages. Selon son désir, sa tombe au cimetière de Louveciennes porte cette épitaphe"Ici, enfin, je repose ..."
Lisez la biographie pendant que les images se chargent
Autoportrait - 1790
Huile sur toile, 100cm x 81 cm,
Galerie des Offices, Florence.En 1789, Vigée-Lebrun fuit la France pour sauver sa tête. Elle s'arrêta d'abord à Florence, où elle fut accueillie comme un chef d'État.
On lui demanda à Florence de peindre son propre portrait pour la célèbre collection d'autoportraits de la Galerie des Offices.
Vigée-Lebrun a commencé son autoportrait à Florence, mais l'a terminé à Rome. Nombreux sont ceux qui pense qu'elle a peint là son meilleur visage, lumineux, souriant, juvénile et heureux.
Le sujet de la peinture est Marie-Antoinette.

 votre commentaire
votre commentaire