CATHERINE,
PRINCESSE DE TALLEYRAND
(1761-1835)
Jacques BRUN
Février 2007
I – Une vie d’aventures.
II – Maîtresse de Talleyrand.
III – Le mariage : Madame de Talleyrand-Périgord.
IV – Châtelaine de Valençay et Altesse Sérénissime.
V – Séparation et Nostalgie.
VI – Le souvenir.
VII – Pauvre princesse !
I - Une vie d’aventures.
Nous sommes au début du mois d’avril 1814. Napoléon est aux abois. Il abdiquera dans quelques jours. Les armées alliées sont à Paris.
Le tsar de toutes les Russies est l’hôte de Talleyrand, dans son hôtel où s’organise la Restauration. (Chateaubriand dira qu’elle s’y tripote).
Depuis longtemps, dans les salons de Talleyrand, se sont cristallisées les oppositions à l’Empire dont tout le monde est las. La rue Saint-Florentin est devenue le centre du monde. Caulaincourt vient plaider la cause de Napoléon II ; d’autres, celle des Orléans, certains même voudraient hisser Bernadotte sur le trône.
La religion de Talleyrand est faite. Il a depuis longtemps décidé du retour des Bourbons. Les prétentions des Bonaparte et consorts sont vite balayées ; cinq ans après, ils paieront l’insulte du bas de soie.
Des comparses, comme l’abbé de Pradt ou Aimée de Coigny, se répandent dans Paris pour diffuser la bonne parole. Si l’on en croit Chateaubriand (1), une autre personne enthousiaste parcourt les rues en calèche en exaltant partout le retour des Bourbons. C’est l’épouse de Talleyrand, la princesse de Bénévent.
Elle a 53 ans. Depuis 16 ans, elle vit dans l’ombre de son mari qu’elle admire. Il n’y a plus d’amour entre eux, seulement l’habitude et le respect des convenances. Elle n’en est pas moins la maîtresse de maison de l’hôtel de la rue Saint-Florentin.
Notre princesse ne se doute pas qu’elle est au tournant de sa vie qui, depuis un demi-siècle, a été une suite d’extraordinaires aventures.
Elle est née aux Indes, de parents bretons, à l’époque où les Français ont été chassés par les Anglais.
Son père, Jean-Pierre Verlée, né en 1724 à Port-Louis dans le diocèse de Vannes, était employé depuis de nombreuses années à Chandernagor par la Compagnie des Indes. Cette ville fut prise et détruite par les Anglais après le rappel de Dupleix en 1754. Il était, en 1758, lieutenant du port de Pondichéry ; devenu veuf, il avait deux filles de son premier mariage Marie Anne Françoise Xavier et Marguerite.
Sa mère, Laurence Alleigne, était la fille d’un maître armurier dans l’armée française de la Compagnie des Indes.
Jean-Pierre Verlée et Laurence Alleigne se marièrent le 17 avril 1758 ; il avait trente quatre ans et elle quatorze.
Le 10 novembre 1760, ils baptisèrent leur premier enfant, une petite fille, Françoise, mais, cette même année, les Anglais prennent Pondichéry et la rasent complètement, remparts, forteresse, maisons et églises. Les français ont trois mois pour partir.
Ici commence, en cette année 1761, l’épopée, le mot n’est pas trop fort, de notre héroïne qui va naître le 21 novembre. On la prénomme Catherine Noël ; pourquoi ce prénom masculin ? Il est vrai que son père a déjà prénommé une de ses filles Xavier…
Son lieu de naissance fait rêver : Tranquebar sur la côte de Coromandel ! On croirait du Hugo avant l’heure.
C’est une possession danoise que la guerre a épargnée. Tous les notables de Pondichéry s’y sont réfugiés. Ils y resteront deux ans jusqu’au traité de Paris qui sonna le glas des Indes françaises…
La famille Verlée retourne à Chandernagor, où va naître un petit frère de Catherine. Le père est tout de suite nommé capitaine du port. Il est très bien noté et pratique très officiellement, à côté de sa fonction, du commerce pour son propre compte, mais, quelques années plus tard ses affaires vont très mal.
La vie est triste et morne dans notre pauvre comptoir de Chandernagor. Catherine n’a que quinze ans mais les filles mûrissent très vite sous ces climats. Elle est ravissante et sa réputation de beauté va jusqu’à la riche et fringante Calcutta dont elle rêve.
De nombreux soupirants s’empressent autour d’elle mais c’est un certain Georges François Grand qui va l’épouser au mois de juillet 1777 et l’emmener à Calcutta. Il s’est fait naturaliser anglais pour pouvoir être employé par la Compagnie anglaise des Indes. Il est né à Genève où sa famille s’était réfugiée après la révocation de l’édit de Nantes.
C’est un personnage un peu falot dont Catherine croit être amoureuse et, effectivement, le ménage sera heureux quelque temps. Ils sortent beaucoup : soirées mondaines, dîners somptueux, bals costumés…. Mais tous les hommes de la colonie papillonnent autour de cette beauté et ce qui devait arriver, arriva : le riche et beau Sir Francis Philips, la coqueluche de toutes les dames de Calcutta réussit, un peu malgré elle, à la compromettre puis à la séduire. « Cette femme exhale l’amour » note-t-il dans son journal. Il y a procès et la Justice de sa Majesté Britannique indemnise pécuniairement le mari trompé qui se déclare satisfait…
Sir Philips est un homme marié, son épouse est en Angleterre avec six enfants. La liaison dure peu et Catherine décide de quitter les Indes. L’aventure commence.
|

CATHERINE GRAND
en 1783 - par Mme Vigée-Lebrun
|
Elle a dix neuf ans, elle est belle à couper le souffle, « grande et svelte, avec un teint d’une fraîcheur éblouissante, des cheveux aux admirables boucles blondes, des yeux bleus sous les sourcils noirs, elle avait un charme étrange. Elle émerveillait par l’éclat de sa beauté et elle séduisait par sa grâce un peu nonchalante »(2) .
Trois ans après, Madame Vigée-Lebrun, peintre attitré de Marie-Antoinette, immortalisera cette beauté. Elle embarque le 2 décembre 1780 sur un bateau hollandais à destination de l’Angleterre.
Elle y fait connaissance d’un Anglais, Thomas Lewin, jeune, beau et fortuné. Le navire est arraisonné par les Français et les deux amants sont débarqués à Cadix. Ils rejoignent Lisbonne et arrivent enfin à Londres sur un bateau portugais. Ils resteront ensemble un certain temps, à Londres et à Paris. Lewin se maria, devint père de famille et, si l’on en croit sa fille, il versera, sa vie durant, une pension à son ancienne maîtresse. John Whitehill, ancien gouverneur de Madras, lui succède auprès de la belle indienne, il lui versera aussi une rente viagère de trente mille francs.
|
De 1782 à 1792, pendant dix années, Catherine est à Paris. Elle mène grand train et tient le haut du pavé, riches appartements, bijoux, meubles, brillants équipages.
Ses amants l’entretiennent dans l’opulence. Ce sont Rilliet-Plantamour, agent de change, le jeune paltoquet baron de Frénilly qui lui offrira un équipage de deux chevaux blancs, le banquier Valdec de Lessart qui sera contrôleur général des Finances en 1790 ou Louis Monneron député des Indes à la Constituante.
Edouard Dillon, père de la comtesse de Boigne, s’est vanté d’avoir été reçu à dîner chez elle seulement vêtue de son abondante chevelure blonde.
Surviennent les évènements du 10 août 1792. Elle a trente ans. Elle assiste au massacre sous ses fenêtres du portier de la maison qu’elle habitait. Elle prend peur et part avec sa femme de chambre sans rien emporter et sans argent. A Paris, tous ses biens sont inventoriés et mis sous séquestre. Elle arrive à Douvres.
Elle s’appelle encore « Madame Grand » ou, mieux dans sa situation actuelle, « Madame Grant », cela fait plus anglais et en tant qu’épouse d’un sujet anglais, elle peut se prévaloir de la nationalité britannique. A Douvres, elle fait la connaissance d’un jeune lieutenant de la marine royale anglaise, Nath Belchier, âgé de vingt et un ans. Elle lui raconte ses malheurs. Celui-ci s’enflamme et se précipite à Paris avec un ami du nom de O’Dryer.
Leur qualité d’Anglais vaut passeport, Belchier est accueilli comme membre de la marine anglaise, il obtient la levée des scellés et, malgré les risques encourus, les deux amis quittent Paris le 19 septembre 1792 en sauvant tout ce qu’ils peuvent emporter : quatre vingt mille francs de vaisselle dont une partie était en or, trois cent mille francs de bijoux, perles et diamants, deux mille cent louis d’or qu’ils cousent dans leurs ceintures et deux cent mille livres de billets de la caisse d’escompte.. Huit jours après, ils remettent ce trésor à Catherine et refusent toute récompense ; ils ne demandent que le remboursement de leurs frais, soixante et quelques livres sterling. Il n’est pas interdit de rêver à ce que fut peut-être la véritable récompense.
Catherine arrive à Londres à la fin du mois de septembre 1792, elle y restera jusqu’à mai 1797. Elle gravite dans les différentes factions d’émigrés et a, entre autres, pour amant le comte de Lambertye dont nous reparlerons. Talleyrand est arrivé le même mois et y restera jusqu’à son départ pour l’Amérique en mars 1794.
Pendant quatre années, elle va vivre de son pécule et de différents trafics où elle excelle en servant d’intermédiaire. Cependant la vie n’est pas toujours rose puisqu’en mars 1795, elle demande une aide à Pitt. Elle veut retourner à Paris et obtient un passeport hollandais grâce à son lieu de naissance, Tranquebar étant devenu une possession hollandaise. Elle arrive à Paris, via Hambourg, vers juin 1797, dans les bagages du marquis Cristoforo de Spinola, ambassadeur de la République de Gênes à Londres après avoir occupé le même poste à Paris avant la Révolution. Celui-ci est expulsé immédiatement comme espion.
II - Maîtresse de Talleyrand.
On raconte que Catherine, inquiétée par la police du Directoire en mars 1798, se serait présentée, un soir, au ministère des Relations extérieures avec une recommandation de Montrond ou de Mme de Sainte-Croix pour demander l’aide de Talleyrand. Celui-ci étant absent, elle l’attendit dans un fauteuil et s’endormit. Reprise par Sacha Guitry dans son excellent film « Le Diable boiteux », cette légende résulte du récit du maître d’hôtel qui l’aurait accueillie au ministère.
La réalité a été tout autre. Talleyrand connaissait Catherine depuis longtemps.
Pendant les dix années ayant précédé la Révolution, il menait la « douce vie » des abbés de Cour et ne pouvait pas ignorer l’existence d’une des plus belles femmes de Paris qui attirait tous les regards. La duchesse d’Abrantès(3) raconte qu’à cette époque, étant aux Tuileries en compagnie de son compagnon de séminaire l’abbé de Lageard, il lui fit remarquer une femme qui marchait devant eux ; « elle était grande, parfaitement faite, et ses cheveux, du plus beau blond cendré, tombaient en chignon flottant sur ses épaules . Ils la doublèrent et furent charmés en la voyant : une peau de cygne, des yeux bleus admirables de douceur, un nez retroussé et un ensemble parfaitement élégant ». C’était madame Grand.
Quelques années plus tard, en janvier 1792, quand Talleyrand fut envoyé pour sa première mission diplomatique à Londres par Antoine Valdec de Lessart, ministre des Relations extérieures de Louis XVI, il ne pouvait pas ignorer que madame Grand était encore récemment la maîtresse de son ministre
De début octobre 1792 à fin février 1794, madame Grand et Talleyrand sont tous deux à Londres dans le grouillement de l’Emigration. madame de Flahaut s’y trouve également avec le petit Charles. Villemarest(4) cite une lettre adressée par Talleyrand à son ministre Lebrun-Tondu le 26 janvier 1793 pour mettre au point un système de correspondance par voie indirecte car, dit-il, les ministres anglais le soupçonnent et le font surveiller, malgré le deuil qu’il porte pour la mort du roi. Il ne se fie plus à madame de Flahaut car elle est jalouse de quelques autres connaissances qu’il a faites ici. Les instructions pourront lui être envoyées entre autres sous le couvert de madame Grant dont il possède l’amitié.
Après la rédaction de cette lettre, une année s’écoulera avant l’expulsion de Talleyrand et son départ en Amérique le 3 mars 1794. D’après Fouché dans ses Mémoires et Philip Francis, le séducteur de Calcutta, Charles-Maurice et Catherine se sont beaucoup vus à Londres en 1793(5) Les relations entre eux sont-elles allées plus loin que la simple amitié ? Cela est possible, sinon probable.
Retournons en juillet 1797 après l’expulsion de Cristoforo de Spinola évoquée plus haut.
Catherine est seule à Paris. Elle apprend que, le 16 juillet 1797, Talleyrand devient ministre des Relations extérieures du Directoire. Elle se souvient de leur amitié et c’est certainement à ce moment qu’elle le contacte et non pas, comme on le lit souvent, sept mois plus tard lorsqu’elle sera recherchée et arrêtée par la police. On chuchote rapidement qu’elle est devenue (ou redevenue) sa maîtresse et le 3 septembre elle figure parmi les invités d’une réception au ministère des Relations extérieures rue du Bac.
On peut estimer que c’est peu de temps après, vers décembre 1797 que fut conçue la petite Charlotte dont nous reparlerons et qui naîtra vers le mois d’août 1798.
Talleyrand est très amoureux, plus que Catherine n’est amoureuse. Elle n’a pas oublié Spinola ni ses amis de l’Emigration. Au mois de mars 1798, elle adresse à Londres par un commissionnaire une lettre à son ancien amant le comte de Lambertye, dans laquelle elle dit que Talleyrand surnommé « Piécourt , est plus amoureux que jamais et l’obsède du matin au soir ; il lui parle mariage depuis quelques jours et espère mettre un sceptre à ses pieds ; elle pense qu’il pourra être bientôt l’un des cinq Directeurs
Cette lettre suspecte est interceptée, Catherine est arrêtée comme conspiratrice ; Talleyrand écrit immédiatement à Barras sa célèbre lettre du 23 mars 1798 : « C’est la personne du monde la plus éloignée et la plus incapable de se mêler d’aucune affaire ; c’est une indienne bien belle, bien paresseuse, la plus désoccupée de toutes les femmes que j’ai jamais rencontrées. … . Je l’aime et je vous atteste à vous, d’homme à homme, que de sa vie elle ne s’est mêlée et n’est en état de se mêler d’aucune affaire. C’est une véritable Indienne, et vous savez à quel degré cette espèce de femme est loin de toute intrigue … »
Ce sera la seule fois où Talleyrand dira et écrira qu’il aime une femme.
Barras le soutient et, malgré l’opposition des Directeurs Larevellière-Lépeaux et Rewbell, Catherine est libérée.
Bien des années plus tard Adolphe Thiers s’étonnait que Talleyrand donne plus d’importance aux femmes qu’à la Politique. « Mais, lui répondit-il, les femmes, c’est la Politique ». Effectivement, c’est peut-être cette vision des affaires qui prévaudra plus tard dans ses actions mais pour l’instant, il n’y mêle pas les femmes. Ne s’est-il pas fâché avec Germaine de Staël à laquelle il doit son ministère mais qui voulait avoir trop d’emprise sur lui. « Mon Dieu, ne peut-elle enfin me détester ! » (6), dira-t-il, excédé.
En ce mois de mars 1798, il mise sur l’avenir de Bonaparte et il a donné le 3 janvier une réception mémorable en l’honneur de Joséphine. Il pressent le 18 brumaire.
Mais, pourquoi ce désir de mariage de Talleyrand ?
La raison ne peut être que l’état de grossesse de sa maîtresse qui est encore mariée. Le divorce est immédiatement demandé ; il est obtenu en quelques jours, le 7 avril 1798.
Cet état de grossesse expliquerait le style désinvolte employé par Catherine dans sa lettre à Lambertye en mars 1798, lettre qui lui valut d’être arrêtée par la police du Directoire. Elle écrit à un ancien amant qui, selon Emmanuel de Waresquiel (7), a été le seul grand amour de sa vie. Elle lui dit que Piécourt veut l’épouser mais se garde bien de lui dire qu’elle le veut aussi et encore moins qu’elle est enceinte.
Ils s’aperçoivent que le délai de viduité ne serait pas respecté et qu’un mariage ne résoudrait rien pour légitimer un enfant à naître cinq mois après le divorce. L’idée en est abandonnée. La naissance aura lieu secrètement, sans doute à Paris ou dans les environs. L’enfant, une petite fille, sera confiée à une certaine dame Beaujard et les deux amants continueront à vivre maritalement. Cette situation était courante à l’époque mais un enfant né hors mariage était une abomination. Pendant quarante ans la dame Beaujard fera chanter « le rusé compère qui, pour une fois, se trouva pris(8) ».Talleyrand devra lui payer une rente..
|

Charlotte
Baronne Alexandre de Talleyrand
Vers 1820. Dessin d’après Gérard
(Coll. André Beau)
|
Le couple récupèrera l’enfant qu’ils prénomment Charlotte. Elle apparaît pour la première fois à Bourbon l’Archambault en août 1803. Elle sera tendrement choyée et signera ses lettres « Charlotte de Talleyrand ». Le compositeur Dussek lui dédiera une de ses œuvres sous cette appellation. Des habitants de Valençay ont entendu le prince la tenant par la main sur la terrasse du château lui déclarer : « Charlotte, tout cela est pour toi » .(9)
Le 6 octobre 1807, Talleyrand sera, avec le consentement de Catherine, désigné par un juge de paix tuteur officieux de l’enfant « née de père et de mère inconnus ».
Il lui avait déjà donné son prénom, Charlotte, il voudra, en 1814, lui donner son nom en la mariant à son cousin germain le baron Alexandre de Talleyrand ; mais, pour cela, il faut lui constituer un état civil.
Il procèdera en deux temps : un prêtre de Londres certifiera que, le 14 octobre 1799, il a baptisé une fille née le 4 de même mois et prénommée Elisa Alix Sara. Ensuite, il désigne, parmi ses amis, un conseil de famille composé de six notables, le duc de Laval, le comte de Choiseul-Gouffier, Jaucourt, Dupont de Nemours, Dominique Bertrand et Dufresne Saint-Léon.
Le 30 août 1814, tous témoigneront devant le juge de paix que Elisa Alix Sara est la même personne que Charlotte .(10)
|
L’enfant du couple devient ainsi, très officiellement, Elisa-Alix Sara, baronne de Talleyrand, née à Londres le 4 octobre 1799.
Nous avons vu que, en fait, elle est née un an plutôt, en région parisienne et vers le mois d’août 1798.
III - Le mariage : Madame de Talleyrand-Périgord.
En 1799, Talleyrand est très amoureux physiquement de Catherine. Elle est experte et c’est certainement la femme qui, charnellement, comptera le plus dans sa vie. Cet amoureux état de grâce durera presque dix ans. Le prude Molé a dit : « Le pouvoir qu’elle avait sur lui avait cela de repoussant qu’on ne pouvait lui assigner que la plus charnelle origine. » (11)
Charles-Maurice n’était pas un foudre de guerre en amour, c’était un cérébral ; « non fortiter in re, suaviter in modo»(12) a dit madame de Flahaut. Catherine est la seule femme qui a su l’emmener au septième ciel. Ce sont des choses que l’on n’oublie pas.
Survient le 18 brumaire (10 novembre 1799). Talleyrand réintègre le ministère des Relations extérieures du gouvernement consulaire. Catherine demeure dans son hôtel rue d’Anjou. Elle est aussi la maîtresse de maison à l’hôtel de Galliffet. Elle reçoit beaucoup ; Joséphine lui témoigne son amitié ; elle lui aurait fait don de la petite guenon à qui on faisait cacheter les lettres du ministère au grand amusement des collaborateurs du ministre. Bonaparte est bien disposé envers elle, Napoléon l’aura en aversion ; Casimir Carrère(13) le soupçonne de lui avoir fait en vain des avances comme il avait l’habitude d’en faire aux femmes ou amies de ses ministres.
En 1802, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte . En mars, c’est la paix d’Amiens, en avril ce sera le Concordat et en août le Consulat à vie. L’ordre moral de l’Eglise renaît en même temps que les convenances mises à mal par la Révolution. Des femmes d’ambassadeurs montrent une certaine réticence à faire la révérence à madame Grand, la maîtresse du ministre.
Bonaparte exige soit la séparation, soit le mariage. Talleyrand est toujours très amoureux et il y a l’existence de Charlotte ; il décide de se marier. A grand renfort de diplomatie, le 21 juin, un bref du Pape réduit le prêtre à l’état laïc mais ne donne pas à l’évêque l’autorisation de se marier. Un décret enregistre le bref de façon ambiguë et l’on passe outre. Le mariage civil aura lieu le 10 septembre 1802. La veille, à Neuilly un contrat de mariage est signé devant deux notaires et contresigné par les deux frères de Talleyrand, Archambaud et Boson, par le premier consul Bonaparte et son épouse Joséphine et par les deux autres consuls Cambacérès et Lebrun. On a rarement vu une union célébrée sous de pareils auspices.
Un prêtre constitutionnel d’Epinay, l’abbé Pourez, quelques jours après, célèbrera le mariage religieux que Talleyrand a voulu bien que rien ne lui en fasse une obligation. N’oublions pas que Bonaparte lui-même n’était pas marié à l’Eglise (Le cardinal Fesch le mariera en catastrophe la veille du couronnement). Il est indéniable que son attachement à Catherine et l’existence de leur fille Charlotte sont pour beaucoup dans sa décision de ne pas faire les choses à moitié.
IV - Châtelaine de Valençay et Altesse Sérénissime.
Talleyrand, dès qu’il est devenu ministre du Directoire en 1798, a cherché à constituer un important patrimoine immobilier : un hôtel rue d’Anjou à Paris, le domaine vinicole de Haut-Brion ou le château et les terres de Pont-de-Sains, cette dernière acquisition étant achetée en communauté avec Catherine avant qu’elle ne devienne sa femme.
Moins d’un an après son mariage, le 7 mai 1803, il achète, sur les conseils et avec l’aide du premier Consul, le château de Valençay et son immense domaine.
Catherine devient la châtelaine d’un château à la mesure des ambitions de Talleyrand : près de 12.000 hectares de terre et de forêts, une filature, une forge, une quantité de fermes ou de métairies.
Catherine s’y plaît beaucoup. Elle crée une école pour éduquer douze jeunes filles. En les accueillant, Talleyrand dit qu’elle est une nouvelle Madame de Maintenon. madame de Staël ne manquera pas de se gausser de cette comparaison.
Elle s’occupe de tout, donne ses instructions au régisseur, organise les nombreuses réceptions. Elle attire des regards curieux et admiratifs lorsqu’elle fait du cheval en habit de gentleman. « Madame de Talleyrand règne sur Valençay, entourée d’invités, de ses jeunes pupilles, de ses voisins dont les Godeau d’Entraigues, et d’une foule de serviteurs. ».(14)
L’une de ses jeunes pupilles, la princesse Anna Santa Croce, sera mariée plus tard à Amédée Godeau d’Entraigues qui deviendra préfet d’Indre et Loire en 1830.
Le 5 juin 1806, Catherine devient Son Altesse Sérénissime la princesse de Bénévent. A ceux qui viennent le féliciter, le nouveau prince répond : « Allez donc féliciter madame de Talleyrand, les femmes sont toujours très fières de devenir princesse. »
En effet, elle en est très fière, on le serait à moins. Il lui arrivera de signer deux lettres « princesse souveraine » et « princesse régnante », lorsqu’elle écrit à Louis de Beer(15) , gouverneur de sa petite principauté de vingt mille habitants ; elle veut promouvoir Bénévent parmi ses relations et lui réclame des objets de manufacture, des curiosités du pays ou encore des chapelets pour les distribuer autour d’elle. Elle reçoit des caisses de « toroni », friandise du genre nougat que le prince aime beaucoup et qu’elle n’offre qu’aux personnes favorisées. « Tout ce qui me vient de Bénévent, lui écrit-elle, m’offre un intérêt que vous devez comprendre et qui vous fera juger, Monsieur, de tout l’attachement que je me sens pour ce pays. »
Début mai 1808, Napoléon décide que Talleyrand, son Grand Chambellan, devra recevoir à Valençay les princes d’Espagne, Ferdinand, prince des Asturies qui deviendra Ferdinand VII, son frère Don Carlos et leur oncle Don Antonio. « Je désire … que vous fassiez tout ce qui sera possible pour les amuser. … .Vous pourriez y amener Mme de Talleyrand avec quatre ou cinq femmes. Si le prince des Asturies s’attachait à quelque jolie femme, cela n’aurait aucun inconvénient, surtout si on en était sûr. »
La princesse de Bénévent part immédiatement. Les princes arrivent le 18 mai 1808 avec leur suite. Ils resteront six ans au château qu’ils dévasteront. Après avoir accueilli ses hôtes par obligation, Talleyrand n’y mettra plus les pieds jusqu’en 1816. Sa passion pour sa femme s’est éteinte, il aime ailleurs.
Sous une surveillance étroite de la police, Catherine dirige tout à Valençay. En signe de gratitude, elle recevra, quinze ans plus tard, le grand cordon de l’Ordre de Marie-Louise en reconnaissance des égards qu’elle avait eus pour adoucir la position de S.M. Ferdinand VII pendant son séjour à Valençay. Elle demandera et obtiendra de Charles X l’autorisation de porter cette distinction.
|

Catherine, princesse de Talleyrand
Vers 1814. Lithographie d’Engelmann d’après un portrait d’Isabey.
(Arch.. dép. de l’Indre)
|
En attendant, ce qui devait arriver arriva. Le prince des Asturies avait un chambellan, Don Joseph-Michel de Carvajal, duc de San Carlos. C’est un grand seigneur dont la carrière, déjà bien remplie, comptera dans l’Histoire de l’Espagne. Il est très beau et, en 1808, il a trente sept ans, neuf ans de moins que Catherine. C’est le coup de foudre.
« Vous ne m’avez pas dit que le duc de San Carlos était l’amant de votre femme ! » lancera Napoléon à celui qu’il vient d’injurier le 29 janvier 1809, « En effet, sire, je n’avais pas pensé que ce rapport pût intéresser la gloire de votre Majesté, ni la mienne. »(16)
Par ordre de l’Empereur, San Carlos est assigné à résidence à Lons-le-Saunier et la princesse de Bénévent doit se rendre dans ses terres de Pont de Sains.
La police la surveille et Savary fait savoir un jour à Talleyrand, que cela indiffère, qu’elle a rejoint plusieurs fois son amant dont une fois habillée en homme.
Cet amour durera jusqu’à la mort du duc en juillet 1828. Revenu l’année précédente pour la deuxième fois comme ambassadeur à Paris, il meurt d’une indigestion de langoustes le lendemain d’un repas pris chez la princesse. Ayant dit à Dalberg qu’il regrettait beaucoup le duc de San Carlos, Talleyrand lui expliquera : « Le duc de San Carlos était l’amant de ma femme, il était homme d’honneur et lui donnait de bons conseils dont elle a besoin. Je ne sais pas maintenant dans quelles mains elle tombera. », paroles cyniques qui montrent qu’il ne s’est jamais désintéressé du sort de sa femme…
|
En 1812, elle règne rue Saint-Florentin après l’achat de l’hôtel de l’Infantado. Talleyrand, quand il n’est pas en voyage, y cohabite avec sa femme ; c’est elle qui reçoit les invités lors des réceptions, elle préside avec lui à table et donne les ordres aux domestiques. Il n’y a plus d’amour, seulement des habitudes.
V - Séparation et nostalgie.
Avril 1814, les Bourbons sont rétablis en France par la volonté de Talleyrand. Nous avons vu Catherine prendre part à l’enthousiasme des opposants à l’Empire. Elle va bientôt déchanter.
En septembre, Talleyrand part au congrès de Vienne. Il laisse à Paris sa femme et sa maîtresse, la duchesse de Courlande. Curieusement, ces deux femmes s’entendent très bien.
En 1809, Dorothée, la fille de la duchesse de Courlande, a épousé Edmond, le neveu de Talleyrand. Elle déteste Catherine et ses relations ont toujours été très froides envers son mari et sa mère.
C’est une jeune femme belle et intelligente. Elle a vingt et un ans et Charles-Maurice en a soixante. Il emmène à Vienne cette brillante nièce plutôt que sa femme légitime qui est encore belle mais qui a cinquante trois ans. En outre, il ne l’aime plus physiquement et il n’a jamais eu d’affinités intellectuelles avec elle.
Saisi par le démon de midi, il est tombé, « comme un jeune homme de dix huit ans(17) », amoureux transi de Dorothée. Celle-ci répondra à sa flamme mais ses nombreux amants le feront beaucoup souffrir jusqu’à ce qu’il en prenne son parti. Pendant vingt quatre ans, jusqu’à la mort du prince, elle tiendra sa maison avec beaucoup de classe et d’autorité.
Comment Catherine pouvait-elle lutter ?
Réfugiée à Londres pendant les Cent-Jours, elle écrit tristement à Mme d’Osmond (18): « Je porte la peine d’avoir cédé à un faux mouvement d’amour propre. Je savais l’attitude de Mme Edmond chez M. de Talleyrand à Vienne ; je n’ai pas voulu en être témoin. Cette susceptibilité m’a empêché d’aller le rejoindre, comme je l’aurais dû, lorsque le retour de l’île d’Elbe m’a forcée de quitter Paris. Si j’avais été à Vienne au lieu de venir à Londres, M. de Talleyrand aurait été forcé de me recevoir. Et je le connais bien, il m’aurait parfaitement accueillie. Plus cela l’aurait contrarié, moins il y aurait paru. Au contraire, il aurait été charmant pour moi... Où je me suis trompée, c’est que je le croyais trop faible pour jamais oser me chasser. Je n’ai jamais assez calculé le courage des poltrons dans l’absence ! J’ai fait une faute, il faut en subir la conséquence et ne point aggraver la position en se raidissant contre. Je me soumets… »
Quand Talleyrand revient à Paris, après Waterloo, il redoute le retour de sa femme. Un accord est négocié par des intermédiaires. Dorothée, toutes griffes dehors, affirme à son oncle que « l’argent est le vrai mobile de toutes les actions de Mme de Talleyrand et qu’il faut la contraindre à vivre en Angleterre » sous peine de voir ses subsides supprimés. Finalement il est convenu qu’elle passera l’hiver à Bruxelles et l’été à Pont-de-Sains. C’est en ce dernier lieu que Catherine restera deux ans en rongeant son frein.
Fin 1817, oubliant en partie l’accord, elle revient à Paris. Talleyrand l’accepte à condition qu’elle demeure dans un autre quartier. Elle va habiter à Auteuil puis, rue de Lille.
Pendant dix sept ans, jusqu’à sa mort, la princesse va vivre dans la nostalgie de la rue Saint Florentin ou du château de Valençay. Elle tient salon, reçoit de nombreux visiteurs et revoit son cher San Carlos. Elle a toujours eu d’excellentes relations avec les frères de son mari et voit très souvent sa fille Charlotte et Georgine la fille de Boson. Son embonpoint s’est accru. Elle vieillit.
Le 7 décembre 1835, Catherine est très malade. Elle demande le secours de la religion. Mgr de Quelen, archevêque de Paris, interrompt immédiatement ses audiences et se rend à son chevet. Le 9 décembre, elle meurt entourée de ses proches, de ses amis et de ses domestiques.
Talleyrand a fait demander des nouvelles de sa femme et, en apprenant sa mort, il délègue son homme d’affaires, M. Demion, pour organiser des obsèques de première classe. Il est souffrant et n’a « pas paru au chevet de la princesse ; il n’a pas paru davantage aux obsèques » (19). Pourquoi ne pas en conclure que, non souffrant, il l’eut fait ?
Le deuil a été conduit(20) par Louis de Valençay (vingt quatre ans) et Alexandre de Périgord (vingt deux ans), les deux fils de Dorothée. Ce n’est certainement pas celle-ci qui en a décidé ainsi. Il est évident que c’est Talleyrand lui-même qui a ainsi confirmé l’appartenance de Catherine à sa famille.
VI - Le souvenir.
Nous avons vu que, de 1798 à 1807, l’euphorie a régnée entre Talleyrand et sa chère Kelly, ainsi qu’il l’appelait tendrement. A aucun moment, ni lui, ni sa famille n’évoqueront son passé aventureux. Il est vrai que ce passé n’avait rien d’exceptionnel : Thérésa Gabarus, Mme Tallien, puis maîtresse de Barras, d’Ouvrard et d’autres est devenue princesse de Caraman Chimay ; Rose Tascher de la Pagerie, Mme de Beauharnais, puis maîtresse de Hoche, de Barras et d’autres, est devenue l’impératrice Joséphine.
De 1808 à 1815, le couple a mené une vie semblable à celle de beaucoup de leurs contemporains. A cette époque, le cocuage était fréquent et banal. Il ne dérogeait pas aux convenances.
Talleyrand a admis l’aventure de son épouse avec le duc de San Carlos et Catherine a accepté les nombreuses incartades de son mari. Lui, se laissait aduler au milieu de son « harem » d’admiratrices et d’anciennes maîtresses plus ou moins bas-bleus et elle, un peu à l’écart, était heureuse de son sort, indifférente aux qu’en-dira-t-on. Il n’y avait plus d’amour entre eux mais elle n’a jamais cessé de tenir son rôle quand elle recevait ou était invitée.
Lorsque Talleyrand sera parti au Congrès de Vienne Madame Reinhard notera ; « Je voudrais borner mes sorties aux réceptions de la princesse de Bénévent. ».(21)
Catherine est au mieux avec la duchesse de Courlande, la maîtresse de Talleyrand restée à Paris. Jaucourt, qui assure l’intérim du ministère des Affaires Etrangères, écrit à son ministre le 1er novembre 1814 : « La duchesse de Courlande chez qui je passe ma vie, m’a fait l’honneur de me faire dîner, dimanche, avec la princesse de Talleyrand, demain avec M. l’archevêque de Reims. »(22) ou, une autre fois : « Ma femme ne vous écrira que samedi. l’honneur qu’elle a d’offrir à dîner à la princesse de Talleyrand avec les ambassadeurs l’absorbe. ».(23)
Viennent ensuite, à partir de 1815, les vingt années de séparation durant lesquelles les deux frères de Talleyrand n’ont pas cessé de la fréquenter. Celui-ci demandait des nouvelles de sa santé et madame Colmache, l’épouse d’un de ses secrétaires, a écrit que, tous les ans, il s’inquiétait de savoir si ses domestiques et collaborateurs lui avaient bien présenté leurs vœux. (24)
Talleyrand n’a jamais et à aucun moment renié son mariage. Il l’a totalement assumé au point de donner officiellement son nom à Charlotte qui en a été le fruit.
N’est-il pas remarquable de constater que, peu de temps avant la mort du prince, Mgr de Quelen et tout un cénacle de théologiens prépareront le texte de rétractation qu’il devrait signer pour se réconcilier avec l’Eglise. Il doit, entre autres, désavouer, condamner et rétracter le mariage, illicite et nul, d’après les lois canoniques, qu’il a eu le malheur de contracter « devant les saints autels » au moyen d’une interprétation arbitraire et forcée du bref du pape Pie VII.
On connaît la longue négociation qui s’en suivit menée jusqu’à sa dernière heure par l’abbé Dupanloup, Dorothée sa nièce et Pauline, sa petite nièce, fille de la précédente. Finalement, à quelques heures de sa mort, Talleyrand signera une déclaration qu’il a lui-même rédigée et dans laquelle aucun grief n’est précisé. Il se borne à déplorer (mais ni ne les regrette ni ne les rétracte) les actes de sa vie qui ont contristé l’Eglise.
Talleyrand a voulu que Catherine reste son épouse devant Dieu, l’Eglise et les hommes. Personne ne l’a contesté de son vivant. Il faudra que la contestation vienne de Dorothée, reprise en écho par Chateaubriand parlant de Catherine « que Bonaparte avait attachée à son mari comme un écriteau .»(25)
En octobre 1835, Dorothée a été avertie par Charlotte, baronne de Talleyrand, que la princesse (sa mère) était à l’article de la mort (26). Elle annonça à Talleyrand la maladie de sa femme avec beaucoup de ménagement car elle ne voulait pas que cela l’affecte, ce qui démontre qu’elle était consciente de ce que son oncle n’était pas indifférent au sort de sa femme. Il ne dit rien mais, les jours suivants, ils furent tous deux très préoccupés par les incidences financières d’une éventuelle disparition. En effet l’article 8 du contrat de mariage établi trente trois ans plus tôt stipulait que tous les biens de son épouse devaient lui revenir. L’exécution de cette clause provoquera quelques remous avec Georgine, fille de Boson le frère de Talleyrand. En apprenant la mort de la princesse, il aurait conclu ; « Voilà un évènement qui simplifie beaucoup ma position ». Paroles cyniques d’un homme qui n’aurait plus à payer une pension et allait récupérer tous les biens de la défunte.
Talleyrand meurt le 17 mai 1838. Dorothée est sa légataire universelle. Sa hargne à l’encontre de Catherine n’a pas faibli. Un an après, le 10 mai 1839, elle écrit au père Dupanloup qui avait assisté le prince dans ses derniers instants. Pour ce prêtre et pour ses supérieurs, le mariage de Talleyrand est une affaire classée mais elle la remet la question : Elle écrit : « Chaque fois que j’avais parlé à mon oncle de son mariage, et cela m’était arrivé souvent, je ne craignais pas de lui montrer ma surprise d’une faute aussi inexplicable aux yeux des hommes qu’elle était fatale aux yeux de Dieu. Il me répondait alors : « Je ne puis, en vérité, vous en donner aucune explication suffisante ; cela s’est fait dans un temps de désordre général ; on n’attachait alors grande importance à rien, ni à soi, ni aux autres ; on était sans société, sans famille, tout se faisait avec la plus parfaite insouciance, à travers la guerre et la chute des empires. Vous ne savez pas jusqu’où les hommes peuvent s’égarer aux grandes époques de décomposition sociale. » …
…que non seulement, il ne cherchait pas à justifier son mariage, mais qu’en vérité il n’essayait pas même de l’expliquer. Il en avait été très malheureux dans sa vie domestique. Sous l’Empire, sous la Restauration, depuis encore, je l’ai toujours vu embarrassé, honteux de cet étrange lien, dont il ne voulait plus porter et dont il ne pouvait entièrement rompre la pénible chaîne. Aussi, quand la mort vint la briser, il sentit pleinement sa délivrance. » : (27)
Or, en 1802, l’ordre avait été rétabli, la France était prospère et nullement décomposée socialement.
Ces propos prêtés à Talleyrand ne sont pas étonnants, échangés par un homme âgé, peu expansif et de nature assez indolente avec la jeune femme qui partageait sa vie depuis vingt deux ans, qui avait une grande emprise sur lui et à qui, ainsi qu’elle le dit, .il était « arrivé souvent » de le questionner à ce sujet. Quand à un Talleyrand « embarrassé, honteux de cet étrange lien », qu’il soit permis d’en douter lorsqu’on connaît l’homme…
Les Mémoires de Talleyrand, revus et corrigés par Dorothée et Bacourt, ne parlent pas de son mariage. On peut toutefois y trouver une allusion indirecte dans les premières lignes de la sixième partie qui traite de l’année 1809. Il veut marier son neveu Edmond et veut mener cette affaire avec intérêt et attention. Il veut un grand nom et une grande fortune. Il lui fera épouser Dorothée. Il vient d’être disgracié par l’Empereur. Il aspire au repos et aux « occupations douces » car, avec Napoléon, ce genre de vie n’était pas possible. « Je partageais cette condition qui explique l’indifférence que chacun portait dans tous les actes de la vie, et que je me reproche d’avoir mise dans plusieurs de la mienne ». (28)
Son mariage pourrait faire partie de ces actes qu’il aurait accomplis avec indifférence à cause de Napoléon qui « croyait que, pour être à lui, il fallait être hors de soi ».
Talleyrand n’était pas un homme à avoir des regrets mais, s’il s’est fait un reproche, c’est d’avoir, par indifférence, imposé une mésalliance à sa Maison à laquelle il est devenu très attaché sur le tard. Le séminariste, l’abbé de Périgord, l’évêque ou le révolutionnaire ont été indifférents à la « Maison de Périgord » par réaction à l’ordre établi de l’ancien régime, le grand dignitaire du Consulat et de l’Empire n’a pas eu, jusqu’en 1809 et par la faute de Napoléon, le temps d’y être attentif.
Les détracteurs de Catherine ne se sont pas bornés à la présenter comme une intruse et une intrigante.
On a voulu la faire passer pour niaise.
Talleyrand avait des amis et des ennemis. La pauvre princesse a dû subir à la fois l’inimitié des ennemis du prince et les moqueries de beaucoup de ses amis. Elle a été la tête de turc des faiseurs de bons mots. « Les Tallemant des Réaux de ce temps, a écrit Michaud (29)en 1846, racontaient les balourdises de la citoyenne Talleyrand, souvent inventées par l’esprit d’opposition… ».
Elle n’a jamais dit « Je suis d’Inde »(30) . Autre exemple, on s’est gaussé de la confusion qu’elle aurait faite d’un invité avec Stevenson, l’auteur de Robinson Crusoé, alors que la même histoire avait déjà été colportée au XVIIIème siècle avec d’autres acteurs.
Dans ses Mémoires, Mme de Chastenay a écrit : «… Je n’ai jamais rien entendu sortir de sa bouche qui ressembla aux propos vides de sens que l’on se plaisait à lui prêter. Jamais elle n’a proféré devant moi une seule phrase de mauvais ton, jamais elle n’a dit un mot qu’on pût qualifier de bêtise. »
On a voulu aussi la faire passer pour inculte. Or, elle écrivait beaucoup et très bien dans un style excellent. Ses lettres au chevalier Millin en sont un témoignage. Elle ne faisait pas plus de fautes d’orthographe que Talleyrand lui-même et, contrairement à celui-ci, elle avait une belle écriture. Comme l’a dit Michel Missoffe, « …n’en déplaise aux nouvellistes de son temps et du nôtre, elle ne méritait certainement pas le bonnet d’âne . »(31)
Aujourd’hui, en ce début du XXIème siècle, par habitude, Catherine n’est pas mieux traitée ; beaucoup persistent à l’appeler « Madame Grand » quelle que soit la période de sa vie. L’idée reçue veut que l’on se moque d’elle et que ses défauts, souvent forcés ou inventés, soient mis en avant.
C’est ainsi que, dans un ouvrage important sur Talleyrand (32), on peut lire un texte de la lettre, qu’aurait adressée Catherine à Pitt pour lui demander des secours en mars 1795 (cf. supra). Cette lettre, écrite en français, est un vrai charabia. « … le maître d’écriture n’avait pas dû suivre son élève en Angleterre. », ironise l’auteur qui n’a pas voulu voir que, à l’évidence, ce document était une mauvaise traduction d’un fonctionnaire anglais d’une lettre adressée en anglais au premier ministre.
Même le fait, reconnu par tous, qu’elle était très belle, a révélé des malveillances : Le musée de Dijon expose un portrait, daté de 1787, de « Madame Grand par Antoine Vestier ». (On peut en voir la reproduction dans les pages hors-texte des illustrations de la biographie de Talleyrand de Jean Orieux.).
L’œuvre du portraitiste Antoine Vestier a fait l’objet, en 1974, d’une étude de Jean-Claude Sueur, descendant de l’artiste. En fait, le tableau du musée de Dijon n’est pas d’Antoine Vestier mais de son fils Nicolas et on lit : « Ce portrait pose un problème. En effet, il est censé reproduire les traits de la future épouse du prince de Talleyrand lequel, il est vrai, protégea Nicolas et ses fils. Cependant le modèle paraît sensiblement plus âgé et plus laid que ne l’était la jolie Catherine à l’époque. Il s’agirait donc d’une autre Mme Grand, soit la femme du banquier parisien d’origine genevoise R.F. Grand (1726-1794), soit celle du feudiste (spécialiste de droit féodal) Henry Grand qui sera arrêté en germinal an II, en même temps que Hyacinthe de Pestre, autre modèle de Vestier. ».
Alerté de cette confusion, le musée de Dijon n’en a tenu aucun compte.
VII - Pauvre princesse !
Oui, pauvre princesse qui ne mérite pas tout le mal que l’on a dit d’elle. Certes, ce n’était pas une Mme de Staël mais elle avait beaucoup de bon sens et était très bonne. Il faut la laisser dans le contexte historique de son époque et surtout, ne pas la juger selon les normes des deux siècles suivants.
Dans l’illustre famille des Talleyrand Périgord, il y a eu des baronnes, des comtesses, des marquises ; il n’y a eu qu’une princesse de Talleyrand et ce fut elle.
Au cimetière Montparnasse, en 1835, sa tombe consistait en une dalle entourée d’une grille en fer forgé. Dans les années 1930, il ne restait qu’un morceau de la grille et actuellement il n’y a plus rien qu’une parcelle de terre battue sur laquelle circulent les visiteurs du cimetière.
Peut-on rester indifférent devant cet état d’abandon ?

Cimetière Montparnasse. Etat actuel de la parcelle de terre battue sous
laquelle repose la princesse de Talleyrand. (Photo Jacques BRUN)
Pauvre princesse !


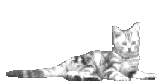









































































































 Comme pour les siècles précédents, le parfum était utilisé pour lutter contre les épidémies. Ainsi, à Lyon, en 1628, pour enrayer les ravages de la peste, fut organisée par les parfumeurs une désinfection générale des placards. Ils pratiquèrent des fumigations à base de soufre, d'antimoine, d'orpiment et de camphre.
Comme pour les siècles précédents, le parfum était utilisé pour lutter contre les épidémies. Ainsi, à Lyon, en 1628, pour enrayer les ravages de la peste, fut organisée par les parfumeurs une désinfection générale des placards. Ils pratiquèrent des fumigations à base de soufre, d'antimoine, d'orpiment et de camphre.


















































